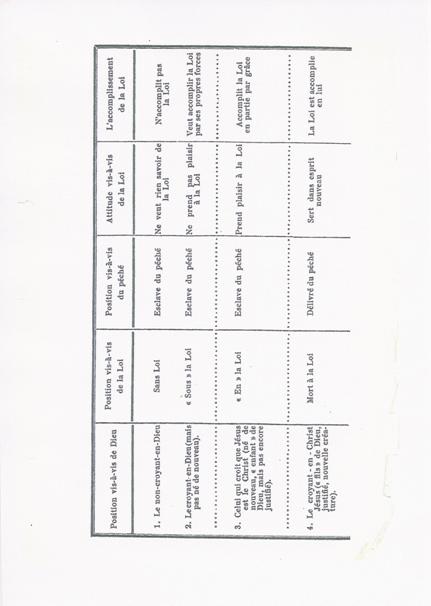S.V.M.
Volume 2
LES ENSEIGNEMENTS
de l’Apôtre Paul
1936
Éditeur : S. VAN MIERLO
9, Rue Pierre Bertin, 9
VERSAILLES
Chèques postaux - Paris 1774.93
Téléphone : Versailles 29.09
Prix : 10 francs
Ouvrages de M. Ch.-H. WELCH
La revue « The Berean
Expositor », les livres et les brochures peuvent être obtenus chez Mr F. P.
Brininger, 14, Hereford Road, Wanstead, London E 11, Angleterre.
La brochure « La Voie par
excellence » et quelques autres imprimés français sont à commander chez Mlle
J. Bieth, 44, rue Victor Hugo, Lyon, ou chez Miss F. Thorpe, 21, Victoria
Road, West Kirby. Angleterre.
Nos Publications Hollandaises
La revue « Uif de Sehriffen »,
les livres et les brochures peuvent être obtenus à l'Administration de cette
revue : Alexander Gogel weg 24, 'sGravenhage, Nederland ; ou : Jacobstr. 18,
Antwerpen, België. Le présent livre peut aussi être obtenu à cette dernière
adresse.
Nos publications Sud-Africaines
S'adresser à l'Administration
de « Uif de Schriften », Alexander Gogel weg 24, 'sGravenhage,
Nederland.
Correspondance
Pour toute correspondance au
sujet du présent livre s'adresser à M. S. VAN MIERLO, 9, rue Pierre Bertin
Versailles.
Lire aussi :
LE PLAN DIVIN
ET SA RÉALISATION
Par S. V. M.
Ce livre donne un aperçu des
âges depuis la création initiale jusqu'à la fin et traite de beaucoup de
questions importantes telles que: La création, la chute, les Alliances, la Loi,
les prophètes, la mission d'Israël, le Royaume sur terre, la période des Actes,
la rejection provisoire d'Israël, le jour du Seigneur, le siècle à venir, la
nouvelle création, Dieu tout en tous.
L'ouvrage contient aussi les
appendices suivants : « Le corps humain », « Les géants », « Les Lois de la
nature et les miracles », « Le premier jour de la semaine) , etc..
Page
INTRODUCTION
............................................................................ 5
Résumé de notre ouvrage « Le Plan Divin »
................................. 16
PREMIÈRE
PARTIE
Pendant
la période des Actes
1. Qui est Paul ?
...............................................................................
23
2. Plusieurs Évangiles .....................................................................
24
3. Le Message du Royaume et de la Nouvelle Naissance
............... 26
4. Le Message du Royaume dans les Épîtres
................................... 33
5. Le Message céleste………………………………………………35
6. Considérations relatives à la Loi
................................................. 38
7. L'Histoire de l'Olivier ..................................................................
45
8. La Justification
............................................................................ 50
9. Les deux Hommes .......................................................................
54
10. Résumé de la période des Actes
................................................ 58
DEUXIÈME
PARTIE
Après
les Actes
1. Les quatre Épîtres écrites en Prison ...........................................
62
2. Le Message du Mystère
.............................................................. 63
a) Une nouvelle unité ....................................................................
65
b) Un nouveau mystère
.................................................................. 67
c) Accès à une nouvelle sphère ......................................................
69
d) Une nouvelle Église
.................................................................. 71
e) Une nouvelle espérance
............................................................. 72
3. Les trois sphères
........................................................................ 73
4. Paul abandonné
.......................................................................... 76
5. Le désarroi général au premier siècle
........................................ 80
TROISIÈME
PARTIE
Les
documents humains des premiers siècles
a) Épître de Barnabas ........................……………………….......… 83
b) La « Doctrine des douze Apôtres » ..........………………...….... 85
c) Les Épîtres de Clément ........................
....................................... 88
d) Les Épîtres d'Ignace
......................................................................89
e) L'Épître de Polycarpe ....................................................................90
f) Les Livres d'Hermas
.......................................................................90
g) Constitutions des Apôtres
..............................................................90
h) Les Pères Apologètes .....................................................................90
i) Eusèbe…………………………………………………. ...............92
CONCLUSION ................................................................................100
APPENDICE 1. - Autre et Différent
..................................................106
APPENDICE 2. - Né de l'Esprit, rempli de l'Esprit,
accompli par l'Esprit .........................................................................109
APPENDICE 3. - Les Épîtres de Paul ...............................................112
APPENDICE 4. - Les Sur Célestes
...................................................115
APPENDICE 5. - L'Église qui est le Corps de Christ
APPENDICE 6. - Peut-on juger de la valeur d'un message
d'après le nombre de conversions obtenues ?....................................123
APPENDICE 7. - La Pâque et la Messe
............................................127
APPENDICE 8. - La date de la Pâque
...............................................131
APPENDICE 9 . – Quelques considérations éparses relatives à
« l’Église naissante »………………………….............................….133
SCHEMAS
ET TABLEAUX
L'Histoire de l'Olivier.
.........................................................................49
Les Trois Sphères
................................................................................73
Les éons et les sphères
........................................................................74
Résumé du rituel de la Pâque juive………………………………….129
_________________________
Alençon
– Imp. Corbière & Jugain.
LES ENSEIGNEMENTS
de l'Apôtre Paul
Page 5
Alors que notre premier volume,
Le Plan Divin a pour but principal de donner un aperçu, général des âges
et du rôle du peuple d'Israël, le présent ouvrage traite plus spécialement la
période des Actes et de l'intervalle entre cette période et le retour de
Christ. Après avoir, dans le premier volume, indiqué les grandes divisions à
discerner dans l'histoire de l'humanité, nous examinons ici les grandes
divisions à reconnaître dans les messages divins.
Nous croyons que, si le
déplorable état actuel du christianisme est avant tout dû à un manque de foi,
deux grandes erreurs ont été, d'une manière plus spéciale, la source de la
confusion et de la ruine : l'idée que « l'Église » remplace Israël et que ce
peuple n'a plus, dès lors, d'avenir comme tel, que cette « Église » commence à
la Pentecôte, et que la totalité du N.T. concerne tous les croyants sans
distinction. Cette tradition humaine des premiers siècles a conduit d'une part
à une usurpation de pouvoir (l'Église de Rome), et d'autre part à une confusion
générale (le protestantisme).
Suivons très sommairement
quelques étapes de ce développement. On n'a pas cru à l'avenir d'Israël, malgré
les affirmations innombrables de la loi et des prophètes. On n'a pas distingué
les âges et les dispensations. Quand Israël fut rejeté temporairement à la fin
des Actes, on a donc cru qu'une autre unité visible devait remplacer ce peuple,
et l'on est arrivé petit à petit à lui approprier le rôle qu'Israël aura sur
terre pendant l'âge prochain. C'est la base de l'Église romaine avec tous ses
abus. Mais le fait qu'un tel ordre de choses n'est pas scripturaire conduit
nécessairement à la corruption. De là une réaction de ceux qui tiennent aux
Écritures ; et la Réforme fait un effort pour revenir vers la foi divine et
vers les enseignements de Paul.
Page 6
Mais la base de l'erreur n'est
pas entamée, et la substitution de « l'Église » à Israël conduit à
d'innombrables difficultés qu'on est amené à résoudre en spiritualisant une
grande partie de la Parole. Mais de grandes difficultés subsistent. Tant que
les problèmes dogmatiques soulevés par la réaction contre Rome occupent les
réformateurs et leurs successeurs, ces difficultés demeurent à l'arrière-plan ;
mais quand la situation se stabilise, elles surgissent et hantent les
théologiens.
Ainsi la tradition humaine
conduit par exemple à la nécessité d'admettre que le Seigneur et les Apôtres se
sont trompés quand ils parlaient de la venue prochaine du Royaume terrestre. On
est amené aussi à la conclusion que Paul a souvent changé d'idées. La logique
oblige alors à ne plus voir dans la Bible un document inspiré par Dieu, mais un
produit de la pensée humaine qu'on peut donc juger et critiquer. Arrivé là, un
examen « rationnel » semble montrer partout contradictions et erreurs, qui
confirment la non inspiration. Que reste-t-il alors ? Un ancien document,
vénérable, mais non pas divin, et une vague morale « chrétienne ».
Après ce désastre, on tâche de
sauver les apparences, et même de présenter les résultats de cette critique
destructive comme un grand bienfait (1). On dit par exemple qu'il ne faut pas une « religion
d'autorité », et qu'il est donc bon de pouvoir montrer que la Bible n'est pas
une autorité.
1 ) M. A. Westphal dans son «
Introduction » au Dictionnaire Encyclopédique de la Bible pense pouvoir citer
beaucoup de contradictions dans la Bible. Il serait facile de montrer que si
l'on ne commence pas par douter de ce que la Bible dit, si on la prend telle
qu'elle est, ces « contradictions » n'existent pas et qu'il est inutile de
chercher une théorie pour les expliquer. Il dit : « En démêlant ces relations
(c a d les trois documents supposés JE D, P), en les reconstituant, autant que
faire se peut, en faisant saillir la pensée originale de chacune d'elles, en
établissant entre elles une saine chronologie, la critique a libéré la foi
d'objections redoutables et ouvert devant elle des horizons de lumière ». En
réalité aucun résultat positif n'est acquis. On est en plein chaos. Le seul résultat
est que la Bible a perdu toute autorité et est pratiquement abandonnée par la
masse.
Faisons de la recherche, mais
pas de critique. Ne craignons pas l'esclavage théopneustique », car si nous
sommes «esclaves» de Dieu et si la Bible est Sa Parole, nous pouvons donc aussi
être « esclaves » de cette dernière. La « théorie de l'inspiration » est
vérifiée par toute l'Écriture et conduit à une unité absolue et à un résultat
positif.
Page 7
Dieu même aurait amené le monde
à reconnaître qu’il ne faut pas chercher à établir l'autorité extérieure d'un
livre. Il voudrait conduire à une religion intérieure, qui se manifesterait à
la conscience pieuse. La source de la vérité serait dans l'homme, et il
suffirait de lui donner l'occasion de se manifester. Il y aurait bien un
témoignage divin dans la Bible, mais il n'y aurait pire hérésie que de prendre
ce livre comme inspiré intégralement et comme ayant une autorité égale à celle
de Dieu car, dans ce cas, la vérité serait extérieure à nous.
Au lieu de reconnaître que la
tradition humaine nous a égarés, on préfère se persuader que la Bible n'est pas
une autorité qui juge l'homme et ne peut pas être critiquée par lui. On a
raison de ne pas sacrifier la raison, mais on a tort de sacrifier les
Écritures. Car par la raison on peut montrer, et c'est ce que nous aurons
l'occasion de faire à plusieurs reprises dans nos ouvrages, que la source des
difficultés n'est pas dans la Parole de Dieu, mais dans la tradition humaine
qui, après avoir rejeté une partie de ses enseignements, a prétendu interpréter
le reste d'une manière arbitraire. Si les Écritures, prises telles qu'elles
sont, se contredisaient ou étaient dans l'erreur, personne ne demanderait
d'accepter ces contradictions ou ces erreurs parce qu'elles se trouvent dans la
Bible. La vraie question est de savoir si ces contradictions et erreurs s'y
trouvent réellement. Est-il logique de commencer par ne pas accepter certaines
choses (par exemple la restauration d'Israël) et d'accuser d'erreur la Parole
quand on est ainsi conduit à une difficulté ?
D'autre part, comparer
l'autorité de la Bible à celle de l'Église romaine, et nier les deux pour
proposer une « religion de l'esprit » est faire preuve d'une singulière
confusion. Tout ce qu'on objecte à l'autorité d'un livre, on peut l'objecter à
celle de Dieu et du Seigneur. Ne sont-ils pas des autorités ? Et voudrait-on
prétendre qu'il est impossible que Dieu ait donné un livre divin ? Si oui, sur
quelle base ? Sinon, les arguments de principe contre une autorité tombent. Et les
arguments qui découlent d'une fausse tradition n’ont aucune valeur ( 2 ).
(2) Il est pénible de voir
comment certains se basent sur cette « lettre » pour tâcher d'en tirer un
argument contre la « lettre ». Ils citent 2 Cor. 3 : 6 : « Car la lettre tue,
mais l'esprit vivifie. » La « lettre » indique ici, « le ministère de la mort
gravé avec des lettres sur des pierres » (v. 7), c à d l'ancienne alliance qui
présentait à Israël la volonté de Dieu, mais ne donnait pas le moyen d'obéir à
cette volonté. En contraste avec cette « lettre » Paul dit qu'il est le
ministre d'une nouvelle alliance (v. 6). Nous avons montré dans « Le Plan Divin
» et nous y revenons
dans
le présent ouvrage, que la nouvelle alliance demande encore et toujours
l'exécution de la volonté de Dieu, c.-à-d. ce qui avait été écrit par Moïse,
mais en donnant la capacité de l'accomplir c.-à-d. la grâce, l'aide de
l'Esprit. La « lettre ~ seule, sans l'Esprit, ne peut que tuer, ainsi qu'il est
dit en Rom. 7 : 10, Il : ( Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour
moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion me séduisit par le
commandement, et par lui me fit mourir. » Ce n'est en réalité pas la lettre, la
loi qui tue, mais c'est le péché (v. 13). Cette action était nécessaire pour
amener Israël à Christ. Arrivé là, ne devait-il plus observer la « lettre » ?
Bien au contraire, c'est justement alors qu'il pouvait le faire. La "
lettre", reste donc absolument nécessaire pour connaître la volonté de
Dieu (Rom. 2 : 18). De même la « lettre » inspirée, la Parole de Dieu, nous est
nécessaire pour connaître toute la volonté de Dieu. Mais la lettre seule est
morte, elle doit vivre en nous par le Saint-Esprit.
Page 8
Admettons un moment que nous
devions retenir seulement ce que nos « lumières intérieures » nous font
reconnaître comme juste et vrai. Si nous reconnaissons de cette manière que
toute la Bible est la Parole de Dieu, qui peut nous empêcher d'en témoigner ?
Voudrait-on nous imposer d'autorité que la Bible est faillible ?
Examinons de plus près la
confusion de ceux qui ne veulent pas de l'autorité d'un livre. Ce Livre peut
très bien être autorité dans le sens qu'il est la vérité sans l’être dans le
sens qu'il s'impose autoritairement. Même s'il est la vérité, s'il est la Parole
de Dieu, l'appropriation personnelle de cette vérité ne se fait que librement
par le témoignage du Saint-Esprit en nous. Imposer ce Livre est l'erreur
que l'on peut combattre et désigner par une « religion d'autorité ». Dire qu'il
ne peut y avoir qu'une « religion de l'esprit » n'a donc rien à faire avec la
question de savoir si la Bible est entièrement inspirée ou non, si elle est la
vérité ou ne fait que contenir la vérité.
Et qu'on ne dise pas que nous
n'avons pas besoin d'une vérité écrite ! Hommes, il nous a été donné par Dieu
une intelligence et une raison, et le Livre est essentiellement adapté à ces
facultés. C'est par ces dons que nous avons accès à la vérité dans la mesure où
elle nous est accessible dans notre manière d'être actuelle. Nous ne devons pas
nous attendre maintenant à des intuitions et des révélations qui nous
permettraient de nous passer de l'Écriture.
Page 9
Le Saint-Esprit agit en
nous non pas de manière à rendre nos facultés « naturelles » inutiles, mais en
illuminant ce qui est obscurci. Le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains de
la Bible ne se passe pas de ces Écritures et ne nous communique pas la vérité
sans la Parole. Si nous n'acceptons pas ces révélations écrites, nous ne
pouvons avoir qu'une foi vague, car l'objet de cette foi est mal déterminé et
ne résulte que d'impressions diverses : conversations, lectures, prédications,
qui toutes sont fort imparfaites. Une vérité écrite est une base sûre qui donne
du corps à l'objet de notre foi.
La tradition et la critique, se
donnant la main, ont conduit à n'avoir plus rien de concret, et il ne reste que
cette « foi » vague qui peut s'adapter à tout parce qu'elle n'est rien. Quand
on ne distingue pas les âges, les dispensations, les messages, etc., il va de
soi qu'on se trouve devant un mélange d'où ne peut résulter aucune indication
nette. On est conduit alors à ne plus s'attacher à la lettre (3). Mais en
distinguant les choses qui diffèrent, l'objet de notre foi peut se préciser et
notre foi peut alors embrasser beaucoup de choses. Toutes nos facultés
concourent à cette oeuvre, notre intelligence sanctifiée aussi bien que nos
sentiments. Nous sommes loin alors de croire « en bloc » tout ce que la Parole
enseigne, sans nous en approprier le contenu.
Relevons un argument qui a pu
impressionner certaines personnes : nous ne possédons pas le texte original et
les copies présentent certaines différences. À quoi bon prétendre que le texte
original est inspiré, si nous ne le connaissons pas ? La réponse n'est pas
difficile. Supposons qu'un artiste renommé ait produit un chef-d'oeuvre. Par
l'effet du temps et du manque de soins, le tableau s'est crevassé, il s'est
recouvert de taches, et quelques petites parties manquent. Certains ont cru bon
de réparer ces défauts et ont essayé de restaurer le chef-d'oeuvre. Dira-t-on :
« À quoi bon prétendre que
c'est l'oeuvre du maître, puisque nous ne possédons pas le tableau intact ? »
(3) Au contraire, ce qui semble contradiction
quand on part d'un point de vue faux, devient confirmation quand on prend le
point de vue juste. Un examen poussé du texte original montre continuellement
son inspiration au chercheur, car une telle précision dans le choix des mots et
une telle structure de l'ensemble ne se trouve dans aucun document humain.
Page 10
Et qui prétendra que les
imperfections enlèvent toute valeur à cette oeuvre ? N'est-il pas vrai qu'on
reconnaisse d'une part la main du maître et d'autre part les petits défauts ?
Ainsi en est-il des Écritures. Il y a un certain nombre de mots douteux, il y a
quelques expressions incertaines. Mais cela ne touche pas l'ensemble et un
chercheur pourra même arriver à reconstituer l'original. La critique a l'air de
dire que le tableau est tellement détérioré qu'on ne reconnaît plus le sujet,
qu'on peut prendre un objet pour un autre. Or il n'en est rien, l'oeuvre ne
peut jamais nous induire en erreur quand il s'agit de questions importantes.
Même dans les détails, il est bien rare qu'après, un examen comparatif des
manuscrits, on n'arrive pas à la vérité pure.
Mais ici se présente une autre
objection. La masse des croyants ne peut pas examiner les textes. Encore une
fois : à quoi bon alors que l'original soit inspiré ou non ? Nous répondrons en
poursuivant notre comparaison. Le chef-d'oeuvre a été copié par d'autres
artistes. Pour la majorité de ceux qui regardent le tableau, il n'y a pas
grande différence avec l'original car le sujet général est rendu avec
suffisamment de précision. Ce n'est que dans le cas où un examen précis est
nécessaire qu'on devra recourir à l'original. Dans la plupart des cas, il
suffira d'un peu d'exercice et d'attention. Nul besoin d'être expert. N'en
est-il pas de même avec la Parole de Dieu ? Les versions sont satisfaisantes
dans beaucoup de cas, ce n'est que dans les détails qu'il faut préciser et
alors un examen relativement simple, qui peut se faire à l'aide d'une
Concordance et d'un lexique peut être entrepris par tout croyant décidé. On a
trop souvent pris la mauvaise habitude de considérer des recherches de ce genre
comme étant hors de la portée d'un croyant « ordinaire ».
Quant à la question : pourquoi
nous acceptons le canon des Écritures établi qu'il fut par une autorité que
nous ne reconnaissons pas, il est assez élémentaire que si Dieu a voulu nous
donner Sa Parole, Il a pu le faire malgré et contre tout. Nous avons tout ce
qu'il a jugé bon de nous donner. Chaque élément de cette Parole porte
d'ailleurs la marque divine et aucun autre document ne peut s'y comparer.
Page 11
La critique a parfois eu
recours à l'orgueil humain pour s'imposer aux naïfs. On a dit que c'est par
ignorance, par défaut de sens critique, par illuminisme qu'on tient à
l'inspiration verbale, mais qu'une étude sérieuse est suffisante pour montrer
que cette opinion n'est pas tenable. Nous accordons que cela a pu se produire
souvent. Surtout dans les cas où les conceptions traditionnelles concernant
Israël et « l'Église ont embrouillé les pensées et où l'on ne distingue ni âge,
ni dispensation. Alors une étude plus sérieuse a semblé montrer les
contradictions apparentes et a pu faire conclure faussement à la faillibilité
de la Parole. Mais qu'on ne dise pas que c'est là un conséquence nécessaire
d'un examen sérieux. Car nous aussi connaissons les documents des premiers
siècles, nous aussi avons suivi le développement de « l'Église », nous aussi
savons comment est née la critique par Luther, Spinoza, Grotius, les
philosophes allemands et tant d'autres. Nous avons suivi avec douleur les
progrès de ce chancre chez Bayle, Leclerc, etc., même dans l'école de Saumur.
Nous connaissons la réaction du Réveil et nous pouvions prévoir qu'elle ne
durerait pas, car tant que les idées traditionnelles directrices demeuraient,
on ne pouvait sortir des conséquences logiques du système. L'expérience
douloureuse d'un Scherer en est témoin. Nous aussi nous avons vu le
développement à outrance de la critique chez de Wette, Baur, Wellhausen, pour
ne pas parler des plus modernes. Nous connaissons toutes ces théories qui
furent répandues comme des conclusions infaillibles de la critique et que les
faits, une plus grande connaissance des langues anciennes, les fouilles dans
les pays bibliques, etc., ont nettement démenti ( 4).
4 On ne compte plus les théories audacieusement imposées par la critique
comme des faits certains, et qui ont été démentis radicalement par la recherche
archéologique et l'étude documentaire. Nous ne mentionnons ici que quelques cas
typiques :
1. On a prétendu que les cinq
premiers livres de la Bible ne pouvaient pas avoir été écrits par Moïse, parce
que de son temps la civilisation ne pouvait pas encore avoir atteint le
développement que montrent ces livres, et qu'en particulier il ne pouvait
exister alors une législation aussi raffinée. Or les résultats des recherches
démontrent, de plus en plus, que la civilisation est très ancienne. Les
tombeaux d'Ur sont estimés être de 1.500 ans plus anciens qu'Abraham et
révèlent une civilisation extraordinaire. Le code d'Hammurabi a montré en particulier
que des législations très développées existaient longtemps avant Abraham.
D'après un expert contemporain,
M. C.-L. Woolley, qui dirige l'expédition du British Muséum et de l'University
Muséum de Philadelphie, Abraham a vécu dans des conditions de vie domestique et
nationale fort compliquée, qui ont étonné tous les chercheurs. Il dit aussi : «
Les fouilles n'éclairent pas toujours la Bible, mais nous avons au contraire-
recours à la Bible pour expliquer les faits donnés par elles. » La Parole de Dieu
se manifeste donc aussi comme une « autorité » dans ce domaine.
2. Le Prof. Garstang qui a
montré que la pioche confirme ce que la Bible dit de la prise de Jéricho, a
écrit ceci : La présentation historique de l'établissement d'Israël en Canaan,
tel qu'elle est donnée par les livres de Josué et des Juges, rue semble, après
dix ans d'investigations sur place, au cours desquels j'ai examiné tout site et
toute route qui s'y rapportent, être à l'abri de toute objection archéologique
ou topographique importante. D'autre part, les dates plus récentes proposées
par des théoriciens modernes conduisent immédiatement à des difficultés
archéologiques et déforment la narration. L' « onus probandi » reste sûrement
chez ceux qui rejettent la tradition biblique. » Son expédition de 1932 a
confirmé l'histoire de l'Exode d'Égypte.
3.
Une étude minutieuse des documents écrits dans les langues sémitiques et autres
a permis au Prof. R. D. Wilson (Princeton Theological Seminary) de montrer :
qu'il n'y a aucune raison pour ne pas croire que le Pentateuque serait de Moïse
et que David aurait écrit beaucoup de Psaumes, et que les langues et l'histoire
confirment que tous les livres de l'A. T., excepté quelques-uns, ont été écrits
plus tôt que 500 ans avant Jésus-Christ.
Parmi beaucoup d'études, qui
montrent que la critique résulte souvent de l'ignorance, nous donnons l'extrait
suivant :
" La critique assure
qu'Esdras, Néhémie et les Chroniques dans leur forme actuelle ont été
rassemblés par le même rédacteur et que celui-ci a dû vivre pendant la période
grecque parce qu'il désigne les rois de Perse par l'expression « Rois de Perse
». L'éminent critique allemand Ewald a dit : « Il est inutile et en
contradiction avec les habitudes de ce temps, de désigner les rois de Perse par
le titre , Rois de Perse... ». Or j'ai montré par une conclusion déduite d'un
examen de tous les titres des rois d'Égypte, de Babylone, d'Assyrie, de la
Grèce et de tous les autres peuples de cette partie du monde, y compris les
Israélites, depuis 4.000 ans avant Christ jusqu'au temps d'Auguste, que de tout
temps, dans toutes les langues et dans tous les royaumes des titres comme celui
ci-dessus ont été utilisés (Voir : The Princeton Theological Review de
1905 et 6). L'auteur a montré en plus que le titre " Roi des Perses "
a été donné par Nabonide, roi de Babylone, à Cyrus en l'an 546 avant
Jésus-Christ, sept ans avant le premier usage de ce titre dans la Bible et
qu'il était utilisé par Xénophon en 365 avant Christ, probablement quarante ans
après avoir été utilisé pour la dernière fois dans la Bible. Il a montré
qu'entre les années 646 et 365, le titre fut utilisé 38 fois en divers temps
par 18 auteurs différant en 19 documents, 6 langues et 5 ou 6 pays. Il a
enfin montré que les auteurs grecs postérieurs à la période perse n'étaient pas
habitués à utiliser ce titre (Voir : Festschrift, Éd. Sachan, Berlin,
1911). »
" La Bible a donc raison ;
et il est démontré que le Prof. Ewald de Göttingen, de son temps l'allemand le plus
savant pour ce qui concerne l'A. T. et les Prof. Driver et Gray d'Oxford ont
tort. Tous auraient pu prendre connaissance de l'évidence donnée par Hérodote,
Thucydide, Eschyle, Xénophon et autres. Après un examen minutieux de ce que ces
savants ont écrit à propos de ce titre, je n'ai pu trouver aucune indication
qui montre qu'ils se soient jamais adressés pour leurs renseignements à une
source quelconque hors du grec, de l'hébreu et de l'araméen. Et pour ce qui
concerne ces sources, ils n'ont pas prêté attention aux grands auteurs grecs
nommés ci-dessus. S'ils sont si négligents et si peu dignes de confiance là où
leurs affirmations peuvent être contrôlées, quelle raison y aurait-il alors
pour attendre de nous que nous les croyions quand leurs affirmations ne peuvent
pas l'être ? »
Voilà quelques exemples qui
montrent que la critique moderne et soi-disant scientifique, ne s'appuie pas
sur des faits, mais sur l'ignorance. Les faits ont toujours confirmé la Parole
de Dieu. Jamais un fait n'en a prouvé l'erreur.
Page 12
L'homme érudit et savant a
donné la mesure de son ignorance et de son orgueil quand il s'est attaqué à ce
qui est divin. Ce n'est donc pas par ignorance que nous croyons à l'inspiration
des Écritures.
Page 13
Au contraire, en voyant
l'impuissance de la critique moderne
nous avons une Preuve nouvelle
de son erreur ( 5 ) et de l'inspiration de la Parole qui reste au-dessus
de toutes les attaques. Si l'on ne part pas d'un point de vue faux, un examen «
scientifique » doit conduire à la conclusion que le Livre n'est pas humain. La
foi et le Saint-esprit nous en donnent la certitude.
Nos publications ont pour but
principal d'amener ceux qui ont soif de vérité à réexaminer les choses. Nous
sommes loin d'imposer nos idées ; nous ne sommes pas une « autorité ». Mais
nous voyons une solution, alors que presque tout mène au néant (6 ).
5 (5) On a souvent parlé des , résultats acquis » de la critique or, tout
est chaos dans cette critique. Les théories de Baur et de l'école de Tübingen
ont en grande partie été abandonnés. Les théories de Wellhausen sont aussi
fortement discréditées. Quand on examine l'évolution des nombreuses théories
concernant les soi-disant « sources » de l'A. T. et le désaccord permanent
entre les grands théologiens, on est édifié sur ce que veut dire : « résultats
acquis ». Il est trop visible que, dans beaucoup de cas, le point de départ de
la critique est que l'on n'accepte pas d'intervention divine. Tout ce qui n'est
pas « naturel » est a priori écarté, comme étant impossible !
6 (6) Il est probable que certains nous répéteront ce qu'on a dit de tout
temps à ceux qui désirent un retour à la vérité et que nous rendrons par les
mots de Calvin : « Ils enquièrent si c'est raison qu'elle (la doctrine de
Calvin) surmonte le consentement de tant de Pères anciens, et si longue
coustume. Ils insistent, que nous la confessions estre schismatique,
puisqu'elle fait la guerre à l'Église : ou que nous respondions, que l'Église a
esté morte par tant longues années, ausquelles il n'en, estoit nulle mention. »
Et plus loin : " Toutesfois ce n'est pas nouvel exemple. On demandoit à
Hélie s'il n'estoit pas celuy qui troubloit Israël (1 Rois 18, 17). Christ
estoit estimé seditieux ,des Juifs (Luc 23, 5). On accusoit les Apostres, comme
s'ils eussent esmeu le populaire à tumulte (Actes 24, 5). » Il se réfère
ensuite à la réponse d'Élie en 1 Rois 18 : 18.
Page 14
Nous proposerons aux croyants
sérieux de faire un effort personnel et de considérer notre travail comme indiquant
quelques jalons le long de la route solitaire qu'ils auront à parcourir.
Dans l'Introduction de notre
ouvrage Le Plan Divin, nous avons déjà exprimé l'opinion qu'il ne faut
jamais craindre d'être trop intellectuel, pourvu qu'il y ait l'équilibre voulu
et qu'on soit spirituel au même degré. Dans le présent ouvrage aussi nous nous
adressons en grande partie à l'intelligence de nos lecteurs, parce que nous ne
concevons pas comment on pourrait autrement exposer ces matières. Nous n'avons
fait que suivre l'exemple de Paul. Nous aurions pu nous attacher davantage à
exhorter le lecteur à prendre à coeur ces messages. Si nous ne l'avons pas
fait, cela ne signifie pas que nous ne le trouvons pas nécessaire. Mais nous
croyons que si le lecteur se rend compte de la profondeur croissante de ces
messages, il sera amené à lire et relire les
Epitres elles-mêmes et, exhorté
par elles d'une manière bien plus efficace que nous ne pourrions le faire. Ces
exhortations prennent toute leur vigueur pour celui qui sait qu'elles sont
d'inspiration divine et
qu'elles s'adressent directement à lui. Or, notre effort a pour but, d'abord de
mieux faire apprécier toute la Parole en supprimant des obstacles qui
pourraient faire douter de son inspiration, et ensuite de rendre chaque message
plus saisissant en le réservant à ceux auxquels il s'adresse. Trop souvent, la
Bible ne semble qu'un chaos plein d'exhortations contradictoires. Par le
mélange, l'effet des parties différentes se neutralise. On ne comprend plus et
on délaisse la Parole. La tradition et les habitudes « religieuses » prennent
alors la place que l'Écriture devrait occuper. Celui qui est membre d'une «
Église » se croit souvent régénéré de ce fait ; pour lui, plus besoin de
repentir. Il croit ne plus être pécheur et pense être sauvé par une foi bien
souvent superficielle.
Nous mettons le lecteur devant
les faits et l'aidons à examiner par lui-même. Nous espérons qu'ainsi le non
régénéré reconnaîtra son état et que sa connaissance intellectuelle le conduira
à prendre au sérieux les exhortations divines adressées aux non régénérés.
Page 15
De même, celui qui n'est pas
encore mort au péché pourra apprendre à s'humilier, à se repentir, à mourir. Et
ainsi, même dans la position la plus avancée sur la voie du salut, le croyant
pourra nettement distinguer la volonté spéciale de Dieu envers lui et accepter
le message particulier qui s'adapte à son cas.
Nous mettons le lecteur en
garde d'une manière toute spéciale contre une fausse impression qui pourrait
résulter d'une lecture superficielle. Nous ne disons pas qu'une partie de la
Bible ne serait pas nécessaire. (Voir à ce sujet aussi p. 32). Tout est utile.
Partout nous trouvons des enseignements nécessaires, des exemples utiles, des
exhortations salutaires. Si nous divisons la Parole, ce n'est pas pour rejeter
certaines choses, mais pour mieux les appliquer, en les plaçant sur leur vrai
plan.
La principale réserve que nous
faisons, c'est que les choses extérieures dépendent souvent des conditions
extérieures et que ces choses doivent rester réservées à ces conditions. À
telle époque, Dieu peut interdire de manger de la viande, à tel peuple Il peut
ordonner des sacrifices, à tel groupe Il peut imposer tel rite. Tout cela est
utile à tous les points de vue, mais tout n'est pas imposé à tous.
Nous faisons une deuxième
restriction. C'est que, pour chaque groupe d'hommes : incroyant, régénéré, «
fils » de Dieu, homme fait, il y a un message particulier. Ce qui est adressé à
l'incroyant ne s'adresse plus au régénéré, etc. Toute l'Écriture reste
cependant utile à tous.
Dans La Voie du Salut, qui
est en préparation, nous traitons de ce qui concerne chaque homme
personnellement. Le Plan Divin et le présent ouvrage ne sont que la
préparation ; l'essentiel pour tout homme est de voir quelle place il occupe
dans la création et comment il peut, en glorifiant Dieu, arriver au but
glorieux qui lui a été assigné.
Nous remercions Mlle J. B., MM.
E. C., H. B., G. G., et d'autres encore pour la révision et la correction du
texte, ainsi que pour leurs suggestions.
Versailles, 1935.
Résumé de notre ouvrage « Le
Plan Divin »
Page 16
Nous croyons utile de présenter
avant tout un résumé de notre ouvrage Le Plan Divin, qui donne un aperçu
général des âges et du rôle du peuple d'Israël.
La Parole de Dieu, acceptée
simplement, comme elle nous est donnée, forme une unité sans contradictions et
nous fait connaître le Plan divin.
Avant toute création, Dieu est.
L'Image de Dieu, nommée aussi « Fils de Dieu », devint créature pour créer.
Le Fils de Dieu est le Médiateur en tout : création, rédemption, perfection.
La création est bonne, mais non
parfaite (puisqu'elle n'est pas Dieu). Dieu veut l'amener à la perfection par
la voie de la liberté. La créature est donc libre et peut faire de sa liberté
un usage bon ou mauvais, suivant qu'elle fait ou ne fait pas la volonté de
Dieu.
La création comprend cinq éons
(âges). Les conditions d'existence, les lois, diffèrent complètement d'un éon à
l'autre, mais il y a une certaine correspondance entre le premier éon et le
cinquième, ainsi qu'entre le deuxième et le quatrième.
Premier éon. - Dieu a, par le moyen de Son Fils, créé librement
des êtres libres et a montré ainsi Sa perfection, Certains êtres s'écartent de
Dieu, tombent ainsi dans le péché et s'élèvent même contre Dieu. Satan
(I'Adversaire), un chérubin tombé par orgueil, joue le rôle principal dans
cette révolte insensée. Une partie de la création est précipitée dans le chaos.
Mais Dieu veut que la créature
parvienne à sa destinée.
Deuxième éon. - Après le chaos, vient la reconstruction en six
jours. Adam est créé à l'Image de Dieu et ressemble donc au Fils devenu
créature.
Il reçoit les grâces
nécessaires pour soumettre la mer, le ciel et la terre, pour être roi. Mais,
avant tout, il doit lui-même occuper librement sa position en faisant la
volonté de Dieu.
Page 17
Il manque ce but à cause de la
séduction de Satan, qui veut empêcher la réalisation sur terre du Royaume
(Royaume céleste cependant, parce qu'institué par le Ciel).
Adam est ainsi privé de la
gloire de Dieu, il est séparé de la source de Vie (mort spirituelle). Il n'a
plus qu'un reste de vie corporelle : il est « mourant », et ainsi le seront
tous ceux qui proviennent de lui.
La terre est maudite. L'homme
n'est pas seulement devenu ennemi de Dieu, mais aussi ennemi de la création.
Les anges déchus (et leur
progéniture) souillent la terre. Le déluge enlève cette corruption et laisse
Noé et les siens.
Troisième éon. - C'est dans cet « âge » que nous vivons. Il diffère
aussi dans les conditions physiques, de l'éon précédent. Cet âge est appelé : «
Le mauvais âge présent », et Satan en est le dieu.
Dieu veut réaliser Son plan. Il
livre la terre et la mer entre les mains de Noé, puis choisit Sem, Abraham,
Isaac, Jacob pour servir d'instruments à la restauration et amener le Royaume.
Satan réagit constamment.
Abraham reçoit la promesse de
bénédictions terrestres et célestes : il aura deux postérités.
Dieu choisit, parmi les nations,
un peuple : Israël, (lui devra spécialement servir à apporter la régénération
du monde, mais qui doit d'abord lui-même être régénéré, c'est-à-dire entrer en
communion spirituelle avec Dieu.
Pour que ce peuple se rende
compte de son péché, se tourne librement vers Dieu et soit régénéré par Lui,
Dieu lui indique ce qu'Il désire : Il lui donne la Loi. Cette Loi a pour base
Sa volonté générale envers toute créature, mais sa forme spéciale n'en est
applicable qu'à Israël, particulièrement en ce qui concerne les cérémonies. Par
l'Ancienne Alliance Dieu demande que la Loi soit exécutée intégralement. Israël
aurait dû se rendre compte qu'il ne savait pas exécuter ce que cette Alliance
demandait et aurait dû avoir recours à la grâce divine. Le peuple élu manque son
but en prétendant faire par ses propres forces ce que Dieu désire.
Page 18
Toute l'histoire d'Israël
prouve la patience de Dieu, qui veut amener Son peuple, par la voie de la
liberté, à se détourner de Satan et à se repentir.
L'Adversaire intervient à tout
moment dans le but d'empêcher la venue du Royaume et de la régénération
mondiale.
Dieu a donc suscité un peuple,
un pays (Canaan), une cité (Jérusalem). Pour que le Royaume vienne, il ne
manque que la repentance d'Israël. Les prophètes rappellent les promesses
divines et font entrevoir les bénédictions qui seront le partage de la terre
quand le Messie sera Roi.
Enfin, le Fils même, devenu
semblable aux hommes, vient sur terre, s'humilie et est obéissant jusqu'à la
mort sur la croix. Il résout le problème impossible à résoudre : concilier
l'amour et la justice de Dieu, permettre à la créature pécheresse et incapable
de faire le bien, de retourner vers Dieu. Il rend possible le pardon, la
justification, la réconciliation et la sanctification du pécheur. Il ne fonde
pas une nouvelle religion, mais Il exécute le Plan divin.
Jésus-Christ s'adresse au
peuple choisi, montre par ses actes qu'Il est son Roi et demande sa repentance
pour que le Royaume vienne sur terre. Les miracles et les signes confirment que
ce Royaume est proche. Il choisit douze Apôtres (les Apôtres de la
circoncision), qui seront assis sur douze trônes pour guider les douze tribus
d'Israël dans ce Royaume. Les vrais israélites formeront une Église visible.
Le Christ instaure la Nouvelle
Alliance avec Israël, dont parlaient les prophètes, et selon laquelle la Loi,
c'est-à-dire la volonté divine à leur égard, pourra être accomplie par la
grâce.
Par leur repentance, les hommes
peuvent obtenir le pardon des péchés et, par leur foi en Jésus-Christ, la vie
éonienne (éternelle), c'est-à-dire la vie sur terre pendant l'éon à venir.
Certains se tournent vers Lui,
mais le peuple, comme tel, le rejette et le fait crucifier. Tout semble perdu,
et pourtant la croix est le seul moyen pour arriver à la restauration et au but
final : Dieu tout en tous.
Par la résurrection d'entre les
morts, Jésus-Christ a été déclaré avec puissance être le Fils de Dieu. La grâce
abonde maintenant. Dieu a condamné et réconcilié le monde en Lui.
Après la croix, Israël n'est
pas rejeté. Les douze Apôtres insistent de nouveau sur la repentance et sur la
venue du Royaume.
Page 19
Ce Royaume par lequel
commencerait l'éon prochain, caractérisé par la régénération du monde, est
toujours « proche », les signes extérieurs : miracles, guérisons, intervention
des anges, etc., le prouvent.
La Loi et les cérémonies sont
scrupuleusement observées par les Juifs, même par ceux qui croient en Christ.
(Les Juifs ne cessent pas en effet d'être juifs quand ils croient en Christ,
mais peuvent alors l'être vraiment et accomplir la Loi par la grâce.)
À la Pentecôte, les anciennes
promesses faites à Israël commencent à se réaliser. Dix ans après seulement la
parole divine commence à être adressée aux Gentils, qui ont part aux
bénédictions d'Israël conformément aux prophéties.
Entre temps, Paul, non compris
parmi les Douze, se convertit. Il est l'apôtre des Gentils, et commence à
proclamer un nouveau message : la justification par la foi. Cette bonne
nouvelle dépasse celle (la régénération) des douze Apôtres de la circoncision
et vise déjà les conditions du cinquième éon. La proclamation, en quelque sorte
anticipée, a comme but partiel d'exciter Israël par la jalousie à accepter ses
privilèges.
Les Juifs rejettent leur Messie
successivement dans les grands centres et, au fur et à mesure, le message de
Paul prend plus d'importance. Le dernier effort auprès du peuple élu est fait
par Paul à Rome (Actes 28) ; mais là encore ce peuple ne veut pas entendre.
Israël est rejeté provisoirement, et toute possibilité d'une venue prochaine du
Royaume disparaît. En même temps, tous les signes extérieurs (y compris les
dons spirituels spéciaux visibles) annonçant le Royaume, cessent. Tout ce qui a
rapport à Israël, tel que l'observance de la Loi et les cérémonies religieuses
visibles, prend fin. Il y a là un changement radical de dispensation duquel il
est extrêmement important de tenir compte quand on lit ce qui est écrit avant
cette date : par exemple les Évangiles, les Actes, les Épîtres aux Romains, aux
Corinthiens, aux Galates et aux Thessaloniciens. La partie personnelle de ces
messages demeure, mais tout ce qui a rapport à la dispensation passe, cesse
d'être applicable. Les charismes pentecôtistes en particulier ne se rapportent
pas à nous.
Est-ce la faillite du Plan
divin ? Non, Paul, emprisonné, proclame maintenant un nouveau message, inconnu
de tout temps, à lui seulement révélé, et concernant le grand mystère : le
Corps de Christ.
Page 20
En esprit, on peut déjà
atteindre la position parfaite correspondant au but du Plan divin : Dieu tout
en tous. La voie du salut est donc entièrement connue : l'homme naturel doit
devenir enfant de Dieu (nouvelle naissance), puis « fils » de Dieu (nouvelle
création-justification) et enfin devenir homme parfait. La dispensation
actuelle est donc celle de l'Église du mystère. Elle commence après le temps
des Actes et prend fin avant le « jour du Seigneur » qui termine l'éon présent.
Pendant toute cette période, il y a interruption dans la réalisation des
prophéties, notre dispensation étant complètement inconnue des prophètes.
Les membres de l'Église du
mystère ressuscitent en premier lieu.
Israël passe par la grande
tribulation, se repent, et le Seigneur vient en gloire. C'est le moment de la
transformation des croyants vivants et de la résurrection des morts.
Tous les royaumes du monde sont
remis à Christ
Il est le Roi de toute la
terre. Satan est lié pour 1.000 ans.
Quatrième éon. - Le Fils de l'homme est assis sur le trône de Sa gloire,
et les 12 Apôtres sont assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël.
C'est le « renouvellement » (la régénération), le temps du rétablissement de
toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de Ses saints
prophètes. Israël occupe la terre promise, du Nil jusqu'à l'Euphrate, et toutes
les nations sont bénies en Abraham. Les juifs chrétiens forment l'Église de
Christ sur terre, une unité visible. La création est affranchie de la servitude
de la corruption. La terre produit normalement ; la nature des animaux est
changée, la durée de la vie décuplée. C'est une ère de justice et de paix,
Satan étant lié. Le temple de Jérusalem est le centre du culte d'Israël, qui
observe fidèlement la Loi par la grâce. La Nouvelle Alliance avec ce peuple est
accomplie et les conduit vers la sphère céleste.
La postérité céleste d'Abraham
se manifeste par des miracles et des actes puissants.
Après les 1.000 ans, Satan est
relâché pour un peu de temps. Il séduit les nations et est jeté dans l'étang de
feu et de soufre.
Page 21
Ceux qui n'ont pas eu part aux
résurrections passées paraissent devant le grand trône blanc pour être jugés.
Ils subissent le châtiment qu'ils méritent.
La durée de cet éon semble
devoir dépasser de beaucoup les 1.000 ans. La terre entière est amenée à
prendre part à la régénération. Tous les ennemis sont finalement mis sous les
pieds du Fils.
En résumé on voit sur terre
Israël et les nations régénérées !(les enfants de Dieu), dans le ciel les
justifiés (les fils de Dieu) et dans les sur cieux ceux qui sont arrivés à la
mesure de la stature parfaite de Christ et qui montrent l'infinie richesse de
la grâce de Dieu.
Le Christ a régné comme Roi
pendant cet éon et remet maintenant le Royaume au Père pour régner avec Lui.
Cinquième éon. - C'est celui de la nouvelle création. Toutes les
conditions sont de nouveau changées radicalement, y compris les lois physiques.
C'est le « jour de Dieu ». Tout ce qui est relatif à Adam, à l'ancienne
humanité est maintenant passé et englouti par la nouvelle humanité. Toute la
création est dans la sphère céleste, à part ceux qui se trouvent déjà pour
ainsi dire hors de la création, dans la sphère sur céleste.
La nouvelle Jérusalem descend
du ciel. Les mots manquent pour décrire la gloire de cet âge. On peut cependant
dire qu'il n'y a pas de mer, pas de souffrances, pas de jour et de nuit, pas de
mort, pas de temple, pas d'anathème, pas de péché. Dieu habite avec les hommes.
Christ règne avec le Père.
La création est amenée à l'état
où elle se trouvait au premier éon, mais avec cette différence, qu'elle a
appris, grâce à l'amour infini de Dieu et au sacrifice de Son Fils, à faire bon
usage de sa liberté. Elle peut ainsi atteindre la perfection.
Dieu tout en tous. - Dieu a atteint Son but et a fait pour cela
l'impossible Il a augmenté Sa gloire en créant et en rendant parfaite Sa
créature. Il est tout en tous et il n'y a donc plus de Médiateur, plus de Roi,
plus de Prêtre. Le Fils a achevé Son oeuvre et possède la gloire qu'Il avait
avant Son humiliation.
La créature, par sa communion
avec le Fils, est élevée avec Lui.
Page 22
Elle atteint l'amour parfait,
la liberté absolue en acceptant librement la volonté de Dieu et forme ainsi une
unité glorieuse.
Nous reproduisons aussi le
schéma du Plan Divin, qui donne en quelques traits un aperçu général des éons.
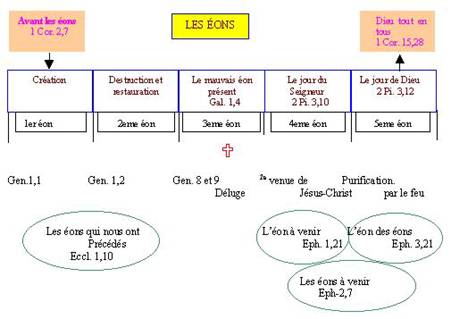
PREMIÈRE PARTIE
1.
- Qui est Paul ?
Page 23
Dans Le Plan Divin, nous
avons montré que Paul n'est pas l'un des Douze Apôtres. Certains pourraient en
conclure qu'il n'est donc pas apôtre. Mais cette remarque a déjà trouvé sa
réfutation et Paul lui-même a dit : « Ne suis-je pas apôtre ? » (1 Cor. 9 : 1).
On l'attaquait de toutes parts et sans doute a-t-on invoqué contre lui le fait
qu'il n'avait pas accompagné le Seigneur pendant sa vie terrestre et ne
satisfaisait donc pas aux conditions requises pour faire partie des Douze
(Actes 1 : 21, 22). Il reconnaît une différence entre eux et lui (1 Cor. 15 :
5-8), mais il maintient pourtant qu'il est apôtre, il prétend même avoir reçu
son apostolat directement du Seigneur Jésus-Christ (Rom. 1 : 5), et être
prédicateur et apôtre (1 Tim. 2 : 7). C'est principalement dans l'Épître aux
Galates qu'il insiste sur son titre : « Paul, apôtre, non de la part des
hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. » On s'était
rendu compte que son message aux Gentils n'était pas le même que celui des
Douze et c'était une raison de plus pour mettre son autorité en doute. Il
reconnaît avoir un autre message, mais cet Évangile « n'est pas de l'homme » et
il ne l'a reçu ni appris d'un homme, mais par une, révélation de Jésus-Christ (1). Il n'a
consulté « ni la chair, ni le sang » et ne monta point à Jérusalem vers ceux
qui furent apôtres avant lui. Trois ans après seulement il fait la connaissance
de Pierre. Quatorze ans après il expose aux Apôtres l'Évangile qu'il prêche aux
Gentils et Jacques, Pierre et Jean (apôtres de la circoncision) ayant reconnu
la grâce qui lui avait été accordée donnent à Paul et Barnabas (apôtres des
Gentils) la « main d'association ».
1 (1) Gal, 1 : 12. Il est bon de remarquer que le mot « apokalupsis »,
traduit par « révélation » indique toujours une communication venant
directement de Dieu.
Page 24
On doit se rendre compte qu'il
est donc absolument nécessaire de distinguer
1° Entre les douze apôtres de
la circoncision, choisis par le Seigneur avant son ascension et les apôtres de
l'incirconcision choisis après son ascension (2) ;
2° Entre le message spécial des
Douze, qui se rapportait au séjour du Seigneur sur terre et au Royaume
terrestre et le message spécial de Paul pendant les Actes, qui se rapporte à
des choses célestes et à la nouvelle création et où il ne connaît plus Christ
selon la chair (2 Cor.5 :16).
Ces distinctions n'empêchent
nullement d'une part Pierre de s'adresser aussi occasionnellement aux Gentils
(au sujet de leurs bénédictions dans le Royaume terrestre) et d'autre part Paul
de s'adresser aux Juifs. Nous verrons que le message caractéristique de Paul
dépasse celui des Douze. Paul peut à l'occasion parler du Royaume terrestre,
mais inversement les Douze ne parlent pas de ce qui est au-dessus de leur
sphère.
2 (2) Eph. 4 : 10 parle de Son ascension et Eph. 4 : 11 des apôtres
appelés après cet événement.
La version Darby rend souvent
le texte inspiré avec plus de fidélité que d'autres versions. Nous y trouvons
par exemple : « À moi, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien
communiqué de plus ; mais au contraire, ayant vu que l'évangile de
l'incirconcision m'a été confié, comme celui de la circoncision l'a été à
Pierre... » (Gal. 2 : 6, 7). La Parole parle en effet de plusieurs « évangiles
» c'est-à-dire de plusieurs Bonnes Nouvelles. Mais, objectera-t-on, Paul
lui-même affirme qu'il n'y a pas « un autre Évangile » (Gal. 1 : 7). Ici encore
la version Darby pourra nous aider il faut distinguer entre « autre » et «
différent » ( 1a ). Toutes les Bonnes Nouvelles qui sont d'inspiration
divine sont de la même espèce, donc pas « différentes », mais par contre
l'évangile auquel passaient les Galates était de provenance humaine ou
démoniaque, donc « différent ».
1a (1a) Grec : alles et heteros. Voir Appendice 1.
Page 25
La grâce de Dieu est telle qu'il
peut y avoir beaucoup de Bonnes Nouvelles, beaucoup d'évangiles, mais leur
ensemble forme une unité homogène, qui renferme Son dessein. En particulier, il
y a une Bonne Nouvelle spécialement pour les Juifs et une autre (mais de même
espèce divine) concernant les incirconcis. Ce dernier évangile a aussi été
appelé par Paul «mon évangile » pendant les Actes. Après cette période, il a
d'autres Bonnes Nouvelles qui complètent la grâce (2).
2 (2) Tous ceux qui ont étudié avec attention les épîtres de Paul se sont
rendu compte qu'elles comportaient des différences frappantes. On a essayé de
les expliquer sans y parvenir et quand l'incrédulité moderne a commencé à
critiquer les Écritures et à nier leur inspiration littérale, on a cru trouver
là des arguments décisifs. On a appelé ces différences de Paul « un progrès
constant de ses conceptions chrétiennes ». On parle de " formes
élémentaires » de la « connaissance humaine ». S'il était vrai qu'en « aucun
moment, ses conceptions ne lui ont paru parfaites ni définitives » on se
demande quelle valeur il faudrait attacher à ses écrits. On nous dit aussi que
par un nouveau « progrès » la pensée de Paul achève de « se débarrasser des
liens de l'eschatologie juive ». Il nous semble que les chrétiens qui croient à
l'inspiration littérale et à l'autorité des Écritures portent une lourde
responsabilité dans ces choses. Il ne suffit pas de passer sur ces problèmes
d'une manière superficielle. Ceci est déjà inconséquent, car si le texte est
inspiré, tout doit être pris très au sérieux et être soumis à un examen
spirituel profond. Mais la négligence de tels problèmes a singulièrement
contribué à répandre les enseignements destructifs et a donné l'impression
qu'on ne peut pas expliquer ces variations de Paul. Le lecteur verra que, pour
nous, la solution est simple. Nous acceptons la Parole telle qu'elle est, nous
l'examinons au microscope, mais nous l'embrassons aussi dans son ensemble.
Cette attitude ne nous donne pas seulement une réponse nette, mais montre que
la question était mal posée et qu'en fait, il n'existe aucune difficulté. De
pareilles difficultés apparentes proviennent du fait qu'on s'est écarté de
l'enseignement des Écritures et au lieu de s'éterniser à discuter une question
insoluble, il est bien plus simple de rechercher en quel endroit on s'est
écarté de la vérité.
Dans le cas présent, il faut
avant tout se rendre compte de la mission d'Israël comme nation. Il ne faut pas
s'imaginer qu'une « religion chrétienne », fondée par « Jésus » aurait remplacé
la « religion juive ». (Voir à ce sujet Le Plan Divin.) il faut aussi se
rendre compte qu'il y a une voie du salut comprenant plusieurs étapes,
plusieurs sphères. Paul parcourt ces sphères et proclame les Bonnes Nouvelles
correspondantes. Ce ne sont pas ses conceptions qui progressent dans le sens
qu'elles seraient au début plus loin de la vérité qu'à la fin. Ce qu'il dit est
toujours absolument juste et reste juste pour la sphère dont il parle. S'il y a
une différence entre ses messages, c'est qu'il y a une différence entre les
étapes successives dans la voie du salut. Il y a progression dans ce qui est
révélé (Jean 16 : 12-14 Eph. 3 : 5 etc.).
Quant à " l'eschatologie
juive », s'il y a un changement, ce n'est pas parce que Paul s'est trompé (ni
parce que les prophètes et le Seigneur même se seraient trompé !). Le Christ
viendra un jour sur terre pour établir son Royaume. Ce qu'il y eût de changé
après les Actes, c'est que par la rejection d'Israël ce Royaume n'était plus «
proche ». Dans les épîtres qui suivent cette période, Paul n'attend donc plus
la venue imminente de ce Royaume et de tout ce qui l'accompagne.
Page 26
3.
- Le Message du Royaume et de la Nouvelle Naissance.
L'évangile de la circoncision
est aussi celui du Royaume. Il est mentionné trois fois (1). Nous avons vu
dans Le Plan Divin que cet évangile annonçait à Israël que le Royaume
sur terre, faisant l'objet de tant de prophéties, était proche. Il ne fallait plus
que la repentance de ce peuple rebelle. Après Jean-Baptiste, le Roi Lui-même
était venu annoncer cette bonne nouvelle : « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » (Luc. 4 : 18, 19).
Après avoir cité ces paroles
d’Esaïe. Il ferma le livre et dit : « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture
est accomplie. » Il s'arrêta au milieu d'une phrase d'Ésaïe parce que le reste
ne s'accomplirait que beaucoup plus tard, juste avant la venue du Royaume.
Le sommaire de ce message, qui
devait contribuer à les amener à la repentance et à la nouvelle naissance,
était que ce « Jésus » méprisé était le « Christ » c'est-à-dire
l'Oint, le Messie, le Fils de
Dieu (2 ).
Or nous voyons que Paul
proclame cette nouvelle dès sa conversion. Après quelques jours « il prêcha
dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu » et après il « se fortifiait
de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant
que Jésus est le Christ (Actes 9 : 20-22).
1 (1) Mat. 4 : 23 ; 9 : 35 ; 24 : 14.
2 (2) Nous rappelons que ce message ne s'adressait qu'aux Juifs. Les
Gentils seraient bénis par le moyen du peuple élu ; il fallait donc que ce
peuple se repentît et prît la place que Dieu avait prévue pour lui, dans Son
dessein. Voir Le Plan Divin. L'évangile du royaume ne dit rien de la
croix. Quand le Seigneur parle de Sa mort aux disciples (Mat. 16 : 21), ils ne
le comprennent pas et Le reprennent !
Page 27
À Antioche il enseigna avec Barnabas
beaucoup de personnes (Actes 11 : 26). Il est bon de se souvenir qu'il s'agit
ici d'assemblées de Juifs-chrétiens. Les premiers Gentils venaient à peine de
recevoir la Parole de Dieu (3). Ces Juifs croyant au Messie étaient appelés des
« chrétiens » (4).
Envoyés par le Saint-Esprit à
Salamine, Barnabas et Paul (qui s'appelle encore Saul) annoncent la Parole de
Dieu dans les synagogues des Juifs.
Arrivés à Antioche de Pisidie
ils entrent dans la synagogue le jour du Sabbat (Grec : des sabbats) et après
la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue les invite à
parler au « peuple » (Actes 13 : 14, 15). Il désigne ainsi l'assemblée des
Juifs et des prosélytes (5). Paul résume l'histoire d'Israël et arrive au
Sauveur d'Israël et à la repentance. « C'est à vous que cette parole de salut a
été envoyée. » Il témoigne, comme les Douze, de Sa résurrection (6). « Et nous,
nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu
l'a accomplie pour nous, leurs enfants. » « C'est par lui que le pardon des
péchés vous est annoncé». Il dépasse les Douze en faisant déjà allusion à la
justification, qui fera plus spécialement partie de son évangile aux
incirconcis.
Le Sabbat suivant il n'y a pas
seulement des Juifs et des Prosélytes, mais « presque toute la ville » et
maintenant les Juifs s'opposent à Paul et celui-ci se tourne, en cette ville,
vers les Gentils.
(3)
Voir le même chapitre v. 1 à 18. Ceci se passe environ dix ans après la
Pentecôte.
(4) Actes 11 : 26. D'habitude on
considère que " juif » et « chrétien » sont en opposition. Il n'en est
rien. Le juif régénéré reste juif. Le terme « juif " n'indique pas une
croyance, mais une nationalité. Ce n'est que dans les sphères célestes et sur
célestes, qu'il n'y a plus ni juif, ni gentil, c.-à-d. plus de distinction
nationale. Tous les juifs de l'éon à venir sont chrétiens tout en restant
juifs. Les juifs chrétiens commencent actuellement à se rendre compte de cela
et à former des assemblées séparées.
(5) Voir le verset 16 où « vous
qui craignez Dieu " indique les prosélytes. C'était le terme, technique »
utilisé pour désigner des Gentils, circoncis ou non, qui croyaient en "
Jéhovah, et assistaient, séparés des Juifs, aux réunions dans les synagogues.
Voir aussi le v. 43 où les prosélytes sont appelés par leur nom, et Actes 13
:26 ; 10 : 2, 22 ; 16 : 14 ; 17 : 4, 17 ; 18 : 7.
(6) Voir aussi 1 Cor. 15
: 11, 12 qui parlent de Paul et des Douze (v. 5-9).
Page 28
Paul et Barnabas sont chassés.
Ils avaient présenté leur message et avaient accompli à la lettre les
instructions du Seigneur quand il s'agissait d'aller, non vers les Gentils,
mais plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël pour leur dire que le
Royaume était proche (Mat. 10 : 5-7). Le Seigneur avait dit : « Lorsqu'on ne
vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou
de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Paul et Barnabas «
secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds » (Actes 13 : 51).
Paul et Barnabas continuent
ainsi à porter les messages du Royaume aux Juifs de la dispersion. À Icône ils
entrent dans la synagogue des Juifs et font les prodiges et les miracles (Actes
14 : 1-4) qui sont l'accompagnement normal de ce message (7). Mention est
faite des « Grecs ». Comme ceux-ci se trouvent dans la synagogue, ce sont des
prosélytes. Les Juifs excitent les « païens » et obligent Paul, et Barnabas à
se réfugier à Lystre et Derbe, où ils annoncent la bonne nouvelle. Paul y
guérit un boiteux et la foule les prend, avec Barnabas, pour des dieux. Mais
Paul n'accepte pas cet hommage et, comme il s'agit d'un milieu païen ne
connaissant pas le Dieu vivant, il ne leur annonce pas le Royaume, mais les
exhorte à se tourner vers le Dieu-Créateur. C'est une autre Bonne Nouvelle,
adaptée à ceux-là et à beaucoup d'autres, même de nos contemporains. Le chemin
du salut devait commencer par la crainte du Dieu créateur.
Retournés à Lystre, à Icone et
à Antioche, ils rappellent aux disciples que la venue du Royaume est précédée
de beaucoup de tribulations. Ils ne font ainsi que confirmer les prophètes, le
Seigneur et les Douze.
Nous voyons qu'Israël, dans les
villes principales ainsi visitées, rejette en quelque sorte officiellement le
message du Royaume et que, par contre, les Gentils commencent à se tourner vers
Dieu et vers le Christ. Le temps des Actes est une période de transition. Elle
aurait dû conduire au Royaume, mais, vu la non repentance d'Israël, elle
aboutit à des bénédictions supérieures à celles d'Israël. Le message du Royaume
continue cependant à être proclamé parmi les Juifs de la dispersion dans les
endroits où le Messie n'a pas encore été rejeté.
7 (7) Mat. 10 : 7, 8 et voir Le Plan Divin.
Page 29
Mais parallèlement nous voyons
se développer l'évangile de l'incirconcision. Barnabas semble cependant vouloir
se limiter au message du Royaume.
Mais le Royaume reste toujours
« proche » et les signes continuent : Paul est délivré de la prison (Actes 16 :
24-26).
À Thessalonique il entre aussi
dans la synagogue et témoigne que Jésus est le Christ (Actes 17 : 1-3).
Quelques Juifs et beaucoup de prosélytes sont convaincus. À Bérée, nouvelle
visite à la synagogue et les Béréens reçoivent la Parole avec beaucoup
d'empressement et chaque jour ils examinent les Écritures, pour vérifier si ce
qu'on leur dit est exact. Or il ne peut s'agir ici que des Écritures formant
l'Ancien Testament et cela prouvent que le message de Paul aux Juifs n'allait
pas plus loin. Rien de ce qu'il annonce en relation avec le Royaume n'est
caché.
À Athènes, Paul s'entretient
dans la synagogue avec les Juifs et les prosélytes et sur la place publique
avec ceux qu'il rencontre. Aux Gentils il annonce, comme à Lystre, le Dieu
Créateur et demande leur repentance « vers » Lui.
Chaque Sabbat il parle dans la
synagogue de Corinthe et atteste aux Juifs que Jésus est le Christ (Actes 18 :
1-5). Là encore, il se tourne vers les Gentils quand les Juifs font de
l'opposition. Nous voyons ensuite Paul dans la synagogue d'Éphèse (Actes 18 :
19 et 19 : 8) discuter pendant trois mois au sujet du Royaume de Dieu (8). Il fait des
miracles extraordinaires.
Aux 26e chapitres des Actes,
Paul parle encore ainsi:
« Et maintenant, je suis mis en
jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à
nos pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent
Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi,
que je suis accusé par les Juifs ! » (Actes 26 : 6-8).
Enfin aux 28e chapitres, où nous
voyons que la morsure d'une vipère ne lui faisait aucun mal, nous assistons
après qu'il a guéri des malades, à la dernière conférence avec les Juifs de
Rome.
8 (8)Voir version Jérusalem : 19 : 8 et 20 : 25 (dans ce dernier
texte les principaux manuscrits n'écrivent pas " Dieu ").
Page 30
Il parle encore et toujours de l'espérance
d'Israël (9), il leur annonce le Royaume de Dieu et cherche, par
la Loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus.
Là encore, Israël rejette son Messie et Paul rappelle la sentence d'Esaïe 6 :
9, 10, qui se réalise enfin complètement : Israël a partout fermé ses oreilles
et ses yeux, a endurci son coeur. Le salut de Dieu est désormais partout envoyé
aux Gentils. Désormais Paul ne parle plus de « Jésus », mais du Seigneur
Jésus-Christ ; il ne connaît plus le Christ selon la chair, mais le
Christ-Jésus placé à la droite de Dieu. Il proclame le Royaume de Dieu en
général, Royaume comprenant toute la création et tous les éons, mais il ne
proclame plus le Royaume des cieux localisé sur terre. Le peuple élu est rejeté
pour un temps, le Royaume terrestre est temporairement éloigné.
Nous voyons donc en résumé que
Paul, pendant cette période, proclame au moins trois évangiles :
1) Il annonce le Dieu-Créateur
aux non-croyants en Dieu et leur demande de renoncer aux choses vaines et de se
tourner vers le Dieu vivant ;
2) Il annonce la bonne nouvelle
du Royaume à la circoncision et aux prosélytes, et les appelle à la foi en
Jésus-Christ et la repentance ;
3) Il annonce aux incirconcis
croyants en Dieu le Christ et leurs bénédictions en rapport avec Israël.
Dans les Épîtres, nous verrons
qu'il proclame également pendant cette période le message de la justification
et de la nouvelle création. Dans le livre des Actes, nous ne trouvons que
quelques allusions à ce dernier évangile.
Il est bon de penser ici aux
promesses abrahamiques. Il faut, dans ce but, considérer quatre catégories
d'hommes:
1) Les non croyants en Dieu
2) La grande nation,
c'est-à-dire Israël, qui sera béni, possédera le pays de Canaân et sera une
source de bénédictions (Gen. 12 : 2, 3) ;
3) Les familles de la terre
bénies en Abraham (10). Israël surtout forme la postérité qui est « comme
la poussière de la terre » (Gen. 13 : 16) ;
4) La postérité qui sera
nombreuse comme les étoiles du Ciel et qui est en relation avec la
justification (Gen. 15 : 5, 6).
9 (9) Actes 28 : 20. Il est important de noter qu'il s'agit jusqu'à la fin
des Actes de l'espérance d'Israël.
10 (10) Il est question des familles de la terre.
Gal. 3 : 8 parle d'une bénédiction plus générale,
qui comprend la postérité
céleste.
Page 31
Ces promesses commencent à se
réaliser pendant la période des Actes. Les Douze s'adressent surtout à la
deuxième catégorie et exceptionnellement à la troisième. Paul s'adresse à tous.
Au fur et à mesure que le Royaume est rejeté par Israël et que les promesses
concernant cette nation et les bénédictions des Gentils par elle apparaissent
comme ne pouvant pas encore se réaliser, Paul se concentre sur le message
adressé à la quatrième catégorie et parle de la position céleste en Christ et
de la justification. Nous voyons ainsi qu'il faut distinguer entre des
catégories de personnes et entre les messages qui leur furent adressés. Il faut
cependant se garder ici d'une grave erreur. Tout homme est né pécheur et Dieu
veut le conduire au salut. Cela reste toujours vrai, dans n'importe quelle
circonstance. Dans ces divers messages, il y a un élément personnel, qui ne
change pas et reste toujours indispensable. Ce qui concerne l'homme extérieur
et ses rapports avec son entourage, peut varier suivant les dispensations, mais
ce qui concerne l'homme intérieur ne varie pas. Ainsi un « non croyant en Dieu
» a toujours besoin, quelle que soit la dispensation, qu'on lui présente le
Dieu-Créateur. De même tout « croyant en Dieu » doit apprendre aussi à avoir
foi en Jésus-Christ. Mais là-dessus se greffe un élément temporaire, qui dépend
des circonstances extérieures, des dispensations. Quand le Royaume terrestre
est proche, on demande aux «Juifs-croyants-en-Dieu » de croire aussi que Jésus
est le Christ. Il y a là un double but : 1e le but personnel ; 2e le but
national. Sans repentance et foi en Christ de la part de la nation, pas de
Royaume terrestre. Mais lorsque le Royaume est rejeté et que le but national
disparaît pour un temps, le premier but subsiste et tout Juif, comme tout autre
homme, peut encore être invité à se repentir. Mais l'Écriture ne demande jamais
à un « Gentil croyant en Dieu » d'avoir foi en Christ pour que le Royaume
vienne. Seule la repentance nationale d'Israël pouvait conduire au Royaume sur
terre.
Si nous disons donc qu'après la
période des Actes, le Royaume s'est éloigné et que le message du Royaume (ou de
la circoncision) n'est plus proclamé, cela ne signifie nullement que l'élément
personnel de ce message est devenu inutile ou a été remplacé par un autre
message.
PAGE 32
Le changement est dans les
conditions extérieures et surtout dans le fait qu'Israël (comme nation) est rejeté.
Si Paul se concentre sur un évangile céleste, cela ne veut pas dire que
désormais, un « non croyant en Dieu » pourra avoir part aux bénédictions
supérieures sans avoir foi en Dieu, sans repentir et sans conversion « vers »
ce Dieu-Créateur.
Nous verrons au chapitre
suivant comment Paul ouvre une sphère nouvelle de bénédiction ; mais nous
insistons ici sur le fait qu'il ne cesse pas pour cela d'exhorter des «
non-croyants » à se tourner vers Dieu et des « croyants en Dieu » à croire que
Jésus est le Christ.
Souvent on nous a reproché de
ne garder des Écritures que quelques Épîtres, puisque nous prétendons que tout
le reste est « juif ». Or, ce reproche repose sur une grave confusion. Nous
disons, en effet, que tout ce qui caractérise la période pendant laquelle
Israël est encore le peuple de Dieu n'existe plus maintenant, c'est-à-dire tous
les dons et miracles visibles et de pratique courante pour la majorité des
croyants, ainsi que toutes les cérémonies, etc., mais nous sommes loin de
rejeter pour cela ce qui est personnel et qui reste toujours nécessaire. La
voie du salut reste la même, malgré tout changement dispensationnel. Nous nous
proposons d'examiner cela plus en détail dans La Voie du Salut.
Nous ne perdons pas de vue que
« Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que,
par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous
possédions l'espérance » (Rom. 15 : 4). Nous avons dans l'A. T. tant d'exemples
de l'amour, de la miséricorde et de la patience de Dieu. Non seulement nous
pouvons nous appliquer beaucoup de choses d'une manière spirituelle, tel le cas
où Paul cite les promesses faites à Israël en 2 Cor. 7 : 1, mais de plus tout
ce qui concerne personnellement les régénérés et les justifiés de l’A. T.,
concerne aussi personnellement les régénérés et les justifiés actuels. Et
comment ne pas apprécier ce que les Psaumes nous apprennent de l'expérience
personnelle de Salomon, de David et d'autres ? Voir aussi p. 15 de
l'Introduction.
PAGE 33
4. Le
Message du Royaume dans les Épîtres.
Nous verrons plus loin que
Paul, dans les épîtres écrites pendant la dernière partie de la période des
Actes (Romains, 2e Ep. aux Corinthiens, et Galates, s'occupe presque
exclusivement du message céleste, qu'il appelle « mon évangile » (11).
Nous n'examinerons pas ici quel
est l'auteur de l'épître aux Hébreux. La Parole garde le silence à ce sujet et
nous ne pourrions n'émettre que des suppositions. Ce qui est certain, c'est
qu'elle est adressée à des « Hébreux » c'est-à-dire à des Juifs, comme celles
de Jacques, de Pierre, de Jean et de Jude. Comme on a généralement trop de
tendance à perdre de vue que ces épîtres sont adressées à des Juifs chrétiens,
il est peut-être bon d'insister un peu sur ce fait.
Pour ce qui concerne l'épître
de Jacques, il n'y a aucune difficulté, il suffit de lire l'adresse : « Aux
douze tribus, qui sont dans la dispersion » (2). Il parle de la synagogue (3), de la Loi (4), d' «amis de Dieu » (5), du Seigneur
Sabaoth (6), de l'onction (7), etc. Toute cette épître respire l'atmosphère
judéo-chrétienne des Actes.
Pierre, dans sa première
épître, s'adresse aussi aux « dispersés ». Ils sont des « étrangers » sur la
terre pendant cet âge (8). Ces Juifs sont régénérés (1 Pi. 1 : 3, 23). Il parle
de la pierre en Sion (1 Pi. 2 : 6) et les désigne comme un « sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis » (9), comme le « peuple de Dieu » (10), comme des «
brebis errantes » (11).
1 (1) Dans les épîtres aux Thessaloniciens, qui sont sans doute les plus
anciennes, Paul touche à peine ce qui concerne la sphère céleste. De même pour
la première aux Corinthiens.
(2) C'est la « diaspora ». Voir
aussi Jean 7 : 35 ; Actes 8 : 1 ; 1 Pi.1 : 1. Jamais ce terme
n'indique des Gentils.
(3) Jacq. 2 :2 (Version
Darby).
(4) Jacq. 2 :9, 10 ; 4 :
11.
(5) C'est une expression juive
caractéristique. Voir 2 Chron. 20 : 7 ; Es. 41 : 8 (Darby).
(6) Jacq. 5 :4 (Darby).
(7) Jacq. 5 :14 et Marc. 6
: 13.
(8) Voir Héb. 11 : 13 et 1 Pi. 2
: 11.
(9) Remarquer que ceci indique
des Juifs : Ex. 19 : 6 ; Es. 61 : 6 ; 66 : 21 ; Apoc. 1 : 6. Celui qui veut
laisser à Israël ce qui appartient à Israël doit appliquer ces textes à ce
peuple.
10 (10) 1 Pi. 2 : 10. Ceci est une citation d'Osée 1 : 9 ;
2 : 25 adressée à Israël. Voir d'ailleurs le contraste avec 1 Pi. 2: 12
où les " païens », c.-à-d. les nations, sont mentionnés.
(11) Voir Mat. 9 : 36. Les
Gentils ne sont jamais appelés des « brebis ». Le Seigneur n'est jamais non
plus appelé le Berger des Gentils.
Page 34
Dans sa deuxième épître, Pierre
s'adresse aux mêmes Juifs dispersés, puisqu'il l'appelle sa « seconde lettre »
(12).
Jean est un des apôtres de la circoncision
et il va de soi que ses épîtres sont adressées aux circoncis. Cela ne demande
donc aucune démonstration. Au contraire ceux qui croient qu'elles sont
adressées à des Gentils devraient justifier cette opinion. Jean met ses
lecteurs en garde contre le fait de croire que Jésus-Christ est une victime
expiatoire uniquement pour les Juifs ( 1 Jean 2 : 2). Il ne dépasse pas la
sphère de la nouvelle naissance (13) et de la vie « éonienne » terrestre.
Jamais il ne parle de la justification dans le sens paulinien, ni de la
nouvelle création. Nous examinerons cela plus loin. Dans sa troisième épître,
il fait le contraste entre les Juifs auxquels il s'adresse et les « païens » (3
Jean 7).
Jude rappelle la délivrance du
peuple hors d'Égypte (Jude 5), mentionne Micaël (Jude 9) qui est le défenseur
du peuple juif (Dan. 12 : 1) et parle des temps précédant le Royaume (14).
Nous n'insisterons pas ici sur ce qui concerne l'Apocalypse, dont le caractère
hébraïque et les nombreuses références à l'Ancien Testament ont amené certains
auteurs à vouloir éliminer ce livre du canon des Écritures.
Le lecteur qui voudra bien
relire ces écrits en tenant compte de nos remarques pourra se rendre compte que
tout demeure dans la sphère du Royaume qui était proche. La fin de l'âge
présent semblait peu éloignée.
(12) 2 Pi. 3 : 1. Il est curieux
de voir l'aveuglement de ceux qui croient que « l'Église » a remplacé Israël.
Ainsi Batiffol dit de 1 Pi. : "L'épître est adressée à des chrétiens, qui
ne sont pas juifs de naissance (2 : 10), et qui vivent dispersés au milieu des
païens (2 : 12). » Or le verset 2 - 10 se réfère évidemment à Osée 1 : 9 et 2 -
25. Israël avait été « Lo-Ammi » (pas mon peuple) mais l'Éternel dirait de
nouveau : « Tu es mon peuple. » Il n'est pas question des gentils ici. Le
comble est que Batiffol ajoute en note : « Je ne connais pas d'autre exemple de
l'emploi chrétien du mot " Dispersion ». Voir l'Église naissante, p. 132.
(13) 1 Jean 5 : 1 et Jean 3 3 et
voir le chapitre 9.
(14) Jud. 18 et voir 2 Pi. 31-4.
Page 35
Le message des auteurs de ces
Épîtres est la repentance, la foi en Christ, comme Messie, la nouvelle
naissance. Le chapitre suivant fera mieux ressortir que ce message n'atteint
pas l'Évangile de Paul.
Toutes les épîtres adressées
aux Juifs pendant les Actes contiennent des indications d'ordre national et
dispensationnel, qui ne sont applicables qu'à Israël, et seulement tant que ce
peuple n'est pas rejeté. Elles contiennent également des éléments personnels,
qui avaient pour but de conduire Israël à la repentance, à la nouvelle
naissance et à une marche digne de sa vocation. Ces parties sont d'application
universelle, mais encore faut-il se souvenir qu'elles ne mènent pas plus loin
que la nouvelle naissance et les bénédictions terrestres avec Israël. Après
avoir vécu ce qu'il y a de personnel dans ces épîtres, il faut suivre Paul dans
sa course vers le but et laisser Jean comme une expérience du passé.
Les épîtres de la circoncision
restent toujours utiles, mais elles cessent, pour deux raisons, d'être de
première importance pour ceux qui suivent Paul.
1e parce que, en partie, elles
concernent uniquement Israël ; 2e parce qu'elles se limitent au commencement de la voie
du salut.
Si certains lecteurs ne sont
pas convaincus que notre conception est scripturaire, les chapitres suivants
pourront peut-être leur faire trouver notre attitude plus acceptable.
Il ne s'agit plus ici de
bénédictions pour les Gentils par Israël, comme annoncées par les prophètes et
confirmées par les apôtres de la circoncision. Dans le Livre des Actes, les
épîtres aux Thessaloniciens et la 1e Ep. aux Corinthiens, on ne trouve que des
allusions à ce nouveau message, et il est préférable d'examiner d'abord les
épîtres que Paul a écrites pendant la dernière partie de la période des Actes,
pour se rendre compte en quoi cet évangile diffère de celui des Douze. On
pourra ensuite relire les Actes et mieux reconnaître les quelques indications
relatives à ce message.
Le message céleste est
tellement différent de celui de Pierre et de Jean, que Paul l'a appelé « mon
évangile » (Rom, 2: 16 ; 16: 25), et aussi l'évangile de l'incirconcision,
(Gal. 2: 7).
Page 36
Il le nomme encore l'évangile du
Fils de Dieu (Rom. 1: 9) et l'évangile de Christ (Gal. 1: 7). Mais quoique ce
message ne soit pas celui des Douze, il n'est pas absolument nouveau. En effet,
l'Ancien Testament y fait déjà allusion. Ne savons-nous pas qu'avant la
formation du peuple élu, avant la circoncision, Abraham savait déjà qu'il
aurait une postérité céleste basée sur la justification par la foi (1) ?
Il n'est plus question ici
d'hériter Canaan, mais d'être cohéritiers de Christ (Rom. 8: 17 ; Gal. 3: 29).
Il y a cependant encore prééminence
des Juifs sur les Gentils, au point de vue national et dispensationnel. Pendant
la période des Actes, nous lisons en effet à plusieurs reprises : le Juif
premièrement, puis le Grec (c'est-à-dire le Gentil) (Rom. 1: 16 ; 2 : 9-10 ; 3
: 1, 2).
Dans cette nouvelle sphère, il
ne s'agit plus de la Jérusalem terrestre, mais de la Jérusalem d'en haut (Gal.
4:25, 26). Paul fait aussi la distinction entre ceux qui - nés de nouveau -
sont « enfants de Dieu » et ceux qui sont arrivés à l'adoption comme « fils »
(2). Les premiers sont encore esclaves du péché et de la Loi (3), et
appartiennent encore à l'ancienne création, tandis que les fils sont libres
(Rom. 8: 2 ; Gal. 4: 5, 26), morts au péché (Rom. 6: 2), séparés de l'ancienne
humanité (Rom. 6: 6) ; ils ne sont plus « en Adam », mais ils appartiennent
maintenant à la nouvelle création parce qu'ils sont « en Christ Jésus ».
1 (1) Gen. 15 : 5, 6 et p. ex. Rom. 4 : 9-13 ; Gal. 3 : 6-9. Paul avait
été spécialement désigné pour proclamer cet évangile. D'autres comme Silvain et
Timothée qui n'appartiennent pas aux Douze, présentent le même évangile (2 Cor.
1 : 19 ; 3 : 5, 6 ; 4 : 3).
(2) Gal. 4 : 1-7 et Rom. 8 : 14,
15, 19 (fils = huios). M. Ch. Welch a montré dans le Berean Exposîtor du mois
d'avril 1935 que Rom. 8 : 1-39 se décompose comme suit :
A, 11-4. Pas de condamnation.
Dieu a envoyé Son propre Fils (huios)
BI 15-15. Conduit par l'Esprit
de Dieu. Fils (huios)
CI 115-17. L'Esprit rend
témoignage. Adoption (huiothesia)
D 1 17-21. Souffrance et gloire.
Manifestation des fils (huios)
C2 / 22-28. L'Esprit intercède.
Adoption (huiothesia)
B2 / 29-30. Semblables à l'image
de Son Fils (huios)
A2 / 31-39. Qui condamne? Dieu
n'a pas épargné Son propre Fils (huios).
On remarque la correspondance
entre les parties A, et Au, BI et Bu, Ci et Cu. D est le passage central. De
telles « structures » sont une des preuves de l'inspiration divine.
(3) Gal. 4 : 1-3, 25 (le texte
n'a pas , enfant » (teknon), mais « mineurs » (nèpios) ; Rom. 7 : 23. Pour la
différence entre " sous » et « en » la Loi, voir note NI 54, p. 39, Le Plan
Divin.
Page 37
Tandis que le message du
Royaume a en vue l'âge prochain (celui de la régénération), le message céleste
est en rapport avec l'âge qui le suivra : celui de la nouvelle création (Gal.
6: 15 ; 2 Cor. 5: 17). Nous restons pourtant toujours dans la série des éons,
et il est donc aussi question de la vie « éonienne » (4). Cependant
celle-ci ne concerne plus la terre et l'ancienne création comme dans le
Royaume, mais le ciel et la nouvelle création. « En Christ Jésus » est
l'expression caractéristique de ce message.
L'accent est maintenant mis sur
la réconciliation (5) et la justification (6). Nous examinerons ces deux sujets
dans un autre chapitre.
Voilà donc l'évangile particulier
de Paul pendant la dernière partie de la période des Actes. Lorsque les Juifs
rejetaient le Royaume et retardaient ainsi les bénédictions terrestres des
Gentils, Paul ouvrait une nouvelle possibilité : la sphère céleste (7). Le but
était triple. D'abord le dessein de Dieu ne serait ainsi en rien retardé par la
défection des Juifs. Ensuite les Gentils n'auraient pas nécessairement à
souffrir de l'apostasie juive. Enfin Israël serait excité à la jalousie (Rom.
10: 19 ; 11 : 11). Nous examinerons ce dernier point au chapitre 7.
Il est bien entendu que les
Juifs aussi pouvaient déjà avoir accès, individuellement, et pour ce qui
concerne l'homme intérieur, à cette position céleste.
4 (4) Rom. 6 : 23 ; Tit. 1 : 2 ; Gal. 6 : 8 et voir Le Plan Divin pour ce
qui concerne la signification de « vie éonienne ».
(5) Rom. 5 : 10, 11 ; 11 : 15 ;
2 Cor. 5 : 18, 19, 20. Paul seul parle de la réconciliation.
(6) Rom. 3 et Gal. 2 et 3.
(7) C'est aussi le but de l'épître
aux Romains p. ex. Il y a en des discussions interminables dans le monde
théologique au sujet de la composition de l'église de Rome. Pour les anciens et
quelques modernes c'est une église de pagano-chrétiens, pour les autres elle
est essentiellement judéo-chrétienne. Il semble clair qu'elle était composée de
ces deux éléments, mais que l'église ne connaissait pas encore le message
céleste. Ce message amena une division et prépara l'abandon complet de l'Apôtre
après la période des Actes. Voir p. 76
Page 38
Si cette bonne nouvelle est
celle de l'incirconcision, cela ne veut pas dire en effet que le Juif en soit
exclu, mais simplement qu'il s'agit des bénédictions promises à Abraham avant
que fût instituée la circoncision, et ne mettant pas en cause Israël comme
nation.
Pour y avoir part, le Juif
devait abandonner toutes ses prérogatives nationales et, comme les Gentils,
mourir avec Christ, se séparer en esprit de l'ancienne humanité, être justifié
par la foi (Gal. 2: 16). Ce qui ne devait pas l'empêcher de suivre selon la
chair les formes extérieures de la Loi.
Nous voyons par tout ceci que
cette nouvelle sphère de bénédiction n'a rien à voir avec la Pentecôte.
Personne en ce moment n'avait une connaissance détaillée de ces bonnes
nouvelles : Paul serait le premier à les proclamer. Par contre, les événements
de la Pentecôte étaient promis à Israël (8).
On a parfois cru que ce qui
distinguait la Pentecôte, c'était qu'à partir de ce moment le Saint-Esprit «
demeurait » dans le croyant, au lieu de le visiter temporairement, comme dans
l'Ancien Testament. C'est une erreur. L'esprit n' « habite » pas dans ceux qui
appartiennent à la sphère terrestre, mais seulement dans ceux de la sphère
céleste (9).
6.
Considérations relatives à la Loi
Nous avons plus spécialement en
vue la Loi particulière donnée à Israël, mais ces considérations s'appliquent
en général à tout commandement conforme à la norme divin. Dans Le Plan
Divin, nous avons déjà touché plusieurs questions relatives à la Loi (1), mais
nous devons maintenant préciser, sans toutefois traiter la matière à fond.
8 (8) Actes 2 : 16 ; Joël 2 : 28-31 ; Es. 44 : 3 ; Ezech. 36 : 26, etc.
Voir aussi Le Plan Divin.
(9) Voir Rom. 8 - 9, il par
exemple. Nous avons déjà fait remarquer dans Le Plan Divin que les dons
spirituels n'étaient pas permanents, mais passagers. On a pensé pouvoir
attacher une signification spéciale à l'expression « remplis du SaintEsprit »
utilisée au début des Actes (Actes 2 : 4 ; 4 : 31). Or il s'agit ici non du
Saint-Esprit lui-même, mais de Ses dons, qui sont souvent indiqués par ce nom.
Cela se voit clairement dans le texte grec, où il n'y a pas d'article et où «
esprit » est au génitif. En contraste avec ceci, l'Épître aux Éphésiens parle
d'être rempli (ou plutôt « accompli »), par l'Esprit, Eph. 5 : 18. Ici le datif
indique la personne qui agit. Voir aussi Appendice 2.
(1) Voir p. 35, 77 et
l'Appendice 6.
Page 39
Dieu donne une série de
commandements pour faire connaître Sa volonté (Rom. 2 : 18, c à d qui est
normal. Ceci est indispensable pour que l'homme puisse parvenir au but que Dieu
a en vue ; parce que, de lui-même, l'homme n'a rien d'absolu, rien qui puisse
lui montrer à quoi il doit parvenir.
Mais en demandant ce qu'Il
veut, Dieu semble demander l'impossible, car l'homme ne peut pas faire par ses
propres efforts ce qui est juste.
La Loi doit ainsi avoir pour
effet :
1e de montrer à l'homme la norme
voulue par Dieu ;
2e De le rendre conscient de son
péché en lui faisant sentir, par l'expérience, son impuissance à se conformer à
la volonté de Dieu (2) ;
3e D'anéantir son orgueil à tel
point qu'il s'adresse finalement à Dieu.
Il est bien vrai que « l'homme qui
mettra ces choses en pratique, vivra par elles » (Rom. 10 : 5), mais pour les
mettre en pratique il faut avoir la grâce divine. L'homme naturel ne se rend
pas facilement compte de son péché, et il peut croire naïvement qu'il suffit
que Dieu lui dise ce qu'il doit faire pour qu'il le fasse. S'il n'était pas
aveuglé, il pourrait pourtant observer que la connaissance de la volonté divine
l'excite souvent à enfreindre cette volonté (Rom. 7 : 8).
Nous savons comment Israël n'a
pas eu recours à cette grâce et devra encore passer par la grande tribulation
avant de se repentir et de se tourner vers Christ. Tous ceux qui veulent
observer la Loi par leurs propres efforts et disent : « Nous ferons tout ce que
l'Éternel a dit » (3) sans se jeter d'abord à Ses pieds en reconnaissant leur
péché, deviennent esclaves de la Loi (Gal. 4 : 3), se placent « sous » la loi
(Rom. 6 : 14) et sous la malédiction (Gal. 3 : 10, 13). Par expérience ils
devront apprendre à connaître leur péché.
Le commandement est saint,
juste et bon (Rom. 7 : 12), mais ne vivifie pas (Gal. 3 : 21) et ne donne pas
par lui-même la possibilité de l'accomplir. Il est donc impossible
d'être justifié par la Loi ou
par les oeuvres.
2 (2) Rom. 3 :19, 20 5 : 20 ; 7 : 7-13 ; Gal. 3 :19.
(3) Ex. 19 : 8 ; 24 1-3, 7, 8.
La grâce de Dieu était cependant offerte depuis longtemps et beaucoup
d'Israélites l'ont acceptée. Ex. 22 : 25-27 ; 34 - 5-7 ; Ps. 116 : 5 ; 103 :
2-10, etc.
Page 40
Quand Israël se repentira, un
des buts de la Loi sera atteint. Mais cela veut-il dire que les Juifs ne
devront plus faire ce que Dieu leur demande ? Au contraire les commandements
ont été donnés pour être observés, et s'il est vrai que les Israélites devaient
être régénérés avant d'aimer la Loi, ce serait un peu trop extraordinaire
qu'étant parvenu là, ils ne soient plus obligés de les accomplir. Quand Israël
sera de nouveau « Mon Peuple », la Loi sera toujours là.
Si le lecteur n'aime pas ce
raisonnement, qu'il accepte au moins les affirmations de la Parole à ce sujet.
La Loi est « éternelle », c à d. durera pendant tout l'âge prochain (4). Le Seigneur a
dit : « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne,
passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de
lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Or le ciel et la terre ne «
passeront » qu'à la fin de l'âge prochain, quand viendront « un nouveau ciel et
une nouvelle terre. » (Apoc. 21 : 1 ; 2 Pi. 3 : 13). Israël aura alors accompli
ses fonctions. Ézéchiel ne donne-t-il pas des détails minutieux de tous ces
commandements, qui comprennent toujours la circoncision de la chair et les
offrandes animales pour l'éon prochain ? (Ezéch. 40 à 45).
Pendant l'âge à venir
s'accomplira ce que les prophètes ont dit concernant la Nouvelle Alliance avec
Israël et la régénération qui sera le premier pas pour, changer leur coeur de
pierre en un coeur de chairs : « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux » (5). Le
Psaume 119 sera alors chanté, non par quelques hommes régénérés, mais par tout
Israël. Ils prendront, comme tout homme né d'en-haut, « plaisir à la loi de
Dieu selon l'homme intérieur » (Rom. 7 : 22). Ils auront par cette naissance de
l'Esprit, l'intelligence nécessaire pour discerner exactement ce que Dieu désire
d'eux, y compris la profonde signification de toutes les cérémonies, qui
mettront journellement devant leurs yeux toutes les grandes vérités. Ils
aimeront ces commandements et pourront exécuter les cérémonies d'une manière
entièrement conforme à la volonté de Dieu. Chez eux, pas de disputes concernant
le baptême d'eau, la Pâque, etc.
4 (4) Ex. 27 : 21 ; 28 : 43, etc. Voir Le Plan Divin pour la signification
d' « éternel ».
(5) Jér. 31 : 31-34 et Héli. 8 :
10 ; 10 : 16.
Page 41
Mais tout cela est loin d'être
parfait. Bien que régénérés, ils ne sont que des « enfants mineurs » et comme
tels ils ne diffèrent en rien d'esclaves, quoiqu'ils soient les maîtres de tout
(6).
Ceci était déjà le cas pour les régénérés de l'Anc. Testament, mais
s'appliquera également à ceux qui vivront pendant l'âge à venir.
Les conditions sur terre,
pendant le règne du Seigneur, sont entièrement différentes des nôtres (7) mais
encore loin de la perfection. Celui qui est arrivé à la nouvelle naissance est
encore semblable à un petit enfant qui doit être conduit par des tuteurs et des
administrateurs. Bien qu'aimant ce que Dieu veut et voulant l'accomplir, il
appartient encore à l'ancienne création et est captif de la loi du péché (8).
Il est encore sous l'esclavage des rudiments du monde, « sous » la loi (Gal. 4
: 3-5). Il tâche d'observer une série de préceptes extérieurs et n'agit pas
encore comme un « fils », qui, sans préceptes, fait ce que Dieu veut par le
Saint-Esprit qui habite en lui. L'humanité a besoin de beaucoup de temps pour
évoluer librement selon le plan divin.
Que faut-il donc de plus ? Par
la régénération on est venu en contact avec le monde spirituel, avec la
nouvelle création, la nouvelle humanité, mais on appartient toujours à
l'ancienne humanité, on est encore « en Adam ». Il faut quitter cette sphère, c
à d mourir au péché, laisser crucifier le vieil homme, laisser détruire le
corps de péché. Alors on sera aussi mort à la Loi et donc dégagé de la loi (9).
6 (6) Gal. 4 : 1. :Le verset 4 indique le moment historique du rachat. Il
ne faut pas conclure de ce verset que tout ceux d'avant la croix étaient des «
enfants » et tous ceux d'après des « fils ». Abraham p. ex. avait déjà part à
la bénédiction qui n'était rendue possible historiquement qu'à la croix. Inversement
des multitudes seront encore « enfants » et n'auront pas encore reçu l'adoption
comme fils dans l'éon à venir
(7) Voir Le Plan Divin.
(8) Hom. 7 : 14-25 et voir les
chapitres concernant le « Message Céleste » et la « Justification » .
(9) Rom 6. Ceci ne veut pas dire
que l'on ne doit plus faire ce que Dieu demande ! La loi, dans le sens de «
volonté de Dieu ,, reste toujours applicable, mais on est délivré de la
condamnation de la loi (Gal. 3 : 13). Il est important ici de distinguer la "
Loi » spécialement donnée à Israël, contenant des prescriptions inapplicables à
nous, de ce qui est la volonté immuable de Dieu envers les hommes en général.
La volonté de Dieu est une et ne change pas. Mais elle peut se présenter à
l'homme sous divers aspects adaptés aux temps et aux circonstances. Ainsi le
peuple d'Israël a reçu une « Loi » à lui dont le fond : aimer Dieu et son
prochain, est d'application universelle, mais dont la forme est particulière.
Cette « Loi » ne se composait pas seulement des " dix commandements »,
mais comprenait aussi toutes les institutions cérémonielles et sociales. Telle
qu'elle est adressée à Israël, elle n'est pas applicable aux Gentils.
Page 42
On ne sera plus esclave du péché,
ni captif de la loi du péché (Rom. 6 : 7 ; 7 : 23), mais affranchi (Rom. 8 :
2). D'enfants mineurs, on sera devenu « fils » de Dieu (10).
Que devient alors la Loi ? Elle
reste toujours dans son essence, mais l'attitude des « fils » vis-à-vis d'elle
est complètement changée. Elle n'est plus pour eux une série de préceptes
qu'ils s'efforcent de suivre ; ce n'est plus une « lettre ». Les cérémonies ne
leur sont plus imposées. Maintenant ils sont entrés dans la nouvelle création,
ils sont « en Christ-Jésus », Lui-même agit en eux, la Loi est accomplie en eux
(Rom. 8 : 4), ils servent dans un esprit nouveau (11).
L'esprit de la Loi reste, la
forme change, car certains commandements n'avaient un sens que tant que ceux
auxquels ils étaient destinés n'étaient pas arrivés à l'état de « fils » ; ils
devaient les aider à y parvenir. Toutes les cérémonies, qui ne sont que l'ombre
des choses, sont écartées. Quand l'humanité sera passée de l'éon de la nouvelle
naissance à celui de la nouvelle création, il n'y aura même plus de temple
(Apoc. 21 ; 22). C'est le Seigneur Lui-même qui remplacera tout ce qui était la
« lettre ».
Ce qui précède a rapport à
Israël comme peuple et à l'humanité. Quand il s'agit d'individus, les
choses peuvent être un peu différentes. En effet personne ne doit attendre pour
recevoir les bénédictions divines que la masse se soit engagée dans la voie du
salut. Abraham était déjà justifié, donc « fils ». De même beaucoup d'autres
après lui.
(10) Rom. 8 : 14, 15 ; Gal. 3 :
26 ; 4 : 5-7. Il faut noter la précision avec laquelle les mots sont choisis
dans l'original. GaL 3 : 26 dit : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
eu Jésus-Christ » et précise donc ce que la foi des v. 23 à 25 embrasse. Les
régénérés avaient déjà cru « jusqu'en » (Grec : eis) Christ, mais pas encore «
en » (Grec : en) Lui. Ceci sera développé dans La Voie du Salut.
(11) Rom. 7 : 6. Faisons une
comparaison banale : Pour certains travaux on peut utiliser des aides auxquels
on donne des instructions minutieuses ou bien un initié qui comprend l'esprit
de la chose. Les premiers tâcheront de suivre tout à la lettre, mais risquent
de mal faire le travail. L'initié arrivera sûrement au but sans aucune
prescription extérieure.
Page 43
Avant la croix le nombre de
régénérés a été relativement considérable quoique Israël ne l'était pas en tant
que nation. À la Pentecôte les dons particuliers ont révélé qu'il y en avait
des milliers.
Pendant les Actes, nous voyons
une variété de groupe de croyants. Il y a des croyants en Dieu, mais non
régénérés, d'autres sont nés de nouveau, mais encore « enfants mineurs » et
enfin il y a les « fils » de Dieu. Les « enfants » et « fils » devanceront le
temps où toute l'humanité sera dans ces sphères correspondantes. Ils n'occupent
leur position qu'en esprit. Leur corps n'y a pas encore part. Comme tous ces
croyants vivent ensemble, ceux des sphères supérieures doivent bien des fois
s'abaisser par charité dans les sphères inférieures et ainsi imiter le Seigneur
(Phil. 2 : 5-8). Un « fils » peut dans ces conditions être amené à suivre la
lettre de la Loi et il n'y a rien d'étonnant de lire que Paul montre en public
qu'il se conduit en observateur de la Loi, se purifie, entre dans le temple et
offre des offrandes (Actes 21 : 22-26). La Loi était en vigueur. S'il est vrai
que Paul, mort à la Loi, n'était pas astreint aux cérémonies, il lui était
impossible de faire comprendre cela à ceux qui n'étaient pas encore morts à la
loi. Ne pas observer les cérémonies aurait donc donné l'impression qu'il les considérait
comme déjà abolies, alors qu'elles ne le seront absolument qu'à la fin de l'éon
à venir.
La période des Actes présente
donc souvent des situations compliquées du fait que diverses sphères sont
représentées, que plusieurs messages sont dispensés. Cette période aurait due
être une transition jusqu'au Royaume terrestre, alors que du fait de la
non-repentance d'Israël elle a conduit à la situation actuelle, ignorée des
prophètes et des Apôtres de la circoncision.
Nous pouvons donc distinguer
pendant les Actes des hommes occupant les quatre positions suivantes :
1° Sans Loi
2° avec la Loi, mais sans la
grâce
3°Avec la Loi et la grâce, mais
encore sous le péché
4° affranchis de la Loi et du
péché ; la Loi accomplie en eux.
Le tableau suivant donne un
résumé de ce que nous avons examiné dans ce chapitre.
Page 45
Les Écritures parlent à titre symbolique
de différents arbres. Ainsi dans le livre des Juges il est question au neuvième
chapitre de quatre arbres :
1. L'olivier (v. 8) qui produit
l'huile (v. 9)
2. Le figuier (v. 10) qui
produit la douceur et un excellent fruit (v. 11)
3. La vigne (v. 12) produisant
le vin qui réjouit (v. 13) (1)
4. Le buisson d'épines (v. 14)
Or dans d'autres textes nous
trouvons qu'Israël (ou ses représentants) sont symbolisés par ses arbres. Nous
ne mentionnons que quelques textes qui se rapportent à l'olivier :
Jér. 11 : 16. « Olivier
verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait
donné l'Éternel. »
Os. 14 : 6. « Il (Israël) aura
la magnificence de l'olivier. »
Hab. 3 : 17 « Le fruit de
l'olivier manquera. »
Zach. 4 : 14. « Ce sont les
deux oints », c'est-à-dire Zorobabel et Josué qui représentaient le peuple.
Apoc. 11 : 3, 4. « -Mes deux
témoins... ce sont les deux oliviers. »
L'olivier symbolise les
prérogatives spirituelles et particulièrement celles d'Israël :
« Quel est donc l'avantage des
Juifs, ou quel est l'utilité de la circoncision ? Il est grand de toute
manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés »
(Rom. 3 : 1, 2).
« À qui appartiennent
l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les
promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ...
» (Rom. 9 : 4, 5).
Romains 11 surtout est
instructif en ce qui concerne l'olivier. Paul parle aux Gentils, dont il est
l'apôtre (v. 13) et les appelle un olivier sauvage (v. 17). Des groupes de
Gentils forment les « branches » de cet olivier (v. 24), entés à la place de
quelques branches de l'olivier franc (17, 24).
1 (1) Jean 15 parle de la vigne, qui, ici aussi, représente Israël.. Il
demeure toujours pour nous une application personnelle de ce qui est destiné à
Israël. Les paroles ne nous sont pas adressées, mais peuvent nous être
applicables, tout au moins en partie.
Page 46
Il désigne donc clairement
d'une part des groupes israélites tombés dans l'endurcissement (v. 25), ne
croyant pas en Christ, et, d'autre part, des groupes de Gentils, participant de
la racine et de la graisse de l'olivier (v. 17). L'olivier sauvage représente
l'ensemble des Gentils, l'olivier franc tout le peuple d'Israël. La racine peut
symboliser les promesses abrahamiques. Les incirconcis ont reçu certaines
bénédictions naturelles (Actes 14 : 17), mais Dieu les a laissés suivre leurs
propres voies et ils étaient « sans Christ, privés du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le
monde » (Eph. 2 : 12). Pendant ce temps, Israël occupait le premier plan et
nous avons vu comment le Seigneur Lui-même ne s'adressait qu'à eux. Ils
devaient occuper la position voulue pour que le dessein de Dieu s'exécutât et
que les bénédictions puissent venir aux Gentils.
Romains 11 nous présente une
image inspirée des conditions de la période des Actes. Conformément aux
promesses abrahamiques, Dieu a suscité en premier lieu Israël, le peuple
terrestre, et les nations sont provisoirement laissées à l'écart. C'est par
Israël que les bénédictions relatives au Royaume terrestre doivent leur
parvenir. Mais Israël ne se repent pas, ne réalise pas sa position et retarde
ainsi la régénération mondiale. En partie pour exciter Israël (Rom. 10 : 19 ;
11 : 11), Dieu fait participer des groupes de Gentils aux bénédictions
abrahamiques (2) et cela pour ainsi dire avant le temps.
Ce qui est de suprême
importance ici, c'est de voir que l'olivier n'a rapport qu'aux bénédictions
spirituelles et non à des prérogatives nationales. Si les nations ont déjà part
à ce qui est spirituel, cela ne veut nullement dire que les croyants de ces
nations remplacent entièrement Israël et encore moins que les promesses
nationales de ce peuple sont définitivement écartées.
2 (2) On a critiqué Paul pour avoir dit que des branches de l'olivier
sauvage sont entées sur l'olivier franc, sous prétexte que cela ne se fait pas.
Or cette pratique était parfaitement ,,connue et est encore de nos jours
utilisée en Palestine et même chez nous pour d'autres arbres. Ainsi le poirier
« Doyen du Comice » ne produit habituellement que peu de fruits, mais on a
trouvé qu'en entant sur cet arbre une branche d'une autre espèce tout l'arbre
devient productif. Ce cas est cité par Mr. C. H. Welch dans son livre The
Apostle of the Reconcilialion, p. 211
Page 47
Pendant les Actes, Israël, même
dépouillé de certaines de ses parties au point de vue spirituel, existe
toujours dans son ensemble c à d. comme olivier, comme figuier, comme vigne.
D'autres peuvent avoir part aux bénédictions spirituelles, mais rien ne
remplace ce peuple sous ses aspects nationaux, sociaux et religieux (3). La Parole ne
dit nullement que l'olivier franc, le figuier, ou la vigne sont abattus à la
Pentecôte. Ce qu'on a nommé « l'Église » n'a d'aucune manière remplacé Israël.
Il y a des croyants en Jésus --Christ parmi les Juifs et parmi les Gentils et
si l'on veut désigner leur ensemble par le nom d' « Église », il s'agit ici de
ceux qui ont part à la sphère céleste. Israël, comme peuple, reste toujours
l'élu qui aura comme mission sur terre de devenir bénédiction pour les autres
nations. Dès qu'il se repentira, le Seigneur en fera son église terrestre (Mat.
16 : 18). Ce sont eux qui formeront l'Église « visible » sur terre ; les
autres, même s'ils s'assemblent, ne constitueront jamais cette unité visible du
Royaume sur terre. Pendant les Actes, les Juifs qui, conjointement à un certain
nombre de Gentils, ont part aux bénédictions célestes, nationalement restent
des Juifs, mais spirituellement ne le sont plus. Les Juifs qui croient en
Christ comme leur Messie et restent dans la sphère terrestre, sont l' « Israël
de Dieu » (Gal. 6 : 16), les vrais Israélites (Rom. 2 : 28 ; 9 : 6).
Les Gentils ne sont pas entés
sur l'olivier afin d'éliminer Israël, mais cette greffe a pour but de sauver
Israël comme nation. C'est la dernière tentative pour l'amener à la repentance,
la dernière tentative pour l'avènement du Royaume terrestre. L'olivier était
toujours debout (4).
3 (3) Pendant le Royaume terrestre, Israël rassemble en une seule unité
l'Église (terrestre) et l'Etat. Ceux qui pendant la période actuelle prétendent
remplacer Israël devraient aussi être un « sacerdoce royal » (l Pi. 2 : 9) et
diriger le monde à tous les points de vues. Tous les conflits actuels
culmineront dans celui du temps de l'Antéchrist et prouveront l'erreur
fondamentale de ces " églises ». La seule Église terrestre visible sera
celle que le Seigneur bâtira dans l'âge prochain. Cette Église ne comportera
pas deux groupes, l'un terrestre, l'autre céleste, mais tous les membres seront
sur terre. Les « portes du Hadès » ne prévaudront point : tous les membres de
l'Église ressusciteront et seront sur terre. C'est la seule Église dont le
Messie dit " mon Église ".
(4) Il est peut-être nécessaire
de faire remarquer que pour « chute " en Rom. 11 : il, il faut lire «
faute , comme la version Darby le met en note, Le grec a : « paraptôma »,
traduit couramment par « offense » (Rom. 4 : 25 ; 5 : 15). Leur faute ou
offense était leur manque de foi dans le Seigneur. C'est pour cause
d'incrédulité que des branches sont retranchées (Rom. 11 : 20).
Page 48
Dans
notre chapitre IV nous avons vu comment les représentants d'Israël ont rejeté
leur Messie successivement dans les grands centres. Les principales « branches
» retranchées étaient celles de Jérusalem (Mat. 13 : 11-15), d'Antioche (Actes
13 : 46, 51), de Corinthe (Actes 18 : 6), d'Éphèse (Actes 19 : 9) et finalement
de Rome (Actes 28 : 26-28). C'est la réalisation de la prophétie d'Es. 6 : 9.
Des « branches sauvages » sont entées à leur place (5) et ont part
aux bénédictions abrahamiques, sans empiéter d'ailleurs sur les prérogatives
nationales, sociales et religieuses d'Israël (6).
Quelle est la fin de l'histoire
de l'olivier ? La dernière branche naturelle a été retranchée à Rome à la fin
des Actes. Israël a été rejeté comme peuple, c à d. nationalement. Depuis ce
temps l'olivier (et avec lui les autres « arbres » représentant ce peuple sous
d'autres aspects) a été coupé parce qu'il ne produisait pas de bon fruit (Mat.
3 : 10). Seule la racine (les promesses abrahamiques) reste. C'est la situation
actuelle que nous examinerons de plus près dans notre deuxième partie.
Tant qu'Israël n'est pas de
nouveau accepté comme peuple de Dieu, le symbole des arbres ne peut plus être
utilisé. Il n'y a ni arbre, ni branches. Il ne reste que des individus ayant, par
leur communion avec Christ, part aux bénédictions célestes. Si la racine de
l'olivier représente les promesses abrahamiques, ces croyants en Christ peuvent
tout au plus être représentés par de petites tiges qui poussent sur la racine.
Mais ce n'est pas là la fin de
l'histoire. Un jour l'arbre repoussera et ses rameaux s'étendront (Os. 14 : 6,
7). Israël, après son repentir national, s'appropriera toutes les bénédictions
terrestres promises et les communiquera aux Gentils.
Nous avons représenté cette histoire
par une figure, qui ne nécessite aucune explication après ce qui précède.
5 (5) Voir p. ex. Actes 13 : 48 ; 18 : 10 ; 19 : 10 ; 28 : 28.
(6) Il leur était p. ex. défendu
sous peine de mort d'entrer dans les bâtiments intérieurs du temple. Il y avait
un « mur de séparation » (Eph. 2 : 14).
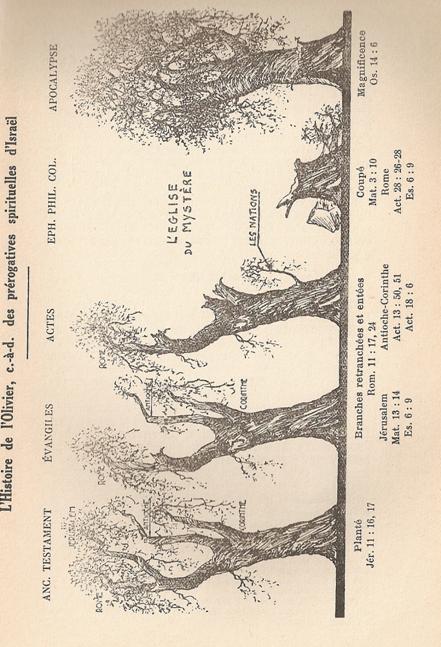
Page 50
Le symbole de l'olivier pourra
nous aider à nous rendre compte de la différence énorme qui existe entre les
circonstances du temps des Actes et celles de la période actuelle. Ce qui est
personnel dans les messages des prophètes, du Seigneur, des Douze, de Paul,
reste toujours indispensable pour tout homme, mais tout ce qui a rapport à la
vie nationale, sociale et religieuse (ainsi, par exemple, toute organisation
visible formant une unité imposante, toute cérémonie religieuse, toute
prescription sociale donnée en relation avec Israël) cesse. Après les Actes on
entre dans l'économie du grand Mystère, qui dépasse tout ce qui se rapporte à
Abraham.
Si notre vision est juste, au
moins dans les grandes lignes, on se rendra compte que l'idée communément
répandue, à savoir que : « L'Église a remplacé Israël », doit introduire
partout la confusion avec ses résultats désastreux.
Dans Le Plan Divin, nous
avons déjà fait allusion à la nécessité de distinguer entre le pardon des
péchés et la justification. La parabole du Roi et des serviteurs (Mat. 18 :
23-35) a servi à nous rendre compte de la manière dont Dieu agit envers le
pécheur. Dès que l'homme se tourne vers Lui et reconnaît son impuissance, Dieu
lui pardonne, c à d. que provisoirement Il ne lui demande pas de payer sa
dette. Le pardon est donc conditionnel, le pécheur devant d'abord croire en
Dieu et se tourner vers Lui. Le pardon est aussi temporaire, il peut être
retiré. En effet, si le pécheur abuse de la situation et n'agit pas
conformément à cette première grâce et aux possibilités qui lui sont données,
Dieu exige de nouveau le payement intégral (1).
Celui auquel les péchés ne sont
que pardonnés (2) n'est pas encore justifié. Il reste pécheur.
1 (1) Ne pas « imputer n'est pas la même chose que remettre. Rom. 4 : 8 et
2 Cor. 5 19 ne concernent pas la rémission des péchés, mais la justification.
En Actes 13 : 38, 39 Paul n'identifie pas ces deux, mais il place la
justification après la rémission des péchés. De même en Rom. 4 : 7, 8.
(2) Nous ne parlons ici que du
mot grec « aphièmi », et pas du pardon complet exprimé par le mot « charizomai
», comme en Eph. 4 : 32.
Page 51
Une personne est justifiée
quand elle est trouvée et donc déclarée sans faute, non coupable. Un coupable peut
recevoir le pardon, mais ne peut pas être appelé juste. Un juste n'a pas besoin
de pardon. Le pardon permet au coupable de changer sa vie, mais n'efface pas le
passe : il reste toujours coupable de ce qu'il a fait. Seule la mort peut
annuler le passé. Tout cela est élémentaire, mais d'importance capitale non
seulement pour comprendre les enseignements de Paul, mais pour ne pas dévier de
la voie du salut. C'est donc essentiel pour celui qui veut aider son semblable.
L'Ancien Testament nous a
appris que l'Éternel ne tient point le coupable pour innocent (3). Cela est-il
changé dans le Nouveau Testament ? Voyons. L'épître aux Romains nous dit que
l'homme est justifié par la foi (Rom. 3 : 28). La foi elle-même n'est pas une oeuvre
(Rom. 4 : 4, 5), mais une grâce. Jamais l'Écriture ne dit que la justification
vient par la foi, dans le sens qu'elle a sa source dans la foi, mais elle dit
que la foi est le moyen par lequel la justification est possible (4). La foi
n'a aucune valeur en elle-même, elle ne peut servir que d'instrument.
Le chapitre IV de l'épître aux
Romains ne nous explique pas comment la foi, qui en elle-même n'a aucune
valeur, peut mener à la justification.
Le cinquième chapitre nous dit
un peu plus : « Nous sommes justifiés par son sang » (Rom. 5 : 9). Nous voyons
immédiatement que la cause de notre justification réside en Christ et, d'une
manière plus précise, dans Son sang.
Mais la solution complète ne se
trouve qu'au chapitre VI où nous remarquons les expressions : « morts au péché
» (v. 2, 10), « c'est en sa mort que nous avons été baptisés » (v. 3), « si
nous sommes devenues une même plante avec Lui » (v. 5), « notre vieil homme a
été crucifié avec Lui » (v. 6), « mort avec Christ » (v. 8). Et le verset 7 dit
(d'après le texte grec) : « celui qui est mort est justifié du péché. » Il n'y
a qu'un seul moyen d'atteindre à la justification : c'est la mort, la mort au
péché, la crucifixion de notre vieil homme, de ce que nous sommes en Adam.
3 (3) Ex. 34 : 7. Il y a bien des choses à dire sur cette traduction, mais
elle exprime exactement la pensée du texte original.
(4) Ceci est clair dans le texte
grec. " Dia » avec l'accusatif veut dire à cause de » ; « dia » avec le
génitif veut dire " au moyen de ou " au travers de ». Or quand il est
question de la justification, c'est toujours le génitif qui est utilisé.
Page 52
Et la foi en Christ (qui est
autre chose que la foi que Jésus est le Christ, le Messie) est le seul moyen
qui nous permettra, par notre communion avec Lui, de mourir ainsi. Par cette
mort seule le passé est effacé, et la nouvelle créature partage la justice du
Seigneur. Considérant sa position devant Dieu, le croyant en christ n'est donc
plus pécheur, mais justifié. Dans La Voie du Salut, nous verrons plus en
détail l'importance de distinguer entre foi et foi. La Parole indique elle-même
ces distinctions et montre que toute foi ne conduit pas de plano à la
justification. Paul seul parle de la foi « en Christ-Jésus » (5) qui fait
partie de la sphère céleste. Cette foi comprend un abandon complet de soi-même
et de tout ce qui est en rapport avec Adam, de tout ce qui est du « Vieil homme
».
Nous voyons donc que
l'affirmation de l'Ancien Testament reste toujours vraie : le coupable n'est
pas tenu pour innocent et ne saurait éviter la punition. Par la foi en Christ
il est baptisé en Sa mort et subit en esprit avec Christ la peine du péché : il
meurt. Lui seul ne peut ni mériter la justification (p. ex. par ses oeuvres),
ni subir la peine. Il ne peut pas crucifier le vieil homme, mais seulement
accepter par la foi, ce que le Seigneur a fait pour lui en mourant sur la
croix. Par la communion en cette mort, il quitte l'ancienne humanité d'Adam et
entre, « en Christ-Jésus », dans la nouvelle création.
Que l'on ne s'imagine donc pas
que Dieu ferme les yeux sur le péché, que Son amour est si grand qu'Il justifie
sans jugement. Ce serait Le rendre injuste. Il faut maintenir d'une manière
absolue aussi bien la Justice que l'Amour de Dieu et l'unique solution, la
solution divine, c'est Christ. Lui est mort pour nous permettre de mourir, non
en suivant Son exemple, mais en mourant avec Lui. Il a porté nos iniquités,
mais nous devons partager en esprit le supplice et cela est possible par la foi
en Lui.
Tout cela n'est pas symbole,
mais réalité spirituelle profonde. Ne soyons pas matérialistes et ne tenons pas
seulement pour réel ce que nous voyons se passer dans le temps et qui ne peut
être dès lors que partiel, douteux et relatif. Ce n'est que dans le domaine spirituel,
dans l'absolu, que nous pouvons vraiment mourir avec Christ. Et là le temps
n'existe pas.
5 (5) Nous nous référons au texte grec.
Page 53
Que la mort de Christ ait,
suivant les données humaines, eu lieu il y a 1.900 ans, n'empêche en rien notre
participation spirituelle à Sa mort (6).
Nous espérons que le lecteur
voudra bien convenir que la justification dépasse de loin le pardon des péchés.
La mort avec Christ est une étape importante dans la voie du salut. Le pardon
concerne la marche du régénéré, la justification concerne une nouvelle
position. Le juste est mort au péché, séparé d'Adam, du vieil homme (7). Les
Douze proclament le message de la nouvelle naissance et du pardon. Paul va plus
loin et parle pendant la période des Actes de la justification et de la
nouvelle création. La nouvelle naissance reste dans la sphère terrestre et dans
l'ancienne humanité adamique, la nouvelle création concerne le groupe céleste
et atteint la sphère supérieure en Christ. Au point de vue personnel, tout homme
doit passer par la nouvelle naissance avant d'atteindre la justification et
devenir une nouvelle création par sa mort avec Christ. Il est alors délivré de
l'esclavage, justifié du péché, « en Christ-Jésus ».
Selon le cours normal du
dessein de Dieu, le monde aurait passé tout entier à la nouvelle naissance
avant que la nouvelle création eût été proclamée. Tous auraient eu un corps
changé ou ressuscité avant d'entrer dans la nouvelle sphère. Ils auraient
atteint l'adoption comme « Fils » lors de la rédemption de leur corps (Rom. 8 :
23). L'endurcissement d'Israël a eu comme conséquence que la sphère céleste a
été pleinement accessible avant la régénération mondiale, avant le changement
ou la résurrection. Il s'ensuit un état anormal : notre corps est encore
humilié et dans la sphère terrestre adamique, tandis qu'en esprit nous pouvons
déjà être placés dans la sphère céleste.
6 (6) On pourrait comprendre jusqu'à un certain point l'idée du «
sacrifice perpétuel » inclus dans la messe romaine, si l'on insistait
exclusivement sur le fait spirituel. Malheureusement l'insistance mise sur la
présence réelle et matérielle, condamne d'autant plus cette pratique, qui au
surplus imite la Pâque juive.
(7) Ceci ne veut pas dire que le
péché est mort en lui, qu'il est sans péchés. Celui qui croit en Christ est,
par. la communion ainsi établie, mort au péché et donc juste. Ceci concerne sa
position , en Christ-Jésus ». Mais il n'est pas parfaitement saint selon sa
marche. il est mort en esprit, mais sa chair n'a pas eu part à cette mort et
reste le siège du péché. Mais celui-ci ne doit pas dominer. Nous développerons
ceci dans La Voie du Salut.
Page 54
De là des souffrances, des
soupirs (8).Nous terminerons cette note concernant la justification en attirant l'attention
sur le fait que le mot « justice » a plusieurs significations dans la Parole,
de Dieu. Il y a d'abord la justice absolue, qui est opposée au péché. C'est une
conformité absolue à la norme de Dieu. À ce point de vue, il n'y a qu'un seul
juste : Le Seigneur Jésus-Christ (1 Jean 2 : 1). Mais en esprit nous pouvons
atteindre cette justice, par la foi en nous établissant dans cette position en
Christ. Paul seul parle de la justification dans ce sens.
Il y a ensuite une justice
relative. Tout homme, qui fait son devoir, correspondant à la position qu'il
occupe, est relativement juste. L'enfant (Eph. 6 : 1) et le non-croyant (Actes
10 : 35, etc.) même peuvent, dans ce sens, pratiquer la justice. Ce n'est là
qu'une justice toute relative aux hommes. Pour le croyant il y a des degrés de
justice et Pierre parle d'une « voie » de la justice (2 Pi. 2 : 21). Cette
justice relative a donc rapport à la marche et non à la position.
Le cinquième éon est
spécialement celui de la justice. Pierre dit en effet que la justice habitera
dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre (9). Pierre et Jean ne parlent
qu'exceptionnellement de la justice et encore, quand ils parlent du présent,
est-ce dans le sens relatif c à d. de la justice consistant à faire ce qui est
imposé dans la position et les circonstances où l'on se trouve momentanément.
Nous nous proposons d'examiner
la question de la justification plus en détail dans La Voie du Salut.
On connaît l'opposition que
Paul fait entre le premier homme « Adam » et le second homme « Christ « (1 Cor.
15 : 45-49). Il y a aussi deux humanités dérivant d'eux, l'une désignée par «
le vieil homme » (Rom. 6 : 6 ; Eph. 4 : 22 ; Col. 3 : 9) et l'autre par «
l'homme nouveau » (Eph. 2 : 15 ; 4 : 24). L'une est sous l'empire du péché,
esclave, l'autre est justifié du péché, libre.
8 (8) Voir p. ex. Rom. 8 - 18-23.
(9) 2 Pi. 3 : 13. Voir Le
Plan Divin pour les cinq « éons » ou âges.
Page 55
Tandis qu'Adam et la vieille
humanité appartiennent à la première création, Christ et la nouvelle humanité
font partie de la nouvelle création (2 Cor. 5 : 17 ; Gal. 6 : 15).
Notons ce point important, que
Paul seul parle de la nouvelle création et du nouvel homme. C'est la base de
son évangile. Il nous fait connaître, que le passage de l'ancienne humanité à
la nouvelle, s'est fait à la croix. Tout homme, déjà régénéré, qui par sa foi
et sa communion avec Christ abandonne ce qui concerne le « vieil homme », est
mort avec Christ, baptisé dans sa mort, mort au péché. Il a quitté en esprit la
vieille humanité parce qu'il a pris part en esprit au crucifiement du « vieil
homme ». Il est ainsi justifié et appartient à la nouvelle création. Là il n'y
a plus de Juif ni de Gentil (Gal. 3 : 128 ; 6 : 1,5). Il est « en Christ-Jésus
».
Nous voyons la différence
radicale entre l'évangile propre à Paul et celui des Douze pour la
circoncision. La mission particulière de ces derniers est d'amener Israël à se
repentir en tant que nation et à croire que Jésus est le Christ, c à d l'Oint,
le Messie. C'était la condition nécessaire pour la venue du Royaume sur ferre.
Or ce Royaume et tout l'âge prochain appartiennent encore à l'ancienne
création. La nouvelle création, non seulement spirituelle, mais englobant tout
le monde, ne commence qu'au cinquième éon.
Le message de la croix relatif
au passage d'une humanité et d'une création à l'autre n'est touché dans aucune
épître de Pierre, Jean, Jacques ou Jude, à part les quelques références qui se
rapportent à l'avenir, au cinquième éon. Leur mission se bornait à réaliser le
dessein de Dieu concernant Israël, les prophéties, relatives au règne terrestre
et la nouvelle naissance du monde. Dans cette sphère, Israël est nettement
séparé comme peuple choisi de toute autre nation. Les douze tribus sont le
moyen de choix divin pour répandre sur terre les bénédictions promises par
lesquelles commencera la restauration universelle. On voit par là qu'il était
impossible aux Douze et à ceux qui étaient en rapport avec eux, de proclamer
l'évangile de Paul qui dépasse cette étape et se rapporte déjà à la nouvelle
création où il n'y a plus ni Juif, ni Gentil, où il n'y a plus de nationalité,
plus de sexe, plus de « religion », plus de race. Paul proclame ce message en vue
de l'endurcissement d'Israël et en partie pour exciter la jalousie de ceux de
sa race.
Page 56
La sphère nouvelle n'est pas
ouverte pour fermer la sphère terrestre, mais au contraire pour en hâter la
manifestation. Le message de Paul n'atteindra actuellement que quelques hommes,
sa pleine réalisation pour le monde entier ne pourra avoir lieu que si ce monde
est d'abord passé, par le moyen d'Israël, par la nouvelle naissance. Ce n'est
qu'après le Royaume terrestre que viendront le nouveau ciel et la nouvelle
terre et que Dieu pourra habiter avec les hommes sans distinction, parce qu'ils
ne seront plus pécheurs, mais justifiés. Le message de Paul, d'individuel et
d'exceptionnel doit devenir universel. Toute la vieille humanité devra un jour
être crucifiée et passer à la nouvelle humanité.
On voit ainsi peut-être encore
mieux l'erreur formidable de la majorité des chrétiens qui croient remplacer
Israël pendant ce mauvais âge, où Satan est le « dieu »... On arrive fatalement
ainsi à une confusion totale. Pour remplacer Israël, les chrétiens devraient
assumer la mission d'Israël, ce qu'en effet d'ailleurs ils veulent faire en
partie. Mais alors ils restent dans l'ancienne création et dans la sphère
terrestre. Or, là les nations, loin d'avoir la promesse de pouvoir remplacer
Israël, ne peuvent être bénies que par Israël. S'ils remplaçaient Israël, ils
devraient dominer le monde et l'autorité politique devrait être entre leurs
mains.
Mais dira-t-on, peut-être
est-il possible d'admettre que Jean p. ex. soit resté dans la sphère du vieil
homme, qu'il n'était pas « en Christ-Jésus » et n'aurait donc pas atteint la
nouvelle création ? Et comment peut-on admettre que le Royaume terrestre soit
encore soumis au péché et dans l'ancienne création ? Évitons de nous baser sur
nos sentiments, essayons de nous débarrasser de toute tradition non
scripturaire et soumettons-nous exclusivement aux Écritures. Jean ne parle
jamais de la nouvelle création ni de l'homme nouveau. L'expression « en
Christ-Jésus » lui est étrangère. Il parle à peine de la justification, et dans
ces rares occasions, il n'utilise pas ce mot dans le sens où Paul le prend
habituellement et où l'homme est mort au péché. Jean ne parle que de la
justification relative (1) et se limite au pardon des péchés et à la nouvelle
naissance.
1 (1) Voir le chapitre concernant la Justification, voir aussi La Voie
du Salut. Jacques parle aussi de la justice relative que l'on peut
atteindre par une marche conforme à certaines prescriptions.
Page 57
Il ne parle pas de la
réconciliation (2), mais se tient à la « victime expiatoire » (3) qui «
couvre » le péché. Il ne connaît pas le pardon complet (4), mais seulement le
pardon conditionnel (5). Il n'envisage que très partiellement la puissance du
sang du Seigneur, puisqu'il se limite à la purification cérémonielle dans le
sens de l'Ancien Testament (6). Il ne connaît que l'état d' « enfant » de Dieu
et ne mentionne en tout cas pas l'adoption comme « fils ».
Pour passer de l'ancienne
humanité à la nouvelle, il faut être crucifié avec Christ, et Jean, ni aucun
autre apôtre de la circoncision, ne parle de la croix en relation avec le
croyant !
On a trop souvent oublié que
Jean est un des Apôtres de la circoncision et qu'il ne s'adresse qu'à des Juifs
chrétiens. Si l'on compare attentivement son message avec celui de Paul, on
sera frappé par la différence et l'on se rendra compte que Jean est resté dans
la sphère où sa mission devait s'exercer.
Tout cela n'empêche que ce qui
est personnel dans ses écrits, et par conséquent applicable à tous les hommes,
est très nécessaire et très utile. Mais il se limite à la nouvelle naissance.
Pour progresser dans la voie du salut, il faut continuer avec Paul et atteindre
la justification, la nouvelle création et même aller plus loin. Jean, ainsi que
les autres apôtres de la circoncision, se limite à rappeler ce qui avait déjà
été révélé (7).
Voyons maintenant la deuxième
objection concernant la situation des « chrétiens » sur terre pendant le
Royaume. Ils ne peuvent pas dire avec Paul : « La loi de l'esprit de vie en
Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » (Rom. 8 : 2).
Ils doivent suivre la loi dans toutes ses cérémonies, pour autant qu'ils sont
Juifs, et ils restent soumis au péché. Mais ils ont l'offrande de réelle
efficacité, celle de Christ, qui peut les purifier du péché quand ils
confessent leurs péchés (1Jean 1 : 8, 9). Dans l'éon à venir Satan sera lié et
l'anathème ôté de l'ancienne création.
2 (2) Katallassô ou Apokatallassô.
(3) Hilasmos, 1 Jean 2 : 2 ; 4 :
10.
(4) Charizomai, comme en Eph. 4:
32.
(5) Afiemi, comme en Mat. 18
27-35.
(6) Comparer 1 Jean 1 : 7 et 2 :
2 avec Lev. 16 : 30.
(7) Voir p. ex. 2 Pi. 1: 12;3 :
2; l Jean 2 : 7,21,24; 2 Jean 5 ; Jud. 5.
Page 58
La présence du Messie,
d'Abraham, des douze Apôtres, la nouvelle alliance de grâce, la justice
immédiate, les puissances spirituelles de cet âge, tout rendra possible une
marche dans la lumière. Mais les « chrétiens » de cet âge restent dans la
sphère terrestre de la nouvelle naissance et n'atteignent la nouvelle création
qu'à la fin du quatrième éon. Des individus, Juifs et Gentils pourront sans
doute abandonner le vieil homme et mourir avec Christ. Les Juifs pourront
abandonner leurs prérogatives nationales. Laissant en arrière ce qui concerne
Adam, ils pourront venir en communion avec Christ par la foi en Lui. Mais de
longs siècles seront nécessaires pour amener librement le monde entier à
atteindre ce qui se rapporte à la nouvelle création. La liberté seule explique ces
longs délais. Si Dieu traitait ses créatures comme des automates ou des
pantins, le but devrait être atteint tout de suite.
Beaucoup de problèmes restent à
examiner, nous le savons, mais nous ne pouvons actuellement qu'esquisser les
choses en laissant au lecteur le soin d'en compléter l'examen. Pour ce qui
concerne le côté individuel, nous nous proposons d'y revenir dans La Voie du
Salut.
10.
Résumé de la Période des Actes.
Dans Le Plan Divin, nous
avons déjà fait remarquer que tout ce qui arriva et fut proclamé pendant la
période des Actes était déjà connu, en grandes lignes, par Moïse et les
Prophètes. Nous nous en rendrons mieux compte maintenant.
Cette période aurait dû
conduire au Royaume terrestre. Israël aurait dû se repentir et arriver ainsi à
la nouvelle naissance en tant que nation. Voilà le but des Douze. Les
prophéties commençaient à se réaliser et ce qui arrivait de ce temps aurait dû
culminer dans la venue glorieuse du Messie et du Royaume. Toutes les épîtres
écrites pendant les Actes sont imprégnées de cette atmosphère.
Mais Israël refuse de se
repentir et ne croit pas que Jésus est le Christ. Paul, qui avant tout adresse
le message du Royaume aux Juifs de la dispersion, de ville en ville se tourne vers
les Gentils lorsque ceux de son peuple n'acceptent pas la bonne nouvelle du
Royaume. Il leur montre que si leur endurcissement bloque la voie normale,
s'ils ne se mettent pas dans la condition voulue pour amener la nouvelle
naissance mondiale, la voie individuelle reste ouverte : foi en Dieu comme
Créateur, conversion et foi en Jésus-Christ.
Page 59
Il ne s'arrête pas à la
nouvelle naissance, mais ouvre une nouvelle sphère, celle de la nouvelle création
et parle de réconciliation, de justification, d'adoption comme fils. Ce message
individuel et supranational dépasse la sphère terrestre et est le sujet
principal des épîtres qu'il écrit pendant les Actes. Il invite à abandonner
tout ce qui se rapporte à Adam et à passer de l'ancienne humanité à la nouvelle
où l'on est « en Christ-Jésus » et, par la mort, justifié du péché.
Il est de première importance
de se rendre compte qu'Israël est toujours en ce temps le peuple élu de Dieu et
que le Royaume continue à être proclamé. Si des Gentils ont individuellement
part aux bénédictions spirituelles, à la nouvelle naissance et même à la
nouvelle création, cela ne veut pas dire qu'ils prennent la place d'Israël au
point de vue national et réalisent ce que les prophètes ont annoncé. Israël
seul a une mission sur terre en rapport avec la bénédiction mondiale des
nations. Mettre ce qu'on nomme « l'Église » à la place d'Israël, c'est
confirmer l'erreur fondamentale qui a tout embrouillé.
Les Juifs chrétiens restent
toujours Juifs au point de vue national et sont tenus de suivre la Loi, de
garder toute la « religion » juive, d'observer les fêtes, les cérémonies et de
maintenir une organisation visible, instituée par Moïse et complétée par les
Douze. À ce point de vue, il y a une séparation nette entre le Juif chrétien et
le Gentil chrétien. Ce dernier ne peut avoir aucune part aux cérémonies et
fêtes juives, à moins de se faire circoncire et d'être ainsi incorporé
nationalement en Israël. Que l'on se rende bien compte que le Gentil n'a part
qu'aux bénédictions spirituelles et que rien ne lui permet de s'approprier une
organisation ou des cérémonies données par Dieu à Israël. Les seules
prescriptions qui lui sont faites, spécialement en vue de rendre possible une
vie commune entre chrétiens juifs et gentils, c'est de « s'abstenir des viandes
sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité » (1).
1 (1) Actes 15 : 28, 29. Ces prescriptions rappellent bien plus Lév. 17 :
10 et les sept prescriptions que les Juifs donnaient aux prosélytes que Gen. 9
: 4. Il va de soi que certaines sont justes et toujours valables, mais d'autres
ne le sont pas. Voir p. ex. 1 Cor. 8 : 1-13.
Page 60
Les épîtres écrites pendant les
Actes parlent nécessairement de beaucoup de choses particulières à ce temps et
adaptées à la position qu'Israël occupait encore. Lorsqu'il était question de
cérémonies pour les chrétiens de ce temps, il était évident que cela ne
s'appliquait qu'aux Juifs chrétiens. Les épîtres mêmes contiennent d'ailleurs
des indications qui peuvent nous mettre en garde contre une fausse application
de ces cérémonies. Nous ne rappelons qu'un cas de ce genre : avant de parler
des cérémonies des chapitres X et XI, Paul a soin, dans sa première épître aux
Corinthiens, de préciser qu'il s'adresse en cet endroit aux chrétiens juifs : «
Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la
nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés
en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment
spirituel... » Or les « pères » ou patriarches appartiennent à Israël seulement
(Rom. 9 : 4-5).
L'épître aux Hébreux, celles de
Jacques, Pierre, Jean et Jude sont uniquement adressées à des Juifs chrétiens.
S'il est certain qu'une partie des messages qui y sont contenus concerne
n'importe quel chrétien, il n'est pas moins certain qu'elles contiennent des
indications relatives à la position nationale et religieuse d'Israël qui ne
sont pas applicables aux Gentils. Ces épîtres restent d'ailleurs toujours dans
la sphère du « vieil homme » et n'atteignent pas la position « en Christ-Jésus
» où l'on est justifié du péché.
Les épîtres de Paul aux
Romains, Corinthiens, Galates et Thessaloniciens s'adressent en général à tous
et (à part la première aux Corinthiens et celles aux Thessaloniciens)
concernent plus particulièrement ce qui doit suivre après la nouvelle naissance
: la réconciliation avec Dieu, la mort avec Christ et au péché, la
justification et la nouvelle création. Cependant, comme Paul s'adresse aussi à
des Juifs chrétiens qui se trouvent dans ces églises locales et que ceux-ci
sont encore nationalement des Juifs et sont tenus de suivre la Loi tant qu'ils
restent en contact avec les choses terrestres, ces épîtres contiennent aussi
des indications qui ne s'adressent qu'à eux et qui n'ont plus cours aussitôt
qu'Israël est dans la réprobation. De plus, comme la période où le Royaume est
encore proche est caractérisée par les puissances de l'âge prochain, ces
épîtres parlent de pratiques et de dons spéciaux qui ne cadrent pas avec les
circonstances des temps actuels, où Israël est mis de côté nationalement.
Page 61
On se rendra donc compte que
tout le Nouveau Testament est utile (aussi bien que tout l'Ancien Testament),
mais que tout ne s'adresse pas à nous.
Tout ce qui tombe dans la
période des Actes est le développement des promesses abrahamiques. Aussi bien
la nouvelle naissance que la justification par la foi font partie de ces
alliances. La postérité céleste était aussi bien promise à Abraham que la
postérité terrestre (2).
La sphère terrestre, ayant
comme caractéristique la nouvelle naissance s'épanouira pendant l'âge prochain
(le quatrième éon). La sphère céleste s'étend dans l'univers, après avoir
absorbé ce qui est terrestre, pendant le cinquième âge. Tout ce qui est
enseigné pendant les Actes fait donc partie des éons et du dessein éonien de
Dieu (3). L'âge prochain, celui de la nouvelle naissance, est encore dans le
péché, de même que le croyant né de nouveau est encore appelé pécheur. L'âge de
la nouvelle création est celui de la justification, il est hors du péché, mais
n'est pas encore parfait. La perfection est réservée au moment où le but est
atteint : « Dieu tout en tous. » (1 Cor. 15 : 28). Là nous sortons des éons,
nous atteignons, l'incréé. Nous ne sommes pas seulement dans la sphère de
Christ, mais nous sommes identifiés avec Lui, nous sommes Ses membres.
Tout ce qui est connu pendant
les Actes rentre donc dans le cadre de la révélation de l'Ancien Testament et
des éons. Certes, il y a développement, révélation supplémentaire de parties
inconnues, mais le fond ne dépasse pas les sphères de bénédictions terrestres
et célestes (4).
Voyons maintenant le message de
Paul après les Actes.
2 (2) Voir Le Plan Divin, p. 30 et suiv.
(3) Eph. 3 : 11 « dessein
éternel ». Voir Le Plan Divin pour ce qui concerne les éons.
(4) Ceux qui ont de la peine à
concevoir que Paul puisse dépasser Jean, auront de la difficulté à se rendre
compte que l'apôtre des Gentils s'est surpassé lui-même et il serait désirable
qu'ils se familiarisent mieux avec ce qui précède, et surtout qu'ils puissent
vivre ces choses, avant de continuer la lecture des chapitres suivants.
Page 62
Après les Actes
1.
Les quatre Épîtres écrites en Prison.
Nous examinerons maintenant les
épîtres que l'apôtre Paul a écrit après la période des Actes et spécialement
celles aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens et la deuxième à Timothée. Une de
leurs caractéristiques est d'avoir été écrites en prison (1). Il y a une
certaine correspondance entre ces quatre épîtres et nous ne pouvons mieux faire
que de traduire un tableau préparé par Mr. Welch à ce sujet (2).
Les
Épîtres écrites en Prison
Structure montrant leur doctrine caractéristique
et leurs correspondances.
A. Éphésiens Mots-clés*
Assis
ensemble La dispensation (3 : 2,
9). Mystère (3 : 3 ; 5 : 32).
L'Église
qui est Son Corps (1 : 22-23).
La plénitude (l : 23 ; 4 : 10). Christ le Chef (l : 22).
Autorités
et puissances (l : 21).
B.
Philippiens Mots-clefs
Le prix Le discernement des choses (l : 10).
Combattre
(l : 27). Courir vers le but (3 : 14).
Prix
(3 : 14). Départ (°) (l : 23). Libation (2 : 17).
A. Colossiens Mots-clefs *
Perfection en Lui Dispensation (charge) (1 : 25). Mystère (1 : 26).
L'Église
qui est Son Corps (1 - 24).
Plénitude
(1 : 19). Christ le Chef (2 : 19).
Autorités
et puissances (1 : 16 ; 2 : 10).
B.
2 Timothée Mots-clefs
La couronne Dispenser (diviser) droitement la Parole (2 : 15).
Combattre
(2 : 5). Achevé la course (4 : 7).
Couronne
(4 : 8). Départ (°) (4 : 6). Libation(°) (4 : 6).
* Aucune de ces expressions ne se trouve en Phil. et 2 Tim.
(°) Les seuls endroits où ces mots sont utilisés dans les épîtres de Paul.
1 (1) Voir Eph. 3 1 ; 4 : 1 6 19, 20 ; Phil. 1 : 7, 13, 14, 17 ; Col. 4 :
3, 10, 18 2 Tim. 1 8 2 : 9 ; 4 : 16. Ceci n'est qu'une simple remarque, non
essentielle à notre thèse. Voir aussi App. 3.
(2) Voir p. 11 de The
Testimony of the Lord's Prisoner
Page 63
Avant
d'examiner de plus près ces épîtres, nous relèverons certains indices qui
montrent qu'à la fin des Actes Paul avait achevé son message céleste. Ainsi,
quand il prend congé des anciens d'Éphèse à Milet (Actes 20 : 17), il leur dit
: « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile... annonçant
aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur
Jésus-Christ. » Et ensuite : « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans
en rien cacher » (3). Tout ce qui concerne la nouvelle naissance et la
justification avait été enseigné par Paul, rien n'était caché. Il confirme
d'ailleurs que ceci ne dépasse pas Moïse et les prophètes : « Rendant
témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que
les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver... » (Actes 26 : 22). Tout ce
qu'il a écrit dans ses épîtres de la période des Actes, c-à-d. celles aux
Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Thessaloniciens, vient sous cette
catégorie.
De plus, il fait allusion à un
nouveau message :
« Mais je ne fais pour moi-même
aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse
ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus,
d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » (Actes 20 : 22-24).
Nous voyons dans sa dernière épître (la deuxième à Timothée) que là il a achevé
sa course (2 Tim. 4 : 7). La grâce de Dieu allait plus loin que la nouvelle
création, le but étant « Dieu tout en tous ». Il lui restait donc à compléter
le message de la grâce et dans son épître aux Éphésiens il parle de cette
nouvelle dispensation de la grâce de Dieu (Eph. 3 : 2), qui compléterait la
Parole de Dieu (Col. 1 : 25 Darby). Paul a eu de multiples révélations et le
Seigneur ne lui est pas seulement apparu dans le chemin de Damas, mais aussi
après (Actes 26 : 12-16). Examinons donc cette plénitude de grâce, ce salut de
Dieu, qui a été envoyé aux Gentils (Actes 28 : 28) après qu'Israël a été écarté
comme nation.
Nous prions le lecteur de se
souvenir que nous ne faisons que jeter un coup d’oeil sur ces matières. Il
faudrait des volumes pour les approfondir.
3 (3) Remarquer que « conseil » est la traduction de « boulè » et non de «
prothesis », traduit par « dessein » en Eph. 3 : 11.
Page 64
La question qu'il convient de
traiter avant tout est celle de savoir si les enseignements de Paul, donnés
après les Actes, ne sont que l'épanouissement de son évangile proclamé pendant
les Actes, ou si c'est un autre message. Nous sommes persuadés que c'est une
chose nouvelle, qu'il s'agit ici d'une nouvelle sphère de bénédictions, d'une
nouvelle position à atteindre, de la perfection qui dépasse la création et les
éons. Évidemment, dans un sens, cet enseignement est la continuation des
messages précédents. Nous avons vu dans Le Plan Divin comment Dieu
arrive à Son but par les éons et il est évident qu'un âge suit l'autre et que
le tout est couronné par la perfection. Il y a donc suite, développement. Mais
ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce développement n'est pas toujours
graduel. Un âge diffère complètement de l'autre, il y a des changements
brusques. De même le croyant doit progresser individuellement dans le chemin du
salut, mais cela se passe par étapes. La nouvelle naissance est un jalon bien
défini : d'homme naturel on devient enfant de Dieu. La mort avec Christ en est
un autre : de pécheur on devient juste, de l'ancienne création on passe à la
nouvelle. Nous nous sommes efforcés de montrer que pendant la période des
Actes, Paul avait ouvert une nouvelle sphère de bénédictions, qui faisait suite
à la sphère terrestre, mais en différait complètement. Il s'agit maintenant de
savoir si après les Actes, Paul parle toujours de la sphère céleste, s'il ne
fait que compléter cet enseignement en communiquant aux croyants des
révélations supplémentaires, ou s'il parle d'une nouvelle, d'une troisième
sphère. Si le message des Douze était en correspondance avec la nouvelle
naissance, l'âge prochain et la sphère terrestre, et si celui de Paul pendant
les Actes concernait la nouvelle création, le cinquième âge et la sphère céleste,
il s'agit de voir si le message de Paul, après les Actes, n'atteint pas l'Homme
parfait, l'état où Dieu est tout en tous, une sphère en dehors des éons (1). Voilà la
question. Avant d'aller plus loin, il est indispensable que le lecteur se
familiarise avec ce que nous avons exposé jusqu'à présent. Nous faisons une
exploration, nous voulons distinguer les choses, or plus elles sont élevées et
plus il devient difficile de les distinguer.
1 (1)Voir les schémas p. 22 et 74.
Page 65
Tout au moins pour celui qui
reste en bas (2).
Quand nous examinons les quatre
épîtres, écrites par Paul après la période des Actes, nous rencontrons des
choses nouvelles, exprimées par des mots nouveaux. Ainsi p. ex. :
Eph. 1 : 3. Bénis de toutes
sortes de bénédictions spirituelles dans les « sur célestes ».
Eph. 2: 16. La réconciliation
parfaite (apokatallassô).
Eph.1: 7. La rédemption
parfaite (apolutrôsis).
Col. 2 :10. La perfection.
Eph.1: 3 ; 2 : 6. Dans les «
sur célestes ».
Col. 3: 3. Christ notre vie,
cachée en Dieu.
Eph.3: 6. Un même corps
(sussôma).
Phil. 3:11. La «
hors-résurrection » (exanastasis).
a)
Une nouvelle unité. -La Parole
parle de plusieurs « unités ». Il y a d'abord celle d'Israël comme peuple de
Dieu : c'est une unité terrestre qui se réalisera dans l'âge prochain quand
Jéhovah-Christ habitera « éternellement » au milieu d'eux (Ezéch. 43 : 7 ;
Soph. 3 : 15-17) et quand le nom de la « ville » sera l'Éternel est ici (Ezéch.
48 : 35).
2) (Le message que Paul donne
dans ses dernières épîtres ne peut être saisi, dans ce qu'il a de spécial et d'élevé,
par un croyant se trouvant au commencement de la voie du salut. Les choses
lointaines sont alors comme enveloppées d'un brouillard et ce qui est en
réalité distinct semble se confondre. Il faut progresser. Non seulement en
connaissance, mais progresser avec tout notre esprit, notre âme et notre corps.
Il faut vivre sa foi pour voir les choses de plus près et pour distinguer. Nous
ne voulons pas dire par là qu'il faut nécessairement beaucoup de temps pour
arriver à ce résultat. Le chemin peut être parcouru rapidement. On peut pour
ainsi dire brûler les étapes et avoir l'impression qu'on a atteint sans
préparation la position parfaite, quoique ce cas semble plutôt rare.
Certains diront qu'il ne faut pas
faire toutes ces distinctions, que tout le Nouveau Testament s'applique à tous.
Il est à craindre que ceux-là ramènent à un niveau inférieur ce qui les
dépasse. Nous ne ferons que leur rappeler que le Seigneur ne pouvait pas encore
dire tout quand Il était sur terre et que Paul non plus ne pouvait pas toujours
donner de la nourriture solide (1 Cor. 3 : 1, 2). Pierre même reconnaît qu'il y
a des points « difficiles à comprendre » dans les messages de Paul (2 Pi. 3 :
16). La Parole de Dieu n'est pas un chaos d'où l'on peut tirer un texte
quelconque et se l'appliquer de plano. Il y a un développement logique et il
est nécessaire de distinguer ce qui diffère et de , dispenser (ou de diviser)
correctement la parole de vérité ». Le croyant a un culte logique (Rom. 12 : 1)
et ne doit craindre aucune objection, aucune critique, pourvu qu'il garde toute
la Parole, et la divise correctement. Mettre tout au même niveau, méconnaître
ce qu'on pourrait appeler la hiérarchie des éléments divers de la Révélation,
c'est créer des difficultés, des contradictions, d'où l'indifférence, la
critique, l'incrédulité, l'antichristianisme. Nous insistons sur le danger de
ne pas distinguer les dispensations, les messages, les positions, les éons, les
sphères. Ce n'est pas là chose indifférente ou accessoire. Dieu nous a doués de
l'intelligence pour nous en servir et Paul nous donne l'exemple. Lorsqu'on
lâche la bride au sentiment et à l'émotion, le désastre est au bout. Nous
répétons que nous ne voulons négliger aucune de nos facultés, mais qu'il faut
un équilibre. Pas de connaissance réelle sans charité, pas d'amour conforme aux
Écritures sans connaissance. Si Dieu nous a donné toute la Bible et non
quelques versets favoris, c'est que cela était nécessaire. Négliger l'étude de
Sa Parole, c'est, dans un certain sens critiquer le conseil de Dieu. Là où il y
a l'amour des Écritures, les hommes les plus " simples" peuvent
obtenir une connaissance surprenante, qui peut rester inaccessible à ceux qui
font de longues études ou se laissent guider par le sentiment « religieux ». Ce
n'est pas notre effort personnel qui compte, mais Dieu agit, pourvu que nous le
Lui demandions et que nous montrions vraiment le désir de Sa grâce en faisant
usage des facultés qu'Il nous a déjà données.
Page 66
Il n'y aura plus alors de
séparation entre les douze tribus. Il y aura une unité, une Église visible, qui
sera en bénédiction à toute la terre.
Et puis il y a le groupe
céleste, qui est « un » en Jésus-Christ (Gal. 3 : 28). Les croyants qu'il
comporte sont « ensevelis » avec Lui, sont « une même plante » avec Lui, sont «
crucifiés » avec Lui, sont « morts » avec Lui (3). Ils ont tous « été baptisés
dans un seul Esprit, pour former un seul corps » (l Cor. 12 ; 13). Ce corps
était « de » Christ (4), Lui appartenait. Ils étaient « à » Christ (Gal. 3 :
27-29).
Mais dans ses dernières épîtres
Paul parle d'une autre unité encore, dont la communion avec le Christ-Jésus est
parfaite. Les croyants dont il s'agit maintenant sont « rendus à la vie » avec
Christ, « ressuscités avec Lui », Dieu les « a fait asseoir ensemble dans les
(lieux) sur célestes en Christ Jésus » (5).
(3) Rom. 6 : 4-8. La résurrection est dans
l'avenir.
(4) 1 Cor. 12 : 27. Le texte
grec ne dit pas qu'ils sont le corps de Christ, mais simplement corps de
Christ, une assemblée Lui appartenant. Ainsi la femme est « corps » de l'homme
parce qu'elle lui appartient, mais elle n'est pas le corps de l'homme. Le mot
" corps » ne signifie pas plus, en 1 Cor. 12, que le « corpus » latin, le
mot juridique pour désigner une association. Pour les lecteurs, qui
désirent un témoignage humain, nous pouvons citer Sabatier : " Le nom de
sôma acquiert une signification transcendante qu'il n'avait point auparavant ;
Paul ne dit plus « sôma Christou " mais, dans un sens absolu « to sôma
Christou ». Dans la première manière de parler, Christou est un génitif
objectif ; dans la seconde, c'est un génitif subjectif. » (L'Apôtre
Paul, p. 257.)
(5) Eph. 2 : 5, 6 ; Col. 2 : 12,
13. Il s'agit ici de faits actuels et non futurs.
Page 67
Ceci dépasse ce qui est dit du
groupe céleste et nous avons ici une unité parfaite, « un seul corps » (Col. 3
: 15 ; Eph. 3 : 6 ; 4 : 4), « un seul homme nouveau » (Eph. 2 : 15), « un seul
Esprit », « une seule espérance », « une seule foi », « un seul baptême » (Eph.
4 : 4, 5). Il n'y a pas là une unité visible, matérielle, mais une unité
réelle, spirituelle (6).
b) Un
nouveau mystère. - Paul parle dans ces épîtres, écrites en prison, non
de mystères concernant le Royaume des cieux ou la position céleste, mais du
grand mystère (Eph. 5 : 32), qui fut caché pendant les éons en Dieu (7), mais
manifesté maintenant, c à d. après les Actes, à ses saints (8). Paul l'appelle
« le » mystère, en contraste avec « le mystère de Christ » (9). Ce dernier
comprend le grand mystère et tous les autres mystères et englobe ainsi toute la
Bible. La Parole est une révélation graduelle du mystère de Christ et Paul peut
donc dire qu'au moment où il fait connaître « le » mystère, le mystère de
Christ est révélé d'une façon plus complète qu'il ne l'a été aux générations
précédentes.
Le passage parallèle de
l'épître aux Colossiens (8) indique que c'est ainsi qu'il faut comprendre le
texte. Il y est dit formellement : « le mystère caché aux éons et aux
générations, mais manifesté maintenant à Ses saints. »
Mais ce mystère n'était-il pas
déjà caché dans les Écritures ? L'Ancien Testament n'y fait-il jamais allusion
? La réponse est encore formelle : « caché pendant les éons en Dieu » (7). Mais
les anges et les autres créatures célestes connaissaient sans doute ce mystère
? De nouveau la réponse est catégorique : « afin que les dominations et les
autorités dans les lieux célestes ( sur célestes ) connaissent aujourd'hui...
» (Eph. 3 : 10).
6 (6) Que l'on ne nous reproche pas de " diviser " les enfants
de Dieu en distinguant trois sphères. Il est entendu que tous sont nés de
nouveau et forment donc dans ce sens une unité. Mais dans cette grande unité on
peut distinguer (sans séparer) trois autres unités. Cette distinction disparaît
après les éons.
(7) Eph. 3 : 9 « apo tôn aiônôn
».
(8) Col. 1: 26. Le grec n'a pas
« révélé », comme en Mat. 16: 17 p. ex. Ici il s'agit de ce qui est « manifesté
». Paul seul a reçu cette révélation, mais il la fait connaître « maintenant »
aux saints.
(9) Eph. 3 : 3. Après « mystère
» commence une parenthèse. Voir Darby. Cette parenthèse est close, non après «
mystère de Christ », mais après « prophètes ». Lire ensuite : « En esprit les
nations seront cohéritières... »
Page 68
Pour mieux marquer que l'on ne
peut pas trouver ces richesses dans ce qui avait été révélé ou écrit jusqu'à ce
moment, Paul ajoute : « À moi... cette grâce a été accordée d'annoncer
aux Gentils les richesses introuvables » (10). Ne cherchons donc pas ce grand mystère chez d'autres
que Paul, ni dans les Écritures des Actes ou de l'Ancien Testament.
Nous concluons que si Paul met
tant d'insistance sur la nouveauté et l'importance de cette révélation, il ne
faut pas la considérer comme un simple développement, comme un appendice à ce
qu'il avait fait connaître antérieurement.
Quel est le sujet de ce grand
mystère ? « En esprit, les nations seront cohéritières et formeront un même
corps (co-corps), étant coparticipantes de la promesse en Christ-Jésus »
(11). Il ne s'agit pas ici d'une promesse à Abraham, mais d'une promesse en
Christ-Jésus. Il ne s'agit pas ici de vie éonienne (éternelle), mais de la vie
en Christ-Jésus (12). Il ne dit pas que les nations sont maintenant élevées au
rang d'Israël et reçoivent aussi l'héritage juif, ni qu'elles font un corps
avec Israël et participent à des promesses abrahamiques faites à ce peuple. Ici
toutes les nations (y compris Israël) participent ensemble à un héritage nouveau
; elles forment ensemble un corps nouveau et participent ensemble à une
promesse nouvelle. Nous croyons avoir montré dans Le Plan Divin et dans
le présent ouvrage quelle est la mission d'Israël, quel est son héritage
(Canaan), quelle est son unité, quelles sont ses promesses. Le message céleste
dépassait tout cela, mais était connu depuis Abraham. Comment pourra-t-on dire
qu'il n'y a ici, dans l'épître aux Éphésiens, qu'une participation des nations
aux prérogatives juives ? Israël est rejeté comme nation. Tout ce qui concerne
Israël est remis à plus tard et l'accomplissement de ces choses attend la
repentance de ce peuple et la venue du Seigneur. Comment les nations
auraient-elles maintenant part à certaines choses avec Israël ? Et si nous
avons bien compris le symbole de l'olivier, pourrons-nous admettre que l'épître
aux Éphésiens se contente de répéter que des groupes de croyants des nations
n'ont été qu'entés sur un arbre juif ?
10 (10) Eph. 3 : 8. Le grec « anexkniastos » est ainsi
traduit par Darby en Rom. 11 : 33. C'est le sens littéral.
(11) Eph. 3 : 6. Nous traduisons
du grec. Voir aussi Darby et ses notes.
(12) Voir 2 Tim. 1 : 1 et Col. 3
: 3, 4.
APRES
LES ACTES 69
D'aucuns auront encore des
doutes et seront tentés de croire qu'il s'agit des promesses abrahamiques
mondiales, qui comprennent la bénédiction de toutes les nations. Or ces
promesses sont encore dans les éons, dans ce qui est imparfait. Nous allons
voir que Paul parle de choses plus élevées, qui se rapportent à la perfection.
c) Accès
à une nouvelle sphère. - On se contente souvent de distinguer la terre et le
ciel. Or l'Ancien Testament fait déjà allusion à plusieurs régions ou sphères
autres que la terre. 1 Rois 8 : 27 est caractéristique à cet égard :
« Dieu habiterait-il
véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent
le contenir » (13). Nous trouvons donc là : 1e la terre, 2e les cieux, 3e les cieux des
cieux, 4e ce qui dépasse les cieux des cieux. Le Psaume 113 dit aussi : « Sa
gloire est au-dessus des cieux. » Il ne faut pas oublier en effet que les cieux
sont aussi bien créés que la terre et que Dieu est avant et indépendamment de toute
création.
Le Nouveau Testament nous
apprend qu'après son ascension, le Christ est « monté au-dessus de tous les
cieux » (Eph. 4 : 10). Il a traversé les cieux (Héb. 4 : 14) et est donc plus
élevé que les cieux (Héb. 7 : 26). Cette sphère a été désignée par un nom
spécial : « les sur célestes » (voir App. 4).
Que le lecteur veuille bien
noter que nous ne disons pas que l'existence de cette sphère était
inconnue avant Paul. A ce que nous-même avons cité de l'Ancien Testament, nous
pouvons ajouter que le mot « sur céleste » est utilisé par Jean et par l'auteur
de l'épître aux Hébreux (14). Dans les Écritures d'avant la fin des Actes, il
est question de :
13 (13) Ces expressions nous en rappellent d'autres, comme
le saint » et « le saint des saints » du tabernacle. On voit là, matérialisées,
des choses célestes (Héb. 8 : 1-5) et une division nette entre le parvis, le
lieu saint et le lieu très saint. De plus, il y avait au-dessus de tout cela la
« nuée » représentant la gloire du Seigneur. Nombres 9.
14) Voici tous les textes Jean
3: 12 ;1 Cor. 15 : 40 (deux fois), 48, 49 ; Eph. 1: 3, 20; 2 :6 ; 3: 10; 6: 12
; Phil. 2: 10 ; 2 Tim. 4 : 18 ; Héb. 3: 1 ; 6: 4; 8 : 5; 9: 23; 11 : 16 ;
12:22.
Page 70
« choses sur célestes »
« corps sur célestes »
« homme sur céleste »
« vocation sur céleste »
« don sur céleste »
« patrie sur céleste »
« Jérusalem sur céleste ».
Mais, dans tous ces cas, c’est
le caractère ou l'origine qui est indiqué. En contraste avec ceci, Paul utilise
cinq fois dans l'épître aux Éphésiens l'expression
« en tois epouraniois »
c à d. « dans les (sphères) sur
célestes». Le datif indique ici (en contraste avec le génitif dans les
expressions précédentes) que les personnes (ou choses) dont il parle, se trouvent
dans cet « endroit ». Toute l'Écriture connaît donc les « sur célestes », mais
jamais la moindre allusion n'indique qu'un homme puisse y être placé. C'est
bien une nouvelle révélation en relation avec le grand mystère et donnant accès
à une sphère fermée jusqu'à ce moment. C'est bien là une chose inconnue, cachée
en Dieu, introuvable. Paul nous apprend que dans ces sur célestes :
nous pouvons avoir toutes
sortes de bénédictions spirituelles (Eph. 1 : 3)
le Christ est assis (Eph. 1 :
20)
Dieu peut nous faire asseoir en
Christ-Jésus (Eph. 2 : 6)
il y a des « dominations » et
des « autorités » (Eph. 3 : 10) (15).
Le texte grec ne dit pas : «
lieux sur célestes », mais simplement « sur célestes ». Nous ne pouvons plus en
effet parler ici de « lieux ». L'espace est une création, or les « sur célestes
» sont au-dessus de la création et « lieux sur célestes » est donc un non-sens.
Nous avons ajouté parfois « sphère » parce que cette expression est plus vague.
Notre langage terrestre n'est pas apte à exprimer ces réalités spirituelles,
mais pour en parler il faut bien utiliser des mots.
Nous osons à peine dire que
dans cette sphère sur céleste il y a un « endroit » spécial : la droite de
Dieu, et que c'est là que le Christ est assis et en Lui ceux auxquels Paul
s'adresse.
15 (15) Il y a aussi Eph. 6 : 12, mais il est probable
qu'il faut lire : « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang...
dans les (lieux) sur célestes » et qu'il faut considérer le reste comme une
parenthèse. Héb. 12 : 22 est au datif, mais n'utilise pas la préposition « en
». Cette Jérusalem descend sur terre (Apoc. 21 : 2).
Page 71
Ils sont ainsi vraiment
au-dessus de tout, même des « dominations », etc., qui se trouvent dans la
sphère sur céleste.
Il est impossible de voir ici
une description complémentaire de ce qui est relatif aux choses célestes, de ce
qui a rapport à la création, aux bénédictions abrahamiques. C'est une sphère
entièrement nouvelle. S'il y a des limites bien déterminées entre la terre et
les cieux, celles qui sont entre les cieux et les sur célestes sont, encore
plus accentuées.
d) Une
nouvelle Église. - l'Église du
mystère est hors du temps et de l'espace, hors de la création, hors des éons.
Elle correspond à l'état final où Dieu est tout en tous, état qui vient après
les éons. En esprit, les membres de cette Église sont donc enlevés des éons et
atteignent la perfection absolue (16). Cette Église n'est pas celle qui existera sur terre
pendant l'éon prochain, ni l'Église céleste, mais c'est le Corps, même du
Seigneur (Eph. 1 : 23). Les membres ne sont pas seulement des « enfants de Dieu
», pas seulement des « fils » : ils peuvent atteindre à « l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ » (Eph. 4 : 13).
Paul parle ici, non pas
seulement de rédemption (lutrôsis), mais d'une rédemption complète
(apolutrôsis) (Eph. 1 : 7) ; non pas seulement de réconciliation (katallassô),
mais d'une réconciliation parfaite (apokatallassô) (Eph. 2 : 16).
La communion de ceux de la
sphère céleste allait jusqu'à la mort avec Christ, mais pas encore jusqu'à la
vraie vie. Paul dit : « Comme si (vous étiez) vivants hors des morts »
(Rom. 6 : 13). Mais à ceux de l'Église du mystère Paul dit franchement qu'ils
sont rendus à la vie avec Christ, ressuscités avec Christ (17). Étant réveillés
avec Christ, c'est Lui qui est leur vie. Là seulement se trouve toute la
plénitude de vie.
Faut-il s'étonner après cela
que Paul dit avoir complété la Parole de Dieu ? (18). À lui seul ce mystère fut
révélé (19) et nous ne devons pas le chercher chez, les apôtres de la
circoncision.
16 (16) Col. 2 :10. Texte
grec.
(17)
Eph. 2 :5, 6 ; Col. 2 : 12 ; 3 : 1. Le
grec ne met pas « ressuscité », mais « réveillé ».
(18) Col. 1 25 Darby et App. 2.
(19) Eph. 33, 8 et voir la note
Nr. 8, p. 67.
Page 72
L'Église du mystère n'est pas
l'Épouse. Nous avons montré dans Le Plan Divin que l'Épouse est formée
de Juifs chrétiens et nous examinerons cette question de plus près dans
l'appendice 5.
Même si l'on distingue ainsi
plusieurs Églises, il reste toujours possible de parler d'une Église
universelle, qui comprend alors tous ceux qui sont nés de nouveau.
e) Une nouvelle espérance. - Nous nous bornerons à dire
que les membres de l'Église du mystère paraissent avec Christ, quand Il
viendra en gloire (Col. 3 : 4), quand d'autres croyants ressuscités ou changés
viennent à Sa rencontre. Leur résurrection corporelle doit donc avoir lieu
avant celle d'autres groupes de croyants. Ils peuvent même atteindre la
conformité à la mort du Seigneur (20) c à d. rester très peu de temps dans le Hadès et
parvenir ainsi à la « hors-résurrection d'entre les morts » (21). C'est ainsi
que l'on peut être « avec Christ » (Phil. 1 : 23). Cette résurrection rend
conforme « au corps de sa gloire » (Phil. 3 : 21), tandis que celle connue
avant ne menait qu'à la conformité à l'image du Fils (Rom. 8 : 29) et
non à Son corps glorieux même.
Si l'on considère ainsi
l'ensemble de ce que Paul a enseigné après les Actes, il ne peut rester aucun
doute qu'il s'agit d'une sphère nouvelle, d'une Église nouvelle. Certaines
choses prises à part peuvent laisser un doute, mais l'accumulation des
indications est telle qu'on ne peut plus hésiter. Comme dans toute la Parole,
c'est la foi qui décidera. Dieu ne donne pas des preuves du genre de celles des
mathématiques, qui obligent d'accepter une solution. Il reste toujours
une liberté de croire. Non pas que ces preuves n'existent pas, mais nous
sommes incapables de les saisir directement. Il n'y a qu'un chemin : celui de
la foi. La preuve se cache dans le domaine que nous devons conquérir par la
foi. C'est là toujours la sûreté du croyant : étant arrivé à la position où
Dieu l'invite, il trouve la certitude. La certitude ne peut pas précéder la
foi.
20 (20) Phil. 3 : 10. Il s'agit de la mort, non de la
manière de mourir.
(21) Phil. 3 - 11. Grec :
exanastasin tèn ek nekrôn. Cette expression doit donc être distinguée de celles
où il n'est question que d'une résurrection d'entre les morts, comme celle de 1
Thes. 4 et 1 Cor. 15. A noter aussi que dans le texte grec le mot résurrection
n'est employé que pour un événement qui concerne le corps. Il n'y a pas de
résurrection « spirituelle. Il peut ,y avoir une « vivification » qui
n'intéresse pas encore le corps.
Page 73
Nous
voyons par ce qui précède qu'il y a trois sphères de grâce, de bénédiction, de
communion avec Dieu : 1e la sphère terrestre, 2e sphère céleste, 3e la sphère sur
céleste. Nous résumons dans un tableau ce qui les caractérise et les distingue.
3. Les trois
sphères.
Nous voyons par ce qui précède qu'il y a trois sphères de grâce, de bénédiction, de communion avec Dieu : 1e la sphère terrestre, 2e sphère céleste, 3e la sphère sur céleste. Nous résumons dans un tableau ce qui les caractérise et les distingue.
|
SPHÈRE TERRESTRE |
SPHÈRE CÉLESTE |
SPHÈRE SUR-CÉLESTE |
|
Nouvelle naissance (Jean 1 : 13 ; 3 : 3,
7, 8 ; 1 Pi. 1 : 3, 23 ; 2 :2). |
Nouvelle création (2 Cor.5: 17 ; Gal - 6 :
15). |
Nouvel homme (Eph. 4:24; Col. 3: 10). |
|
Enfant de Dieu, esclave (Rom. 8: 15 ; Gal. 3 :
24 ; 4 : 1,9 ; 1 Jean 3 : 9, 10). |
Fils de Dieu, libre (Rom. 8 : 14 ; Gal. 3 :25 ; 4 :5). |
Homme fait (Eph. 4; 13). |
|
Renouvellement de
l'intelligence (Rom 12 : 2). |
Vieil homme crucifié (Rom. 6 : 6). |
vieil homme dépouillé (Eph. 4: 2 2; Col.
3 : 9). |
|
Sous le péché (Rom. 7 : 14). |
Mort au péché (Rom. 6 : 2 ; 8 : 2). |
Mort aux péchés (Eph. 2 :1, 5 ; Col. 2 :
13). |
|
Béni en Abraham. |
Béni avec Abraham (Gal. 3 : 9, 14). |
Promesse en Christ (Eph. 3 : 6). |
|
Poussière de la terre (Gen. 13 : 16). |
Étoiles du ciel (Gen. 15: 4-6). |
Dans les sur célestes (Eph. 1 : 3 ; 2 : 6) |
|
Rémission des péchés (Mat. 6 : 12, 14, 15 ;
18 : 27-35). |
Justification (Actes 13 : 39 ; Gal. 2 :
16). |
Grâce et rédemp. compl. (Eph. 4 : 32 ; 1 : 7). |
|
Couvert (1 Jean 2 : 2 ; 4 : 10). |
Réconcilié (Rom. 5 : 10 ; 2 Cor.
5:18 -20). |
Réconciliation compl. (Eph. 2:16; Col. 1 :21) |
|
Résurrection au dernier jour
(Jean 6 : 39-54). |
Enlèvement (1 Thes. 4 ;
1 Cor 15). |
Hors-résurrection d'entre
les morts (Phil. 3: 11 ; Col. 3: 4). |
|
Résurrection au dernier jour
(Jean 6 : 39-54). |
Enlèvement (1 Thes. 4 ;
1 Cor 15). |
Hors-résurrection d'entre
les morts (Phil. 3: 11 ; Col. 3: 4). |
|
Résurrection au dernier jour
(Jean 6 : 39-54). |
Enlèvement (1 Thes. 4 ;
1 Cor 15). |
Hors-résurrection d'entre
les morts (Phil. 3: 11 ; Col. 3: 4). |
|
Résurrection au dernier jour
(Jean 6 : 39-54). |
Enlèvement (1 Thes. 4 ;
1 Cor 15). |
Hors-résurrection d'entre
les morts (Phil. 3: 11 ; Col. 3: 4). |
|
Vie éonienne terrestre (Jean 3 : 15, 16, 18 ; 1
Jean 5 : 11). |
Vie éonienne céleste (Rom. 6 : 23 ; Gal. 6 :
8-10 ; Tit. 1 : 2). |
Christ notre vie (Phil. 1: 21 ; Col. 3 :
3,4). |
|
|
|
|
Nous avons vu à plusieurs reprises qu’il y a une correspondance entre les éons et les sphères. Ainsi l'éon prochain (le quatrième) est celui où la nouvelle naissance domine sur la terre. Dans le cinquième éon, c'est la nouvelle création qui a englobé la sphère de la nouvelle naissance. Après les éons vient la sphère parfaite, où Dieu est tout en tous. Nous avons essayé de représenter cela par le diagramme suivant:
Page 74
Les
sur célestes (sphère de l’état parfait)
|
Les cieux (sphère de la
nouvelle création) Création primitive
Nouvelle création |
Dieu tout en tous |
||||
|
Sphère de la nouvelle
naissance Adam
Royaume |
|
|||
|
Séparation |
|
|||
1 + 2 3 4 5
Les éons qui sont passés Le
mauvais éon présent L’éon à
venir L’éon des éons
Pendant l'éon prochain, il y a donc : l° sur terre, ceux qui sont dans la sphère de la nouvelle naissance ; 2° dans les cieux, ceux de la nouvelle création ; 3° dans les sur-célestes, ceux de l'état parfait. Pendant le cinquième éon, il n'y a que deux groupes : ceux de la nouvelle création et ceux de l'état parfait. Les autres sont rentrés dans un de ces deux groupes. Après les éons, Dieu est tout en tous et toute la création est donc parvenue à la perfection.
On se représente souvent les choses d'une manière un peu trop simpliste : on ne connaît, dans l'avenir, qu'une sphère de bénédictions, le ciel. Pour arriver à ce résultat, on est obligé de « spiritualiser » à outrance.
D'autres se sont rendu compte que le peuple d'Israël avait une mission terrestre et qu'il y a donc deux sphères de bénédiction : une sur terre dans l'âge prochain, et une céleste. Ceci est un progrès énorme et permet de comprendre d'une manière simple et claire une grande partie des Écritures. Beaucoup de difficultés sont ainsi évitées. Mais il reste des points obscurs et une partie de la Parole doit encore être forcée pour pouvoir entrer dans le schéma.
Page 75
La grâce de Dieu n'est pas appréciée dans toute sa plénitude et il manque quelque chose à sa glorification. De plus, les conclusions non scripturaires conduisent, comme tout écart de la vérité, à la division, au scepticisme, etc. L'état actuel du monde chrétien, la division, même entre ceux qui croient à l'avenir d'Israël, montre qu'il y a des lacunes dans cette conception. Tous ont une partie de la vérité, mais on n'arrive pas à en faire une unité. Certains s'attardent à la loi, d'autres aux évangiles, d'autres à la Pentecôte, d'autres aux Douze, aux cérémonies des Actes, etc. Tout cela est scripturaire quand c'est à sa place, mais n'est pas conforme à la volonté de Dieu lorsqu'on l'applique à nous. On veut suivre des prescriptions données dans d'autres temps à d'autres groupes de croyants et on veut même s'approprier des promesses nationales, qui sont le monopole d'un peuple terrestre. Nous n'avons aucune objection contre un symbolisme scripturaire, qui permet d'appliquer certaines vérités d'une manière « spirituelle ", mais il ne faut pas que ce sens symbolique prenne la place de la réalité. Ainsi nous admettons parfaitement que l'histoire d'Israël peut nous servir d'exemple et d'instruction. Mais c'est une raison de plus pour protester de toutes nos forces contre l'idée qu'Israël est rejeté définitivement comme nation. S'il en était ainsi, quel mauvais exemple ! Ou tout au moins quel exemple imparfait. Si l'histoire des Israélites se termine à la fin des Actes, s'ils n'arrivent pas à leur but, nous pourrions en conclure que nous non plus n'y arriverons pas.
Nous comprenons les scrupules que certains ont à croire en
un Royaume terrestre. Trop souvent, la chose est si mal présentée, qu'elle
devient inacceptable ; on a raison alors
de rejeter un « chiliasme » non scripturaire. Mais si on se rend compte que
pendant l'âge à venir il y a aussi une sphère céleste et même sur céleste et
que ce Royaume n'est pas le but, mais le moyen pour parvenir à la nouvelle
création mondiale, puis à la perfection universelle, toute objection tombe. Une
vue partielle de la prophétie peut donner lieu à bien des difficultés et à
rejeter le sens littéral. Seule une solution générale se basant sur toute
l'Écriture, même si elle n'est pas parfaite, écarte les objections. Si elle
fait apparaître les choses comme un peu plus compliquées, elle les simplifie en
réalité, parce qu'on peut ainsi prendre à peu près tout à la lettre. On peut
croire ce que Dieu dit.
Page 76
Mais, dira-t-on, avez-vous la
prétention de savoir tout cela mieux que les croyants des premiers siècles, que
les Pères et tous les grands hommes qui sont venus après eux ? Aurait-il fallu
attendre dix-neuf siècles pour atteindre la vérité ? Ne devons-nous pas au
contraire nous tenir à ce que nos pères ont enseigné ? Notre réponse est simple
: nous avons foi dans les Écritures plus que dans les hommes. Nous admirons
tous ces croyants qu'on nous donne comme autorités, mais s'il est vrai que nous
essayons d'estimer leurs travaux à leur valeur, nous ne désirons comme modèle
que Paul seul (1). Et nous croyons toucher là le point faible du
christianisme : il a abandonné Paul, tout au moins en partie et cela depuis le
premier siècle de notre ère. Nous n'acceptons pas le moins du monde la thèse
que de ce temps-là les chrétiens avaient toute la vérité et que nous devons
toujours nous en référer à eux. Nous donnons nos raisons en détail dans les
chapitres suivants (2).
Pierre, Jean et Jude mettent en
garde contre les faux docteurs, les antéchrists et les moqueurs (1a). Ils
attendent le retour du Seigneur et la venue du Royaume sur terre, et ils savent
très bien que ce Royaume ne viendra pas graduellement, mais qu'au contraire
l'âge présent se terminera par des événements terribles et que les puissances
du mal seront alors en pleine activité. Leurs vues correspondent exactement à
celles des prophètes.
Pendant la période des Actes,
Paul confirme cela et ne s'épargne pas pour mettre les croyants en garde contre
l'esprit de séduction :
« Je
sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après
eux.
1 (1) Phil. 3 : 17. Voir aussi la note 6 de l'introduction.
(2) Si certains nous regardent
comme des "ouvriers trompeurs » (2 Cor. 11 : 13-15), nous leur proposons
de se servir de la pierre de touche qu'Esaïe donne pour reconnaître ce qui est
de Satan (Es. 8 : 19, 20) : la loi et le témoignage, c.-à-d. la Parole écrite.
(1a) 2 Pi. 2 ; 1 Jean 2 et 4 ; 2
Jean ; Jude.
Page 77
Veillez
donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour
d'exhorter avec larmes chacun de vous » (Actes 20 : 29-31).
« Ces
hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de
Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange
de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres » (2 Cor. 11 : 13-15).
Dans ses dernières épîtres, il
parle de toute la période qui le sépare de la fin de l'âge présent.
«
Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront
toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène » (2
Tim. 2 : 16, 17).
«
Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les
hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence
de piété, mais reniant ce qui en fait la force » (2 Tim. 3: 1-5).
«
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal,
égarant les autres et égarés eux-mêmes » (2 Tim. 3 : 13).
« Car
il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais,
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une
foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la
vérité, et se tourneront vers les fables » (2 Tim. 4 : 3, 4).
Il ne s'agit pas seulement des
incrédules, mais aussi des croyants :
« Il
doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur
donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que,
revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est
emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté » (2 Tim. 2 : 25, 26).
Paul était-il au moins
satisfait d'avoir organisé et consolidé un grand nombre d'églises qui se
maintiendraient dans la vérité, dans toute la vérité ? Nous avons déjà vu
ci-dessus qu'il ne se faisait aucune illusion à ce sujet et qu'une prière
continuelle et prolongée pendant trois ans n'était pas superflue.
Page 78
Et plus il allait loin dans
l'exposition de ses révélations, plus il se rendait compte qu'on l'abandonnait.
Il fut obligé de dire aux Philippiens :
« Car
je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à
coeur votre situation ; tous en effet cherchent leurs propres intérêts, et non
ceux de Jésus-Christ » (Phil. 2 : 20, 21).
Après avoir parlé de trois
compagnons, il ajoute :
« Ils sont du nombre des
circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu,
et qui aient été pour moi une consolation » (Col. 4 : 11).
On voit que la grande majorité
de ceux qui ont travaillé avec lui n'ont pas été pour lui une consolation. Nous
sommes persuadés que ces collaborateurs étaient des croyants sérieux, mais nous
sommes obligés de croire aussi qu'ils s'arrêtaient, soit à la sphère terrestre,
soit à la sphère céleste, ou même étaient anti-scripturaires en certaines
questions. Bien rares étaient ceux qui le suivaient dans la sphère sur céleste.
Ils travaillaient pour le « Royaume de Dieu », une expression qui englobe
beaucoup de choses, mais ils ne travaillaient pas pour l'Église du mystère. Il
est fort probable, que l'on disait de Paul ce que certains de nos lecteurs
diront de nous : « Vous allez trop loin. » Ils jugeaient donc Paul d'après
leurs propres idées au lieu d'accepter ses révélations, qui dépassaient en
effet tout ce qu'ils avaient entendu eux-mêmes auparavant. Nous ne prétendons
pas que tous étaient des ministres de Satan, loin de là, mais ils étaient les
victimes de ces ouvriers trompeurs. Nous n'entendons pas les juger, mais nous
devons constater les faits.
Dans sa dernière épître, Paul
confirme l'abandon général :
« Tu
sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné » (2 Tim. 1 : 15).
Or on se souvient de ce qu'il
disait pendant les Actes :
«
Cela dura deux ans, en sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et
Grecs entendirent la parole du Seigneur » (Actes 19 : 10).
Tous ceux d'Asie l'avaient
entendu et abandonné. Même quand sa vie est en péril, ils ne passent pas sur ce
qui les sépare de Paul au point de vue doctrinal, mais persistent dans leur
abandon :
Page 79
«
Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné »
(2 Tim. 4 : 16).
Que l'on se rende bien compte
que ces épîtres ont été écrites pendant une période où, d'après la tradition, «
l'Église » aurait déjà été très nombreuse et en pleine activité. Nous ne
doutons pas qu'il y ait eu alors, en effet, des dizaines de milliers de
croyants actifs et courageux, prêts à donner leur vie. Mais nous regrettons
d'avoir à constater qu'ils ont abandonné Paul et son enseignement. Ils avaient
la foi en Dieu, en Christ, mais n'atteignaient pas les sphères supérieures, la
perfection, le but de Dieu. Les temps étaient fort difficiles et nous pouvons
supposer que certains se sont excusés, comme on le fait encore actuellement, en
disant qu'avant tout il fallait un « Évangile simple », qu'on n'avait pas de
temps pour toutes les subtilités de cet « intellectuel » qu'était Paul, pour
toutes ces doctrines compliquées. On osait peut-être dire déjà que les choses
du coeur devaient primer celles de l'intelligence. Quoi qu'il en soit, nous
avons à tenir sérieusement compte de ce fait indéniable qu'à part quelques
rares exceptions, les croyants les plus sérieux, les plus pieux, ont abandonné
Paul après qu'il eut fait connaître le grand mystère (2). Or si nous
croyons à l'inspiration des épîtres de Paul, ne sommes-nous pas alors obligés,
non pas de suivre les enseignements de ces chrétiens, mais au contraire de nous
méfier d'eux au point de vue doctrinal et de faire un effort pour nous dégager
de la tradition humaine ?
Quelques croyants étaient «
fidèles » et c'est particulièrement à ces « saints et fidèles en
Christ-Jésus » qu'il adresse ses dernières épîtres (3).
C'étaient des membres de
l'Église qui est le Corps de Jésus-Christ et qui devenaient conscients de leur
position. Ou c'étaient au moins des croyants qui étaient prêts à accepter les
derniers enseignements de Paul. Le nombre de chrétiens augmentait rapidement,
mais les croyants fidèles semblent toujours être restés des exceptions. Paul
avait rapidement traversé en esprit les éons et les sphères correspondantes et
était arrivé en esprit à l'état final où Dieu est tout en tous.
2 (2) Voir App. 6.
(3) Eph. 1 : 1 ; Col. 1 : 2 ; 2
Tim. 2 : 2. Le grec pour « fidèle est « pistos »
Page 80
Le plus grand nombre de
chrétiens restait en arrière, soit dans la sphère de la Nouvelle Naissance,
soit dans celle de la Nouvelle Création et de la justification. Quelques-uns
seulement suivaient Paul dans la sphère parfaite.
Ici se pose une question grave
: qu'ont fait les Apôtres de la circoncision, qui survivaient à la fin des
Actes ? La Parole reste muette à ce sujet. Nous n'avons aucune indication dans
leurs écrits qu'ils aient connu la sphère sur céleste. Leur mission était
d'amener Israël à occuper sa position dans le monde afin que les nations
fussent bénies. Pendant tout l'éon à venir Israël exercerait sa mission sur
terre. Or, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne commencent qu'après
l'éon prochain, jusqu'à ce moment Israël se tient dans l'ancienne création. Il
s'ensuit qu'il était impossible aux Douze de proclamer l'évangile de Paul, qui
transporte en esprit ceux qui le reçoivent dans la nouvelle création, où il n'y
a plus ni Juif ni Gentil. Les Douze avaient une mission terrestre et se
bornaient à exécuter cette mission. Si parfois nous pouvons croire entendre
chez eux un vague reflet de l'évangile de Paul, il est certain qu'ils ne disent
cependant pas un mot du grand mystère.
Mais que faisaient-ils après le
rejet d'Israël et surtout après la destruction du temple, quand le Royaume
était loin ? Il est inutile de raisonner sur ces questions. Ce qu'il nous faut
ce sont des faits. Or si l'Écriture ne nous donne pas d'indications, nous avons
les documents humains de ce temps. Nous n'avons jamais eu recours à de tels
documents quand il s'agissait de choses divines, mais il est normal de les
consulter quand on veut savoir ce que les hommes ont fait et pensé. Nous
examinerons donc les écrits des deux premiers siècles sous ce rapport. Mais
avant cela, tâchons de nous placer dans la situation de ce temps.
5.
Le Désarroi général au Premier Siècle
L'année 70 avait scellé, par la
destruction de Jérusalem et la dispersion des Juifs, le rejet provisoire
d'Israël en tant que peuple élu. Pendant environ deux mille ans, le Seigneur
avait montré Sa patience et Sa grâce envers ce peuple. Les nations avaient été
reléguées au second plan et Israël constituait en somme le pivot de l'histoire
humaine.
Page 81
Tous les croyants des Actes
vivent dans l'atmosphère du Royaume terrestre à venir et attendent la venue du
Roi en gloire. Même la venue prématurée des bénédictions abrahamiques célestes
sur les nations avait pour but d'apporter la conversion d'Israël et l’avènement
du Royaume terrestre. C'est en se pénétrant de cet état d'esprit, que l'on peut
plus ou moins se figurer quel coup de foudre a été le rejet d'Israël, et quelle
importante limite constitue les années 60 à 70.
L'histoire confirme ce désarroi
et nous en examinerons quelques exemples dans ce qui suit.
Jusqu'alors toute la Parole
présente Israël comme le centre du dessein de Dieu et ne connaît que les
bénédictions qui doivent venir par cette nation ou avec elle. Que reste-t-il
donc quand Israël disparaît ? Sur quoi faille-t-il s'appuyer ? Avec les Douze,
on avait une autorité vivante, comme il convient à une communauté visible. Mais
quand ce peuple est rejeté, que devient cette autorité vivante ? Il est vrai
que Paul est venu avec quelque chose de nouveau. Il a parlé d'un mystère caché
de tout temps, d'une Église invisible, mais qui voudrait le suivre dans ces
enseignements ? On se détourne complètement de lui et la tendance principale
parmi les chrétiens juifs et Gentils est de rester fidèle aux enseignements des
Douze. La solution qui a le plus de succès est que « l'Église » remplace
Israël, qu'elle est le vrai Israël, donc héritière de toutes les promesses et
que tout ce qui est prophétisé concernant ce peuple, doit s'entendre d'une
manière « spirituelle » de « l'Église » (1). Quoique le peuple terrestre disparaisse, on garde
autant que possible ce qui est visible. On retourne vers l'Ancien Testament et
les Évangiles et on oublie Paul. On constate alors trois courants principaux
parmi les chrétiens :
1) Ceux qui « judaïsent » et
s'appliquent autant que possible littéralement l'enseignement de l'Ancien
Testament et des Douze. Ce sont surtout les juifs chrétiens ;
2) Ceux qui réagissent contre
cette tendance et rejettent l'Ancien Testament, comme Marcion ;
3) Ceux qui « spiritualisent »
et tâchent ainsi de résoudre les difficultés.
1 (1) Ceci ne pouvant pas se soutenir intégralement, on résolut
généreusement de laisser toutes les malédictions pour les Juifs et de réserver
les bénédictions à « l'Église » !
Page 82
Dans certains cas, ils vont si
loin qu'ils affirment, comme Barnabas, que les Juifs ont mal compris Moïse et que
jamais ils n'auraient dû prendre la circoncision, le sabbat, les offrandes,
etc. à la lettre ! Ils n'ont jamais été le vrai peuple de Dieu !
Nous verrons dans ces écrits
qu'une grande partie du monde chrétien prétendait être « apostolique ». Mais de
partout surgissent des difficultés quand on veut s'appliquer les prescriptions
juives ; il est difficile de savoir jusqu'à quel point il faut « spiritualiser
». Les « évêques » s’anathémisent entre eux ; c'est le chaos et il faut
beaucoup de temps avant que tout se calme et qu'on se mette d'accord. Les
persécutions et les hérésies antichrétiennes favorisent cependant cette entente
et l'on voit naître « l'Église universelle » (ou catholique) dont Rome est le
centre et la tête.
Et que deviennent ceux qui sont
restés fidèles à Paul ? Nous l'ignorons. Ils formaient sans doute une minorité
infime et méprisée. Ils ont peut-être bien laissé des documents, mais ceux-ci
semblent être inconnus. S'ils existent, ils ne sont pas traduits, pas compris
ou simplement négligés par les savants.
Examinons maintenant les plus
importants des documents connus. Avant tout, ceux des « Pères apostoliques ».
TROISIÈME PARTIE
Les documents humains
des premiers siècles
La majorité des chrétiens
croyait encore, après l'an 70, à la prochaine venue du Seigneur et s'attendait
à voir commencer le Royaume terrestre. Barnabas, Clément, Hermas, Ignace,
Polycarpe et beaucoup de « Pères de l'Église » parlent de cette venue en termes
non équivoques. Ils gardaient donc l'espoir, espoir justifié pendant les Actes,
alors qu'Israël pouvait encore se repentir, mais complètement périmé quand ce
peuple avait été écarté pour un temps. Voilà au moins une chose qu'ils ne «
spiritualisaient » pas.
Quand ils parlent du Seigneur,
ils l'appellent surtout « Jésus », c à d. qu'ils Le connaissent surtout dans
Son humiliation et non comme le « Christ-Jésus » placé à la droite de Dieu.
La justification par la foi fut
entièrement perdue de vue, ainsi que tout ce qui caractérise Paul.
Nous donnons ci-dessous
quelques extraits de ces documents afin que le lecteur puisse juger par
lui-même.
a)
Épître de Barnabas.
Barnabas écrivait vers la fin
du premier siècle. On a supposé que c'était lui qui avait accompagné Paul.
L'épître attribuée à Barnabas
se réfère à des passages comme Es. 1 : 11-13 ; Jér. 7 : 22-23 ; Zach. 8 : 17 ;
Es. 58 : 4 -10, etc., qui insistent sur la signification des offrandes et des
cérémonies et rappellent que toute la loi dépend du commandement d'aimer Dieu
et son prochain. Barnabas pense trouver là un argument décisif pour son idée
que jamais Dieu n'a demandé ces offrandes à la lettre. Après avoir cité Ex. 33
: 1-3 il ajoute :
Page 84
Barnabas 6. « mais que dit la connaissance ?
Comprenez bien. Espérez en Lui,
qui paraîtra bientôt en chair, Jésus... Mais que dit-Il donc ? Vers le pays où
coule le lait et le miel. Béni soit notre Seigneur, frères, qui nous donne la
sagesse et l'intelligence de ces choses cachées. Car le prophète parle en
allégorie à propos du Seigneur... C'est nous-mêmes qu'Il a conduits dans le bon
pays. Qu'est-ce alors que le lait et le miel ? C'est parce que l'enfant est
d'abord maintenu en vie par le miel et le lait. Ainsi de même, comme nous
sommes maintenus en vie par notre foi dans la promesse et par la parole, nous
vivrons et serons seigneurs de la terre. »
Quand il parle de Jér. 4 : 4 il
insiste aussi sur l'idée que seule la circoncision du coeur est demandée et non
pas celle de la chair :
Barnabas 9. « mais vous direz : en vérité, ce peuple avait la
circoncision comme un signe. Non, ainsi l'est aussi tout Syrien et tout Arabe
et tous les prêtres des idoles. Appartiennent-ils donc tous à l'alliance ? Même
les Égyptiens sont circoncis. »
Il veut donc conclure que la
circoncision de la chair ne prouve rien du tout et n'a jamais été demandée.
À propos des indications de
Moïse, défendant de manger des animaux impurs, il dit :
Barnabas 10. « Dieu ne leur défend pas de manger avec leurs dents,
mais Moïse parle en esprit... Vous voyez quel sage législateur Moïse était.
Mais comment pouvaient-ils voir et comprendre ces choses ? Mais nous qui avons
une vue correcte sur ces commandements, nous en parlons confortablement à la
volonté du Seigneur. »
La prophétie d'Ezéch. 47 : 1-12
est expliquée ainsi:
Barnabas 47 - 11. « Il dit ceci parce que nous descendons dans l'eau,
chargés de péchés et d'ordures, et que nous en sortons portant du fruit en
notre coeur, laissant reposer notre crainte et espérance sur Jésus en esprit. »
Sous prétexte que la Parole
parle des bénédictions des Gentils, il croit que la Nouvelle Alliance est faite
avec eux et non avec Israël, comme Jér. 31 : 31 le dit si clairement. Le «
sabbat » est le temps qui vient après les six « jours », qui sont d'après lui
les six milliers d'années depuis la création.
Après avoir mentionné Es. 1 :
13, il ajoute :
Page 85
Barnabas 15. « Vous voyez ce qu'il veut dire : ce ne sont pas nos
sabbats présents qui Lui plaisent. »
Ainsi Barnabas supprime aussi
le sabbat hebdomadaire. Il prétend du reste qu'il ne faut pas non plus prendre
les prophéties à la lettre. C'étaient des allégories que les Juifs ne pouvaient
pas comprendre.
Nous voyons donc que Barnabas
est un des précurseurs de la « spiritualisation » de ce que Dieu dit dans sa
Parole. Mais où faut-il s'arrêter dans cette voie ? Tout contrôle logique
devenant impossible, c'est la porte ouverte librement à la fantaisie
individuelle. Cette erreur est donc bien ancienne et a commencé pendant l'âge «
apostolique ». Parce qu'on avait abandonné Paul on était obligé pour sortir
d'une situation désespérée de recourir à une solution de fortune.
Devons-nous suivre ces
enseignements ? Nous savons que la grande majorité l'a fait et a donné comme
argument que ce point de vue est ancien et traditionnel. Mais nous ne voyons
pas qu'une erreur doit être acceptée parce qu'elle est ancienne. La vérité
l'est encore plus, et Barnabas n'était en son temps qu'un novateur dangereux.
Si l'on doit rester fidèle aux « Pères », nous préférons les « Pères d'Israël »
aux « Pères apostoliques ».
b)
La « Doctrine des Douze Apôtres ».
Cet écrit, nommé aussi «
Didachè », date de la fin du Ier siècle ou du commencement du IIe. C'est
faussement qu'on l'a attribué aux Douze, mais cette attribution illégitime
montre assez que la masse des chrétiens suivait les Apôtres de la circoncision.
Plusieurs autres écrits leur ont aussi été attribués. On a dit de la Didachè
que c'était le plus ancien document existant, après le Nouveau Testament. Une
copie, datant de l'année 1056 a été trouvée au XIXe siècle à Constantinople. Ce
document est divisé en 16 chapitres assez courts dont le contenu rappelle
l'enseignement des Évangiles. On y trouve des prescriptions éthiques empruntées
à la Loi et aux Évangiles, plus ou moins adaptées aux nouvelles circonstances.
Voici d'abord quelques extraits caractéristiques :
1 : 3. « Jeûnez pour ceux qui
vous persécutent. »
4 : 6. « Si vous avez des
possessions, vous donnerez une rançon pour vos péchés. »
Page 86
6 : 2. « Car si vous savez
porter le fardeau entier du Seigneur, vous êtes parfait, mais si vous ne le
pouvez pas, faites ce qui vous est possible. »
Nous nous trouvons ici
entièrement dans le domaine de la justification par les oeuvres et il est
évident que l'auteur rejette les messages de Paul (1). On attache,
beaucoup d'importance à ce document (souvent plus qu'à une partie des
Écritures) et cela donne une idée de la mentalité générale au Ier siècle et à
ce jour. Nous faisons suivre encore quelques parties :
7 : 1. Pour ce qui concerne le
baptême, baptisez ainsi : Après avoir enseigné toutes ces choses, baptisez au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, dans de l'eau courante.
2. Mais si vous n'avez pas
d'eau courante, baptisez dans une autre eau ; et si vous ne pouvez pas le faire
dans de l'eau froide, faites-le dans de l'eau chaude.
3. Mais si vous n'avez même pas
cela, versez de l'eau trois fois sur la tête, au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit.
4. Mais avant le baptême,
faites jeûner celui qui baptise aussi bien que celui qui est baptisé et même
d'autres qui savent le faire. Vous demanderez à celui qui est baptisé de jeûner
un ou deux jours d'avance.
8 : 1. Mais que votre jeûne ne
coïncide pas avec celui des hypocrites, car ils jeûnent le deuxième et le
cinquième jour de la semaine ; mais vous jeûnerez le quatrième jour et le jour
de la préparation (2).
2. Ne priez pas non plus comme
les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son Évangile... Priez
ainsi : « Notre père... »
3. Priez ainsi trois fois par
jour.
9 : 1. Mais à propos de
l'eucharistie, rendez grâce ainsi.
2. D'abord concernant la coupe,
« nous rendons grâce à toi, notre Père, pour la vigne sainte de ton enfant
David, que tu nous as fait connaître par ton enfant Jésus, à toi soit la gloire
dans les siècles. »
3. Concernant le (pain) rompu,
« nous rendons grâce à toi, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu
nous as fait connaître par ton enfant Jésus à toi soit la gloire dans les
siècles. »
1 (1) Batiffol dans l'Église Naissante, p. 131, dit : « La Didachè
qui, à cet égard, retarde sur saint Paul, qu'on dirait qu'elle n'a pas
connu, a tout de même le sentiment de cette unité. »
(2) Il semble que le « jour de
la préparation » indique le vendredi. Les Écritures n'utilisent le mot ,
paraskeuè , (préparation) que pour le jour de la préparation de la Pâque : Mat.
27 : 62 ; Marc 15 : 42 ; Luc 23 : 54 ; Jean 19 : 14, 31, 42.
Page 87
4. De la même manière que ce
(pain) rompu était dispersé sur les montagnes et, étant rassemblé, est devenu
un (seul pain), que de même ton Église soit rassemblée des extrémités de la
terre dans ton royaume, car à toi est la gloire et la puissance par Jésus-Christ
dans les siècles. Mais ne laissez manger ni boire personne de l'eucharistie,
excepté ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur, car, concernant ceux-ci, le
Seigneur a dit : « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. »
10 : 1. Après être rassasiés,
rendez grâce ainsi.
2. « Nous rendons grâce à toi,
Saint-Père, pour ton saint nom, que tu as fait habiter dans nos coeurs, et pour
la connaissance et la foi et l'immortalité que tu nous as fait connaître par
Jésus, ton enfant, à toi soit la gloire dans les siècles.
3. Toi, Seigneur tout-puissant,
tu as fait toutes choses pour ton nom ; tu as donné la nourriture et la boisson
aux hommes pour en jouir afin qu'ils puissent te rendre grâce, mais tu nous as
bénis avec de la nourriture et de la boisson spirituelle et avec la vie
éternelle par ton enfant.
4. Avant tout, nous te rendons
grâce que tu es puissant ; à toi soit la gloire dans les siècles.
5. Souviens-toi, Seigneur, de
ton Église pour la délivrer de tout mal et pour la rendre accomplie dans ton
amour, et rassemble-la des quatre vents, elle qui est sanctifiée, dans ton
royaume que tu as préparé pour elle ; car à toi est la puissance et la gloire
dans les siècles.
6. Laisse venir la grâce et
laisse passer ce monde. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint qu'il
vienne, si quelqu'un n'est pas saint, qu'il se repente. Maranatha. Amen. »
7. Permettez aux prophètes de
rendre grâce tant qu'ils veulent.
Le chap. 13 demande des
prémices de la moisson, des boeufs et des moutons, etc. pour les prophètes et
les pauvres.
14 : 1. Rassemblez-vous le
seigneurial (jour) du Seigneur et rompez le pain, et rendez grâce après avoir,
confessé vos fautes, afin que votre offrande soit pure.
2. Que celui qui a une dispute
avec son ami ne s'unisse pas à vous avant d'être réconcilié, afin que votre
offrande ne soit pas souillée.
3. Car voici ce que le Seigneur
a dit : « En tout lieu et temps, présentez-moi une offrande pure, car je suis
un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est grand, parmi les nations. »
Page 88
On se rend compte de la
différence énorme qui existe entre ce langage et celui des Écritures. Il y a là
une adaptation des cérémonies juives, des prières « standardisées », etc. La «
sainte cène » est appelée une offrande. Tout cela peut très bien être utilisé
par Rome, qui professe s'appuyer sur la tradition ; mais ce n'est certainement
pas scripturaire.
d)
Elles datent de la fin du Ier
siècle et sont adressées aux Corinthiens. Elles parlent d'offrandes qui doivent
être faites à des jours et à des heures déterminés et d'une succession dans les
fonctions ecclésiastiques. La « loi du Seigneur » doit être suivie, les «
prêtres supérieurs », les « prêtres » et les « lévites » ont leurs fonctions
déterminées. On voit que des instructions humaines devaient êtres introduites
et se substituaient en partie aux instructions divines données au peuple
d'Israël (3).
Les objections contre le rituel
chrétien restent toujours les mêmes : toute cérémonie demandée par Dieu, était
complètement décrite et ceux auxquels Il s'adressait avaient tous les détails
directement de Lui. Si l'on veut se substituer à Israël, il faudrait continuer
à suivre ces cérémonies divines ou justifier un changement. Si Dieu avait voulu
d'autres cérémonies des chrétiens on le saurait et celles-ci auraient été
observées depuis le début. Nous voyons, au contraire pendant les premiers
siècles une évolution lente ayant comme point de départ les cérémonies juives
et païennes.
3 (3) Batiffol dit à ce propos " Oui, la Prima Clementis proclame le
droit divin de la hiérarchie investie par les apôtres » (L'Église Naissante,
p. 156). Or cette hiérarchie des prêtres et lévites est en majeure partie
empruntée à Israël. Ce n'est que dans le cas où " l'Église » est le « vrai
Israël » qu'on peut parler de « droit divin » en relation avec ces
institutions, et encore faudrait-il enlever ce qui est d'innovation humaine. La
question cruciale restera toujours : Dieu se repent-Il de Ses dons et de Son
appel ? (Rom. 11 : 29). C'est-à-dire Dieu a-t-Il abandonné définitivement
Israël comme peuple élu terrestre ? La réponse scripturaire est formelle et
négative. Les discussions interminables de Batiffol, Harnack, Lightfoot, Renan,
Sabatier, Sohm et beaucoup d'autres ne touchent pas le point principal et se
perdent dans la confusion. Si « l'Église ) remplace Israël, la position de
l'Église Romaine est solide. Si « l'Église » est le vrai Israël, elle est une
Église visible et il lui faut une autorité vivante indiscutable. Mais plus on
insiste sur cette position solide et sur la tradition « apostolique » et plus
on démontre ,sa faiblesse scripturaire.
Page 89
Comment ose-t-on faire ce que
Dieu n'a pas demandé ? Ou prétend-on que tout ce qu'on fait est de source
divine ? Rome peut, sans y parvenir, essayer de se justifier. Mais que peuvent
dire ceux qui prétendent vouloir s'appuyer uniquement sur la Parole écrite pour
tout ce qui concerne leur vie religieuse ? La faiblesse de toutes les « Églises
» actuelles réside dans leur origine. Alors que tout ce qui concerne un peuple
visible comme Israël est net et clair, « l'Église » commence dans les ténèbres,
au temps où Israël fut rejeté, Paul abandonné et où il n'y avait aucune unité,
mais un désarroi complet.
Clément ne connaît rien de la
doctrine de Paul, quoiqu'il mentionne « l'évangile » de cet apôtre.
Elles datent de la fin du Ier
siècle ou du commencement du IIe.
Il dit aux Éphésiens : « Vous, disciples
de Paul » et leur recommandent de ne pas résister aux évêques, qu'ils doivent
considérer comme le Seigneur même.
Aux Tralliens : « Il faut respecter les diacres comme ordonnés par
Jésus-Christ ; l'évêque comme celui qui est la figure du Père ; les anciens
comme mandataires de Dieu et comme continuation des Apôtres. Sans eux, il n'y a
pas d'Église. »
Aux Philadelphiens : « Faites attention de n'user que d'une seule
eucharistie. Car une est la chair de Jésus-Christ, et un le calice dans l'unité
de son sang ; un autel... » « Je vais à l'Évangile comme à la chair de Jésus,
et aux Apôtres comme aux ancêtres de l'Église. »
Aux Smyrnéens : « Ils s'abstiennent de l'eucharistie et de la prière parce
qu'ils ne confessent pas que l'eucharistie est la chair de notre Sauveur
Jésus-Christ, celle qui a souffert pour nos péchés et que le Père a
ressuscitée... Où est l'évêque, que là s'assemble la multitude ; de même que là
où est le Christ-Jésus, là est l'Église catholique... »
« Celui qui honore l'évêque est
honoré de Dieu... Celui qui agit de quelque manière sans consulter l'évêque,
est le serviteur du diable. »
Graduellement le clergé se
forme et devient puissant. Que nous sommes loin de Paul ! Préférons-nous Ignace
?
Page 90
Aux Philippiens il parle de
l'épître de Paul qui leur est adressée, mais ce qu'il écrit est complètement
étranger à l'enseignement de Paul.
L'esprit général ici encore est
l'observation de la loi et la justification par les oeuvres. L'auteur dit p.
ex. « Si je ne pèche plus je serai sauvé. » Il parle beaucoup d'un édifice qui
représente « l'Église » et on a voulu en déduire qu'il se rapprochait de Paul.
Malheureusement sa doctrine est tout l'opposé de celle de l'Apôtre.
g)
Constitutions des Apôtres
Cet écrit a été attribué à
Clément, mais l'authenticité en est fort discutée. Il daterait du IVe siècle.
Les choses ont évolué et le ritualisme commence à se stabiliser. Au chapitre 57
du Livre 11 il dit :
« Après cela, que l'évêque
fasse le sacrifice, tout le peuple étant debout... et quand il aura été offert
qu'il prenne le corps du Seigneur et le sang précieux, tous s'avançant avec
ordre et avec respect et crainte, comme au corps du roi ; les femmes aussi. »
Cet écrit montre elle-même ses
erreurs, quand il prétend que ces « Constitutions » ont été rédigées par les
Douze et par Paul :
« Pierre et André, Jacob, etc.,
de même Jacques, frère du Seigneur, Évêque de Jérusalem, et Paul, Docteur des
Gentils, Vase d'élection, tous ensemble réunis avons mis par écrit cette
doctrine catholique. »
L'Église romaine tire de ce
document la série de « Papes » : Pierre, Linus, Anacletus, Clément, etc. Une
des bases de cette Église est donc un document douteux, plein d'erreurs.
h)
Les Pères Apologètes
Nous trouvons là : Justin,
Irénée, Tertullien, Cyprien, Clément d'Alexandrie, Origène, qui écrivent aux
IIe et IIIe siècles.
Page 91
L'opposition contre le
Christianisme en général a favorisé la formation d'un groupe, qui entreprend la
lutte contre les « hérésies ». Paul est parfois mentionné par eux quand on
trouve chez lui un argument contre les adversaires, mais sa doctrine reste
toujours ignorée. On admet qu'il y a beaucoup de questions obscures et l'on
recommande de se borner à ce qui est clairement et ouvertement proposé par les
Écritures.
Justin dit :
« Douze hommes sont partis de
Jérusalem pour parcourir le monde : ces hommes étaient simples et sans
éloquence, mais avec la vertu de Dieu ils annonçaient aux hommes de toute race
qu'ils étaient envoyés du Christ pour enseigner à tous la parole de Dieu »
(Apolog. 1 : 23).
Il n'est donc pas question de
Paul et contrairement aux Écritures, les Douze se seraient adressés à tous.
D'après Justin, les prophéties de Michée se sont réalisées depuis que les
apôtres ont porté l'évangile aux Gentils dans le monde entier (Dialog. 110 : 4).
Il dit aussi :
« Ceux qui croient au Christ
sont une âme, une synagogue, une église » (Dialog. 63 : 5).
Irénée écrit dans son troisième
livre, chapitre 1 :
« Quant à Luc, sectateur de
Paul, il fit un livre de l'Évangile prêché par Paul... auquel si quelqu'un
n'adhère pas, il méprise ceux qui participent du Seigneur, et se damne lui-même
en repoussant son propre salut : c'est ce que font les hérétiques. »
Or ce que Luc écrivit, ce sont
les Actes des apôtres et nous avons vu que ces Actes traitent à peu près
exclusivement d'Israël et de la venue du Royaume. L'Évangile de Paul est exposé
dans ses épîtres et non pas dans les Actes. On voit ainsi combien peu Irénée
connaissait les enseignements spéciaux de Paul. Au troisième chapitre il dit :
« Par la tradition des Apôtres,
et par la succession continue, conservée dans les Églises, des Évêques
institués par eux, on confond invinciblement les hérétiques. »
Les hérétiques, ce ne sont pas ceux
qui s'opposent à la Parole de Dieu, mais ceux qui ne croient pas à la tradition
humaine.
Page 92
Tandis que les plus anciens
documents ne parlent pas d'une prépondérance de l'Église de Rome, nous trouvons
à la fin du IIe siècle chez Irénée qu'elle devient la « grande, très antique »
Église qui aurait été constituée par Pierre et Paul !
« Car à cette Église, à cause
de sa primauté qui s'impose, il est nécessaire que toute autre Église se
rattache ; en elle a été toujours la tradition qui vient des Apôtres. »
En lisant ces écrits, on est
frappé par le fait que l'origine de « l'Église » est, même pour ceux de cette
époque, dans les ténèbres. Tout ce qu'Irénée dit n'est pas généralement établi,
au contraire il cherche des renseignements de divers côtés, tâche de se
justifier, fait des déductions, etc. Nous verrons qu'Eusèbe confirme cette
incertitude et ce manque d'informations indiscutables.
De ce temps certains opposaient
Paul à Pierre. Irénée dit qu'ils sont apôtres du même Dieu (13e chap.). Il défend
Paul contre les Ébionites (14e et 15e chap.). Il montre que « lateinos »
(latin) donne par addition de la valeur numérique des lettres, le nombre 666 et
il est donc inutile pour nous de chercher là un argument contre l'Église
romaine qu'Irénée aide justement à créer.
Tertullien et Cyprien s'en
réfèrent en tout à Irénée et confirment qu'il y avait rivalité entre ceux qui
mettaient Pierre en relief et d'autres qui soutenaient Paul. Tertullien nie que
Paul ait prêché un autre évangile que Pierre ! Après une visite à Rome, il en
revient désenchanté et nie que « l'Église », considérée comme organisation
extérieure, ait les « clefs ». C'est Pierre seulement qui les avait,
pense-t-il.
L'Église est appelée « l'épouse
». Des sept Églises de l'Apocalypse, celle de Pierre est la première. Cyprien
ne fait pas mention de Paul. Clément d'Alexandrie et Origène parlent un peu
différemment et semblent résister à la primauté de Pierre et de Rome. Origène
surtout connaît Paul et semble se rendre compte que son message diffère de
celui des Douze.
Nous terminerons par Eusèbe
(Évêque de Césarée, le « père » de l'histoire de l'Église) qui écrivait au IVe
siècle. Il essaie d'écrire l'histoire d'une manière systématique et est fort
gêné par le manque de documents clairs et positifs.
Page 93
Les quelques indications sont «
comme de faibles lumières qui paraissent de loin ». La tradition s'est
cristallisée en une organisation et on désire maintenant établir une base pour
cette tradition.
Eusèbe parle de Papias qui
croyait en un Royaume de 1000 ans, mais il trouve cela trop fabuleux. Népos au
IIIe siècle avait aussi cette espérance.
Il nous fait connaître que
certains martyrs du IVe siècle s'appelaient par des noms juifs pour montrer,
qu'ils étaient le véritable Israël. La prophétie connue des os d'Ézéchiel 37
signifierait que des églises seraient bâties et que le christianisme se
répandrait partout. La prophétie d'Es. 35 : 1-6 ne concerne pas Israël, mais
les faits qui s'accomplissent depuis l'avènement de Constantin : c'est
l'épanouissement de « l'Église ». De même plusieurs autres prophéties ont comme
sujet « l'Église ». On voit que l'idée que « l'Église » remplace Israël et doit
réaliser le « Royaume des cieux » sur terre, conduit à en faire un instrument
politique et une organisation appartenant à ce monde. Eusèbe connaît Paul, mais
pas ses doctrines.
Nous faisons suivre quelques
extraits d'Eusèbe, qui nous donnent de singulières précisions concernant la
Pâque juive et son observance par les Apôtres, Évêques, etc.
Livre 5, Chap. 23. Du temps de
ces Évêques se produisit une grande dispute à cause des églises de toute l'Asie
qui, d'après une très vieille tradition, étaient d'avis qu'il fallait tenir la
fête de la Pâque du Seigneur le quatorzième jour de la lune (le jour où les
Juifs devaient immoler l'agneau pascal) et que le jeûne devait se terminer en
ce jour, quel que fût le jour de la semaine où il tombait. D'autre part, les
autres églises dans le monde entier n'avaient pas, l'habitude d'agir ainsi,
mais suivaient selon la tradition apostolique, l'usage qui a jusqu'à présent la
prépondérance : à savoir qu'il n'est pas permis de rompre le jeûne un autre
jour que celui de la résurrection de notre Sauveur. On a alors tenu à ce sujet
des Synodes et des Réunions d'Évêques : et tous les Évêques avertirent
unanimement les chrétiens de partout de la règle de l'Église par des lettres.
Notamment qu'il ne fallait pas fêter le mystère de la résurrection du Seigneur
un autre jour que le dimanche et que le jeûne ne devait se terminer que ce
jour-là...
Livre 5, Chap. 24. D'autre
part, les Évêques d'Asie, avec Polycrate en tête, prétendaient qu'il fallait
maintenir avec soin l'usage traditionnel.
Page 94
Polycrate même explique dans sa
lettre à Victor et à l'Église de Rome, que la tradition leur est parvenue
ainsi. « C'est nous qui sommes fidèles à la tradition, sans y rien ajouter,
sans en rien retrancher. C'est en Asie que reposent ces grandes lumières, qui
ressusciteront le jour de l'apparition du Seigneur, quand Il descendra en
gloire du ciel et éveillera tous les saints. Philippe, celui qui était un des
douze apôtres, qui est enterré à Hiérapolis, ainsi que ses deux filles, qui
vieillirent dans la virginité, sans parler de son autre fille, qui observa dans
sa vie la règle du Saint-Esprit, et qui repose à Éphèse ; puis Jean, celui dont
la tête s'inclina sur la poitrine du Sauveur, lequel fut pontife portant la
lame d'or (Voir Lev. 8 : 9, etc.), et martyr, et docteur ; celui-là aussi est
enterré à Éphèse ; puis Polycarpe, celui qui fut à Smyrne évêque et martyr ;
puis Thraséas, à la fois évêque et martyr d'Euménie, qui est enterré à Smyrne.
Pourquoi parler de Sagaris, évêque et martyr, qui est enterré à Laodicée, et du
bienheureux Papirius et de Méliton, le saint eunuque, qui vécut en tout dans le
Saint-Esprit, lequel repose à Sardes, attendant la venue du Seigneur du ciel,
quand il ressuscitera ? Tous célébraient la Pâque le quatorzième jour, selon
l'Évangile, sans rien innover, suivant la règle de la foi. »
« Et moi aussi, j'ai fait de
même, moi Polycarpe, le plus petit de vous tous, conformément à la tradition de
mes parents, dont quelques-uns ont été mes maîtres, car il y a eu sept évêques
dans ma famille, je suis le huitième ; et toujours ils ont fêté le jour auquel
le Peuple (juif) cessait de manger le pain sans levain. Moi donc, mes frères,
qui compte soixante-cinq ans dans le Seigneur, qui ai conversé avec les frères
du monde entier, qui ai lu d'un bout à l'autre la Sainte Écriture, je ne
perdrai pas la tête, quoi que l'on fasse pour m'effrayer. De plus grands que
moi ont dit : Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. »
« Je pourrais citer les évêques
ici présents, que, sur votre demande, j'ai convoqués ; si j'écrivais leurs
noms, la liste serait longue. Tous étant venus me voir, pauvre chétif que je
suis, ont donné leur adhésion à ma lettre, sachant bien que ce n'est pas pour
rien que je porte des cheveux blancs, et assurés que tout ce que je fais, je le
fais dans le Seigneur Jésus. »
Alors Victor, l'évêque de Rome,
essaya de séparer de suite de la communauté toutes les églises d'Asie et celles
des environs. À cette fin, il écrivit des lettres dans lesquelles il déclara
que tous ces frères étaient bannis de la communion. Mais ceci ne plut pas à
tous les évêques. Ils conseillèrent à Victor de ne pas agir ainsi et de garder
la paix, l'unité et la charité envers son prochain.
Page 95
Il y a aussi des lettres
d'évêques qui attaquèrent Victor avec des réprimandes assez sévères. Entre
autres Irénée lui écrivit au nom des Frères de la Gaule, où il était évêque.
Dans cette lettre, il reconnaît que le mystère de la résurrection du Seigneur
ne doit être fêté que le jour du Seigneur, mais il exhorta Victor à ne pas
séparer ces Églises de Dieu, qui suivaient une ancienne tradition. Parmi
d'autres choses, il utilisa les mots suivants : « Il n'y a pas seulement
différence concernant le jour, mais aussi concernant la manière de jeûner, car
les uns prétendent qu'il faut jeûner un jour, d'autres deux jours, d'autres
plusieurs jours, enfin il y en a qui comptent comme jour de leur jeûne quarante
heures se succédant jour et nuit. Ces différences dans l'observation du jeûne
ne sont pas récentes, mais existaient du temps de ceux qui ont vécu avant nous
et qui, n'ayant probablement pas été très stricts dans l'observation du jeûne,
sont la cause que leurs descendants ont suivi cette coutume, due à la
simplicité et à l'ignorance. Mais malgré cette différence, ils ont vécu en
paix, comme nous aussi nous vivons en paix. Ainsi cette différence dans le
jeûne confirme l'unité de la foi. »
« ... Car Anicet ne parvint pas
à convaincre Polycarpe d'abandonner cette ancienne coutume qu'il avait observée
avec Jean, le disciple du Seigneur, et avec les autres apôtres. Mais Polycarpe
ne sut pas non plus convaincre Anicet de la suivre ; celui-ci disait qu'il
était de son devoir d'observer la coutume qu'il avait reçu des anciens, ses
ancêtres. »
Livre 3, Chap. 23. De ce temps,
l'Apôtre et Évangéliste Jean, que Jésus aima, était encore en vie, et dirigea
l'Église d'Asie, étant retourné de son exil à l'île (de Pathmos) après la mort
de Domitien.
Nous sommes loin de considérer
Eusèbe comme infaillible, mais il semble qu'il a dû rendre fidèlement les
documents qui étaient à sa disposition. En particulier, quand il parle du
conflit entre les Églises d'Asie et les autres, il semble que ces faits ont dû
se produire, attendu qu'ils ne sont pas trop favorables à « l'Eglise ». Nous
voyons donc en particulier qu'un groupe important de chrétiens, s'appuyant sur
l'exemple de Jean et de Philippe (des Douze) et sur d'autres évêques et
martyrs, fêtent la Pâque le quatorze Nissan, comme les Juifs, observent le
jeûne comme les Juifs, et terminent ce jeûne le jour de Pâques et non le
dimanche suivant (4).
4 (4) -Ceci confirme aussi que
les Juifs chrétiens observaient, pendant la période des Actes, toutes les
cérémonies juives.
Page 96
Ils considèrent cela comme une tradition
divine et au risque d'être excommuniés, maintiennent leur point de vue,
considérant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La fête de Pâque
était devenue la fête de la résurrection et était fêtée le dimanche (qu'ils
appelaient le « jour du Seigneur » comme les païens). Ceux qui avaient
introduit cette nouvelle coutume jeûnaient jusqu'au dimanche. Jean, à son
retour de Pathmos, aurait conduit les Églises d'Asie (celles dont Paul dit
qu'elles l'ont abandonné). Jean aurait encore donné l'exemple dans
l'observation méticuleuse de la fête juive. Il est en tout cas difficile de
concevoir que si Jean avait compris et répandu un message correspondant à celui
de Paul, on aurait eu recours à lui pour justifier l'observation de cérémonies
judaïques parmi les chrétiens. Jean semble donc avoir persévéré dans
l'enseignement des Douze, mais sans doute appliqué aux Gentils. Irénée et
Clément d'Alexandrie nous l'assurent et il n'existe aucune indication
contraire. Il semble d'ailleurs que si tous les évêques et autres piliers de «
l'Église » ignorent la doctrine de Paul et tâchent d'adapter les enseignements
des apôtres de la circoncision aux Gentils, ils ont dû être dirigés dans cette
voie par ces apôtres mêmes. Si ceux-ci avaient compris Paul, ils se seraient
opposés à ces pratiques et il est hors de doute que nous l'aurions su. La
théorie selon laquelle Israël était remplacé par « l'Église », que tout devait
être « spiritualisé » et que les fêtes juives mêmes pouvaient être adaptées aux
nouvelles conditions, était acceptée par la grande majorité et c'était en effet
la seule solution possible, du moment qu'ils ne suivaient pas les enseignements
de Paul.
Pourtant ils avaient bien du
mal à venir à bout de cette assimilation des cérémonies juives. Il a fallu des
siècles pour arriver à des pratiques assez uniformes, comme celle de la messe,
basée sur la Pâque juive et sur le repas du Sabbat. Voir App. 7 et 8. La
controverse pascale était particulièrement difficile à résoudre. La masse des
chrétiens s'appelait « l'Israël spirituel » et voulait donc garder cette fête (5) qui parlait de
la mort du Seigneur, du sacrifice de l'Agneau, mais d'autre part il fallait
maintenant y donner un autre caractère en souvenir de la résurrection.
5 (5) N'oublions pas que les Gentils non circoncis ne pouvaient pas y
avoir part, Ex. 12 : 43-48.
Les documents montrent que la
fête de Pâque n'a pas été célébrée en tant que commémoration annuelle de la
Résurrection jusqu'à la moitié du second siècle. On gardait la Pâque juive,
tout en reconnaissant que l'agneau représentait Christ. Pendant une période de
transition on célébrait la « Pâque de la crucifixion » et la " Pâque de la
résurrection ». La première a donné naissance à la « messe » et à la « Cène »
actuelle. La deuxième est restée la « Pâque chrétienne ».
Page 97
D'une part le jeûne juif
cessait le quatorze Nissan, qui pouvait être un jour quelconque de la semaine,
d'autre part pourtant on ne pouvait interrompre le jeûne que le jour de la résurrection,
qui était fixé au dimanche ! De génération en génération la tradition juive
s'est estompée et la nouvelle coutume a pu être généralisée. Dans ce cas
encore, le fait qu'une nouvelle manière d'observer cette fête n'a pas remplacé
brusquement celle des Juifs, mais s'est formée lentement, prouve qu'elle n'est
pas une institution divine. De même pour les autres cérémonies, il y a
incertitude, contradiction, séparation et ce n'est que sous l'influence d'une
puissante organisation religieuse et politique favorisée par Constantin, qu'on
a pu arriver à uniformiser. C'est p. ex. le Concile de Nicée qui, en 325 imposa
à tous de fêter la Pâque le dimanche. Depuis Constantin « l'Église » est
devenue l'Église de ce monde, de l'âge présent. L'abandon de Paul et la
prétention de remplacer Israël ont porté leurs fruits.
Le fait que les douze Apôtres
de la circoncision ont été suivis, plutôt que l'Apôtre de l'incirconcision (6) a évidemment
attiré l'attention des théologiens et des savants. D'aucuns, comme Baur et
Renan ont cru que c'était là un phénomène temporaire et que le Judaïsme avait
remplacé dans « l'Église » l'enseignement de Paul. Or il n'est pas difficile de
montrer que ce n'était pas une réaction temporaire et brusque. Ainsi Lightfoot
n'a pas eu de peine à montrer qu'Irénée et d'autres ne font jamais allusion à
une telle révolution, mais qu'ils sont témoins que l'évolution s'est faite
graduellement depuis Jean, par Polycarpe, Papias, etc.
6 (6) Nous n'avons -aucune objection à ce qu'on fasse un large usage du
message des Douze en ce qu'il a de personnel. Il est même essentiel de
présenter à tous les hommes l'évangile du pardon des péchés par la repentance
et de leur montrer la nécessité de la nouvelle naissance. Mais il est
important, de se souvenir que les Douze adressaient leur message au peuple élu
Israël, en vue de sa repentance nationale afin qu'il pût exécuter sa mission
nationale dans le Royaume terrestre. Le message personnel était donc partie
intégrante d'un message national. Le premier est universel, le second est
réservé à Israël. Nous objectons donc à ce qu'on suive les Douze jusqu'à faire
application à tous de ce qui concerne seulement Israël et au fait que pour en
arriver là on substitue « l'Église -) à Israël, comme si la mission future de
ce peuple était dévolue désormais à un nouvel organisme.
Page 98
Il n'y a pas eu une période
spéciale de Judaïsme, mais celui-ci était l'état « normal » de « l'Église ».
Ceux qui ont abandonné Paul n'ont pas produit une révolution dans « l'Église »,
pour la bonne raison que c'est justement cette « Église » qui, dans son
ensemble, s'est détachée de la doctrine de Paul. Mais il y a eu, au contraire,
révolution quand on est revenu d'une manière résolue vers Paul, ainsi qu'on l'a
vu lors de la Réforme. Il est vrai que Saint Augustin était déjà retourné en
partie vers Paul, mais ce mouvement concernait seulement la dogmatique et, de
ce fait, n'atteignait pas les masses. À ce sujet il peut être intéressant pour
certains lecteurs de savoir que les théologiens sont à peu près d'accord pour
admettre que Saint Augustin est un des premiers qui retournent vers Paul. Nous
citons comme témoin Harnack (7) :
« Ce n'est que par Augustin que l'Évangile de
Paul a été placé, en Occident, sur l'avant-plan ; quant aux pays orientaux, il
y est toujours resté dans l'ombre. »
Un théologien de l'Église
Réformée Hollandaise (8) a dit :
« Il y a beaucoup de vérité
dans l'affirmation d'un savant connu, que, parmi l'Ancienne Église, Marcion
était en somme le seul qui comprenait Paul ; et encore Marcion le comprenait-il
mal ! Car on ne trouve aucune trace de l'influence des idées fondamentales de
l'épître aux Romains, par exemple sur le développement dogmatique de l'Église
grecque et latine des premiers siècles. En Occident, Augustin est en somme le
premier à se rendre compte de la signification de cette épître. Et, se
rattachant à Lui, vient Luther dont on connaît assez les commentaires de
l'épître aux Romains. »
Citons encore un autre docteur
de cette Église (9):
« Ainsi, l'enseignement
d'Augustin est devenu de la plus grande importance pour la dogmatique
ultérieure ; il domine les siècles suivants. Toute réformation retourne vers
lui et vers Paul. »
Calvin de même cite abondamment
Augustin en opposition avec « l'Église ».
7 (7) Die Mission und
Ausbreitung des Christentums, p. 210.
(8)
Le Dr. J. A. C. Van Leeuwen dans De Brief aan de Romei Den, p. 33.
(9)
Le Dr. H. Bavinck dans Gereformeerde
Dogmatiek, vol. 1, P. 115.
Page 99
Nous croyons avoir justifié
dans ce chapitre notre affirmation que les chrétiens des premiers siècles ont
persisté dans l'abandon de Paul et qu'ils ont été forcés par conséquent de «
spiritualiser » l'Ancien Testament et de se substituer à Israël. Ce n'est donc
pas vers eux que nous devons nous tourner quand nous voulons toute la vérité,
malgré l'admiration que nous pourrions professer à leur égard sur d'autres
points. Ce qu'il nous faut et ce qui peut au-dessus de tout glorifier Dieu, ce
n'est pas la théologie telle qu'elle s'est graduellement formée en tentant de
concilier les Écritures et la tradition en sacrifiant la Parole inspirée par
Dieu, mais c'est une théologie purement biblique, c à d. fondée uniquement sur
les Écritures (10).
Les origines de ce qu'on nomme
« l'Église » sont enveloppées de trop d'obscurité, l'histoire montre trop de
variations et de conceptions anti-scripturaires, pour que nous ayons le droit
de nous appuyer sur cette organisation. Tout homme a dans les Écritures tout ce
qui lui est nécessaire, et cela suffit s'il veut utiliser les facultés
naturelles que Dieu lui a données et la grâce que Dieu veut lui donner. Tout le
monde ne saurait être « théologien » dans le sens habituel de ce mot, mais tout
homme peut être un « théologien » biblique.
10 (10) A ce sujet nous citerons un passage de
l'Introduction de La Théologie de saint Paul, le livre remarquable du
jésuite F. Prat : « La théologie biblique serait protestante si elle avait la
prétention d'être toute la théologie : protestante en principe, car par une
heureuse inconséquence, jamais les luthériens, ni les calvinistes, pas plus que
les anglicans, ne se sont exclusivement renfermés dans la théologie biblique. »
Il n'est que trop vrai que le protestantisme a conservé une large part de
tradition
Page 100
Nous avons été conduit par
notre examen à un certain nombre de conclusions qui s'écartent de ce qui est
généralement accepté. Nous le regrettons, mais nous ne pouvons qu'exprimer
franchement nos convictions en invitant la critique à montrer où nous sommes en
contradiction avec la vérité. À quoi nous servirait de garder une tradition, si
celle-ci est contredite par la Parole ?
De plus, nous nous faisons un
devoir de répéter que jamais nous ne rejetons systématiquement l'enseignement
d'autrui. Nous nous estimons, en tout cas, dans l'obligation morale d'en tenir
compte très sérieusement, de l'approfondir. Mais c'est la Parole de Dieu qui
doit rester la décisive pierre de touche. Il est vrai que les « évangélistes »,
« pasteurs » et « docteurs » resteront toujours nécessaires dans la
dispensation actuelle. On ne peut pas exclure systématiquement toute aide
humaine, mais leurs messages, leurs conseils, leurs enseignements ne devront
jamais être présentés comme faisant autorité par eux-mêmes.
Leur fonction ne sera pas de
s’imposer, mais d’aider tout homme à se rendre compte de sa propre situation
vis-à-vis de Dieu, à former sa propre conviction, à déterminer sa propre voie,
en se basant sur l’écriture et en se laissant guider par l’Esprit. Le « docteur
» ne devra pas s’enfermer dans sa tour d’ivoire et rendre les textes inspirés
inaccessibles aux non-initiés, mais il devra au contraire faciliter l'accès de
ces textes à celui qui est moins bien préparé (1).
Un philosophe chrétien a dit :
« La réforme n'est pas arrivée à se constituer dans l'unité, même un seul
instant. La liberté des interprétations individuelles l'a brisée et tend à la fractionner
toujours plus en une multitude indéfinie de dénominations. Les disputes,
d'abord violentes, ont fini par se calmer ; les Églises protestantes se
reconnaissent les unes les autres, elles essaient même de se confédérer.
1 (l) Il faudrait en premier lieu une Concordance française, où tous les
textes de la Bible seraient groupés d'après les mots grecs. Il faudrait ensuite
un lexique où le sens de ces mots serait donné d'après leur usage dans le texte
inspiré.
Page 101
Pour chacune d'elles c'est
confesser clairement la possibilité d'entendre les textes autrement qu'elle ne
fait, et comme le texte seul est infaillible, c'est reconnaître que sa propre
doctrine n'est qu'une opinion sujette à l'erreur. C'est avouer soi-même, à la
joie des papistes, qu'un texte infaillible sans un interprète infaillible ne
donne aucune garantie d'unité ni de vérité. Et pourtant chaque secte n'a de
raison d'être que l'opinion qu'elle représente, tout en la sachant douteuse.
Elle est obligée de l'imposer à ses membres, elle ne saurait subsister qu'en
limitant le libre examen auquel elle doit son origine : pour mieux dire, elle
se compose uniquement des croyants que le libre examen a conduits à sa
formation et qui désormais n'examinent plus. Si la congrégation n'écarte pas
ceux qui se séparent de ses vues, elle n'est plus qu'un cadre vide, elle n'est
plus rien ; de sorte que l'esprit de recherche, la préoccupation consciencieuse
de la vérité parmi ses membres, sont incompatibles avec sa paix et mettent
constamment en péril son existence. L'étude personnelle, indépendante, est un
devoir pour le protestant, et s'il pratique ce devoir, il fait le désert autour
de lui, rien n'est plus aisé que de s'en convaincre.
D'où vient que tant d'opinions,
divergentes sur des points capitaux au jugement de chaque secte, se réclament
également de l'Écriture, avec une égale bonne foi ? Ce fait, qu'on ne songe
plus à contester nulle part, ne comporte qu'une explication ; mais si l'on
accorde le fait, on n'en repoussera pas moins l'explication, parce que
l'admettre serait abandonner le terrain où la Réforme s'était assise. La Bible
n'est pas un livre, c'est un recueil. Nulle confession ne l'embrasse également
tout entier, chaque parti se fonde sur certains textes qui parlent clairement
dans son sens, et s'efforce avec plus ou moins de succès de ramener à la même
doctrine ceux qui servent de base aux sentiments contraires. On oppose passage
à passage, et si nul chrétien biblique ne peut avouer que l'un contre dise
l'autre, la controverse prouve assez que souvent ils ont au moins l'air de se
contredire, ce qui pratiquement est la même chose. Dès que la Bible est le seul
fondement, la seule source et le seul juge, il n'y a pas à choisir en elle, il
n'y a pas de versets plus importants les uns que les autres, il faut tout
viser, tout mettre en oeuvre et l'on n'a pas même le droit de rester dans le
doute sur un point dont la Bible a parlé.
Page 102
Aussi n'est-il point facile de
se former une manière de voir véritablement biblique. Celles qui tiennent le
plus à ce titre sont loin de le mériter. La théologie des réformateurs n'est
point tirée de la Bible uniquement et sans secours étranger. Ils ont accepté le
travail dogmatique de quinze siècles en abrogeant les décisions qui
établissaient une autre autorité que l'Écriture ou qui de prime abord
semblaient en contradiction avec celle-ci ; mais que tout ce qu'ils ont
conservé de cet héritage soit, démontrable par les livres saints, que leurs
systèmes religieux résument l'Écriture sainte, sans en rien laisser en arrière
et sans y rien ajouter, c'est une prétention insoutenable » (2).
Il nous semble difficile de
nier qu'il y a beaucoup de vérité dans ces lignes. Chaque Église, chaque secte
a sa profession de foi qui, au début est le résultat d'un examen consciencieux,
mais devient trop vite une clôture. À notre avis, tout le mal provient du fait
qu'on trouve nécessaire de former des organisations qui prétendent constituer «
l'Église ». Cette erreur découle de la notion fausse qu'il peut y avoir une
Église visible dans la dispensation actuelle. Et cette notion a sa source dans
l'erreur fondamentale que les « chrétiens » ont remplacé Israël.
On peut très bien se réunir,
mais il ne faudrait pas qu'une restriction puisse empêcher une recherche
continue de la vérité et une épuration constante de nos pauvres convictions ;
l'unique restriction, sans laquelle nous tomberions dans un quelconque
humanisme, devant être que seule la Parole inspirée peut nous servir de base
certaine et seul le saint-esprit peut donner l’interprétation exacte. Il ne
faut pas pour cela des inspirations, des révélations, des visions, des
intuitions ; tout
ce qui est nécessaire c'est que
nos facultés soient éclairées, que nous puissions nous en servir pleinement et
sincèrement.
2 (2) La Philosophie de la Liberté, par Ch. Secrétan, tome II, p. 34. Nous
sommes loin d'accepter toutes les idées de ce philosophe, qui doute de
l'inspiration intégrale des Écritures et propose le dilemme suivant : « La
Réforme abjure et se soumet à la tradition ou bien la valeur et l'autorité de
la Bible elle même sont remises au jugement individuel. » Il tend à s'en
référer à, une inspiration individuelle tout en faisant usage des « débris des
constructions écroulées ». Nous préférons dépendre des Écritures et être des
protestants conséquents, même si cette attitude fait le vide autour de nous.
Nous ne saurions, dans un âge dont Satan est le dieu, chercher le succès.
Page 103
Certaines Églises disent
franchement qu'il faut accepter leur enseignement sans discuter et sans
comprendre. D'autres ne le disent pas, mais excluent celui qui pense autrement,
sans faire un effort sérieux pour le comprendre. Il n'est que trop vrai qu'un
protestant conséquent fait le désert autour de lui. L'Apôtre Paul a été le
premier à l'éprouver. L'unité qu'on cherche à établir n'a pas pour base la
vérité ; elle ne se fait le plus souvent qu'en la sacrifiant.
La Bible est en effet un
recueil, et l'erreur est de ne considérer qu'une partie de ce recueil, de ne pas
l'embrasser dans son ensemble. Toute contradiction apparente, toute difficulté
dans l'interprétation sont une preuve d'une erreur ou d'un défaut dans le
système d'interprétation. Il ne faut pas alors s'enfermer dans, son erreur et
s'acharner à défendre sa conception, mais réviser l'interprétation qu'on avait
jusque-là professée. Chaque Église ou secte détient une part de vérité. Il est
vain d'opposer vérité à vérité ; il faut les réunir et éliminer ce qui est
erreur. Surtout ne pas éliminer la vérité pour réunir les erreurs.
Nous avons fait un effort pour
mieux embrasser le recueil inspiré dans son ensemble. La distinction des éons,
des sphères et des dispensations nous ont permis d'éviter des contradictions et
des difficultés et d'accepter à la lettre ce que Dieu nous dit. Mais nous ne
prétendons pas être arrivés à la perfection. Nous restons, donc toujours
chercheur et invitons à la recherche. Cette attitude est peu appréciée, car on
pense qu'elle est incompatible avec une foi solide. Or, rien n'est plus faux.
Avons-nous moins de foi en Dieu, dans l’oeuvre de Son Fils, dans l'inspiration
de la Parole, dans la nécessité de la nouvelle naissance, de la nouvelle
création, de la justification, de la sanctification, de la perfection ? Au
contraire. Ces notions fondamentales restent, s'étendent et s'emparent de nous
d'autant plus qu'elles s'enchaînent logiquement. La recherche touche en effet
surtout à ce qui relie ces points et doit conduire à un ensemble que nous
pouvons saisir par nos facultés sanctifiées. La recherche biblique peut
sacrifier certaines habitudes, certaines notions sentimentales, certains rites.
Mais cela ne touche pas la foi en ce qui est vrai et divin. La recherche met en
danger toute « religion » humaine ; mais n'est-ce pas un bien ?
Page 104
On nous objecte que la grande
majorité n'a ni les facultés, ni le temps nécessaire pour un examen personnel.
Notre réponse est que chacun doit examiner selon ses conditions particulières.
La pratique montre que des personnes n'ayant que peu d'instruction peuvent, de
fait, étudier et comprendre les questions les plus profondes. La plus grande
partie de notre instruction est de peu d'utilité pour un pareil examen ; ce
qu'il faut avant tout c'est la soif de la vérité. Le manque de connaissance
n'est donc pas le plus grand obstacle, car il peut être vite comblé : c'est la
tiédeur envers les choses divines qui nous arrête le plus souvent. Certaines
connaissances acquises par l'étude peuvent même rendre impossible une vision
correcte de la vérité.
Quant au manque de temps, ce
n'est très souvent qu'une excuse. Dire qu'on n'a pas le temps pour une chose,
c'est dire qu'on préfère utiliser son temps pour une autre chose. Or combien de
temps ne gaspillons-nous pas à des choses de moindre importance ! Pour toute
chose, il faut un effort soutenu : la culture d'un jardin, l'éducation d'un
enfant, l'entretien de notre santé, etc. Et la connaissance des choses divines
devrait nous être donnée sans effort ? La Parole de Dieu nous dit tout autre
chose : « Si tu la poursuis (la sagesse) comme un trésor, alors tu comprendras
la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu » (Prov. 2 :
4-5). Les Israélites n'obtenaient pas le pain tout cuit dans le désert, mais
ils devaient se lever tôt pour ramasser la manne, la broyer, la piler, la
cuire. Et cela tous les jours. Il faut « acheter » la vérité (Prov. 23 : 23).
Les Écritures sont avant tout utiles pour enseigner (2 Tim. 3 : 16) (3). Il n'est pas
difficile de se rendre compte combien d'efforts sont dépensés pour quelque
plaisir futile ou pour quelque gain. Le fait qu'on dit ne pas avoir le temps
pour lire et comprendre ce que notre Père nous écrit est une preuve du peu
d'intérêt qu'Il nous inspire. Il serait bon qu'on le reconnaisse franchement au
lieu de présenter une excuse.
3 (3) Nous ne voulons pas un examen purement intellectuel, mais une étude
spirituelle n'exclut pas l'intelligence : Il faut un équilibre. C'est aux
humbles que Dieu enseigne Sa voie (Ps. 25 : 9).
Page 105
Est-il bien utile de dire que
nous ne voulons pas détruire, mais construire ? Dieu peut dans sa magnanimité
utiliser ce qui est partiellement vrai et bon et ce serait donc une grande
erreur de vouloir renverser ce qui n'est pas parfait. Que resterait-il ? Tout a
une certaine utilité et peut amener à ce qui est mieux. On a dit de certaines
professions qu'elles sont bonnes, pourvu qu'on en sorte. C'est exactement ce
que nous disons de tout ce qui existe dans ce monde. Ne l'abolissons pas, mais
sortons-en et aidons les autres à en sortir. Le danger universel est de se
laisser enfermer dans un cercle qui nous empêche de progresser vers la vérité,
la liberté, la gloire. Tout peut concourir au bien, pourvu que nous ne nous
laissions pas retenir et immobiliser à jamais par ce qui nous a fait du bien.
Notre conception des sphères de
bénédiction nous permet de sympathiser avec tout homme et de lui venir en aide
avec le message qui lui convient. Nous ne devons pas le considérer comme un
réprouvé ou un hérétique, mais comme un homme qui a besoin de plus d'amour et
de vérité. Nous pourrons partout reconnaître la part de bien qui s'y trouve.
Tendons donc à un seul but : la glorification de notre Père ; par un seul moyen : la communion avec la Parole vivante et la Parole écrite ; par une seule puissance : celle de l'Esprit.
Page 106
APPENDICE I
Autre et différent
Plus nous nous rendrons compte
exactement des paroles qui ont été choisies par le Saint-Esprit et plus
l'Écriture vivra et agira en nous. Nous en donnerons un exemple simple en
distinguant entre deux mots grecs « allos » et « heteros ». Une bonne
Concordance indique à tous, sans qu'il soit nécessaire de savoir le grec, les
textes où l'un ou l'autre de ces mots est employé. Ces textes indiqueront la
signification exacte de ces mots. Nous n'avons donc recours à aucune « autorité
» humaine, nous laissons parler les Écritures.
À titre d'exemple nous donnons
les textes suivants :
Mat. 5 : 39. « Si quelqu'un te frappe
sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre (allos). » - Qui pourrait mieux
nous définir le sens de ce mot « allos » ? C'est une chose « autre », mais de
la même espèce.
Mat. 27 : 42. « Il a sauvé les
autres (allos), et il ne peut se sauver lui-même. » - Voilà où le mot « allos »
(c'est-à-dire autre, mais de la même espèce) nous indique que l'erreur
fondamentale des sacrificateurs, scribes et anciens était de classer le Fils de
Dieu dans la même espèce que les pécheurs.
Luc 5 : 29. « Beaucoup de
publicains et d'autres (allos) personnes. » - Ceci définit ces personnes :
elles étaient de la même espèce que les publicains, donc des pécheurs. Au
verset 30, nous trouvons la confirmation : « les publicains et les gens de
mauvaise vie » (grec - pécheurs).
Jean 5 : 32. « Il y en a un
autre (allos) qui rend témoignage de moi. » - Cet autre est le Père d'après le
v. 37. On voit l'importance capitale de la signification précise du mot « autre
». Si nous n'attachons pas l'importance nécessaire aux paroles inspirées, nous
risquons de voir en Jésus un homme, peut-être excellent, mais non pas un être
de la même espèce que le Père, c'est-à-dire Dieu.
Page 107
Jean 10 : 16. « J'ai encore
d'autres (allos) brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. » - Il ne faut pas
perdre de vue qu'en ce temps le Seigneur avait dit : « Je n'ai été envoyé
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » (Mat. 15 : 24) et : « n'allez pas
vers les païens... allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël »
(Mat. 10 : 5, 6). Il fallait d'abord rassasier les « enfants », c'est-à-dire
les Juifs (Marc 7
27). Les gentils seraient bénis
après, par le peuple élu. Or il y avait en premier lieu les Juifs de Jérusalem
et puis ceux de la dispersion. Quand Il s'adresse à ceux de Jérusalem (« cette
bergerie »), Il fait remarquer qu'il y a encore d'autres brebis (ceux de la
dispersion), qui ne sont pas de cette bergerie. Le mot « autre » indique des
brebis de la même espèce, c à d des Juifs, des « enfants ». Il n'est pas encore
question des gentils. Ceux-ci auraient été désignés par le mot « heteros »
(d'une espèce différente), que nous examinerons plus loin. La distinction entre
Juifs et gentils, illustrée par l'histoire de la femme cananéenne (Marc 7 :
25-28), était trop grande à cette époque pour qu'il fut permis de désigner les
gentils par : « les autres brebis ».
Jean 14 : 16. « Il vous donnera
un autre (allos) consolateur. » - Le croyant le plus simple peut trouver ici
une preuve que le Saint-Esprit est une Personne divine et une confirmation de
la divinité de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance, le
Seigneur n'aurait pas pu employer le mot « allos », c'est-à-dire « un autre de
la même espèce ».
Il nous semble que ces quelques
exemples montrent d'une part l'importance d'une connaissance précise des
paroles inspirées et d'autre part la simplicité d'un examen de ce genre où la
seule autorité est la Parole de Dieu.
Nous continuons par une série
de textes, qui emploient le mot « heteros » et qui feront encore mieux
ressortir la nécessité de distinguer.
Mat. Il : 3. « Es-tu celui qui
doit venir, ou devons-nous en attendre un autre (heteros) ? » - Jean n'avait
plus la certitude que Jésus était le Christ. S'Il n'était pas l'Oint, Il
n'était qu'un homme né dans le péché et ils devaient encore attendre, non un «
allos », c'est-à-dire un autre de la même espèce, mais Celui qui serait différent
de tout homme.
Luc 17 : 34. « L'une sera prise
et l'autre (heteros) laissée. » - Il s'agit bien là de personnes différentes,
l'une est née de nouveau, l'autre pas.
Luc 23 : 40. « Mais l'autre
(heretos) le reprenait ».
Page 108
- Un des malfaiteurs croyait en
Christ et était donc un homme différent essentiellement de l'autre.
Jean 19 : 37. « Et ailleurs
l'Écriture dit encore. » - Le texte grec dit : « une Écriture différente
(heteros) dit. » Nous avons ici deux citations. La première : « aucun de ses os
ne sera brisé » venait de s'accomplir. La deuxième : « Ils verront celui qu'ils
ont percé » ne l'est pas encore. Ces deux Écritures sont donc d'espèce
différente.
Actes 1 : 20. « Qu'un autre
(heteros) prenne sa charge. » - Matthias devait remplacer Judas. Matthias était
« allos » par rapport aux Onze, mais « heteros » par rapport à Judas.
Actes 7 : 18. « Jusqu'à ce que
parut un autre (heteros) roi. » - Non seulement ce nouveau roi d'Égypte ne
connaissait pas Joseph, mais il était d'une autre race que les rois précédents.
Les Hyksos furent dépourvues de leur pouvoir au profit d'un véritable Égyptien.
Nous avons ici dans le choix du mot heteros, un important indice historique,
qui explique l'attitude différente à l'égard des Juifs. Déjà alors, un
nationalisme outré conduisait à la persécution d'Israël.
Rom. 7 : 23. « Une autre
(heteros) loi. ». - Il y a contraste entre la loi divine et la loi, différente,
du péché.
Gal. 1 : 6, 7. « que vous
passez... à un évangile différent (heteros), qui n'en est pas un autre (allos).
» Darby a traduit fidèlement ce passage. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles
(évangiles) dans les Écritures, mais toutes ont une origine divine et sont dans
ce sens de la même espèce. Ici, il s'agit d'un évangile différent, d'origine
humaine ou satanique.
Jac. 2 : 25. « Elle les fit
partir par un autre (heteros) chemin. » - Ils étaient entrés par la porte, mais
sortirent par la fenêtre ! (Jos. 2 : 15). Le chemin était donc bien différent.
Jud. 7. « Étant allés après une
autre (heteros) chair. » - Darby traduit ceci plus fidèlement que d'autres,
mais aurait dû écrire : « différente chair ». Il s'agit ici des anges qui n'ont
pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils
s'étaient incarnés dans une chair différente de celle des hommes. Voir Gen. 6 :
2 et les conséquences aux versets 4 à 7.
Nous terminons ici cette étude.
On se rendra compte que les Écritures commencent à vivre et peuvent nous
nourrir et nous réjouir quand nous gardons les saines paroles. D'autres études
aussi simples permettront à tout croyant d'obtenir des renseignements précis et
importants, directement de la Parole de Dieu.
Page 109
APPENDICE II
Né de l'Esprit, rempli de l'Esprit, accompli par
l'Esprit
Dans une intention louable, on
a distingué entre « avoir l'Esprit » et « la plénitude de l'Esprit ». On a dit
p. ex. que tous les convertis ont reçu l'Esprit, tandis que la plénitude ne
vient que quand le croyant s'abandonne entièrement au Seigneur. En somme on
fait là une distinction entre les deux premières sphères. Celui qui est né «
d'en haut » est né de l'Esprit et l'Esprit peut agir en lui. Mais le don de
l'Esprit n'habite, c à d. ne réside d'une manière continue, que dans
celui qui est mort avec Christ et qui est justifié.
Nous ne donnons ici qu'un
rapide aperçu de la question et commençons par faire observer qu'il faut avant
tout s'habituer à distinguer entre le Saint-Esprit, la Personne divine, et «
esprit » ou même « saint-esprit », le don, la puissance. D'après Actes 1 : 4
les Apôtres devaient attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis (1). Luc 24 : 49
dit ce que c'est : « la puissance d'en haut » et cela correspond d'après
Actes 1 - 5 au baptême dans l'esprit saint. Nous lisons donc dans Actes 1 - 8 :
« Mais vous recevrez une puissance, le saint-esprit survenant sur vous. »
Le jour de la Pentecôte cette promesse est accomplie et nous lisons : « ils
furent tous remplis de saint-esprit » c à d. de la puissance, comme nous le
verrons encore mieux plus loin.
En ce temps cette puissance se traduisait extérieurement par des
effets sensibles. Ainsi on lit : « ils furent tous remplis de saint-esprit et
se mirent à parler en d'autres langues... » (Actes 2 : 4). Ils parlaient des
merveilles de Dieu (v. 11). « Ils furent tous rempli de saint-esprit et ils
annonçaient la parole de Dieu avec assurance » (Actes 4 : 31). On voit par là
qu'ils ne furent pas « remplis » une fois pour toutes, mais que cela arrivait
quand c'était nécessaire, selon la volonté du Saint-Esprit. De même Actes 13 :
9 et d'autres textes montrent par la forme du verbe employé en grec, que cette
plénitude était passagère et se répétait.
1 (1) Notons qu'il s'agit ici d'une ancienne promesse du Père à Israël
(Voir p. ex. Joël 2 : 28 ; 3 : 2 ; Es. 44 : 3).
Page 110
Ce n'est pas encore là
l'habitation du saint-esprit dans l'homme justifié.
Nous croyons utile, pour qu'on
puisse mieux se rendre compte, de donner tous les textes où les mots « plèroô »
(accomplir), « plèthô » (remplir) et « plèrès » (plein) sont employés en
relation avec esprit, esprit-saint ou saint-esprit.
Plèroô
(rendre plein-accomplir)
Eph. 5 : 18. Soyez, au
contraire, accomplis en esprit (par l'Esprit) (2).
Plèthô
(remplir)
Luc 1 15. Jean... sera rempli
d'esprit saint.
Luc 1 41. Élisabeth... fut
remplie d'esprit saint.
Luc 1 67. Zacharie, son père,
fut rempli d'esprit saint.
Actes 2 4. Ils furent tous
remplis d'esprit saint.
Actes 4 8. Pierre, rempli
d'esprit saint.
Actes 4 31. Ils furent tous
remplis du saint-esprit. Actes 9 17. Que tu (Paul) sois rempli d'esprit saint.
Actes 13 9. Paul, rempli d'esprit saint.
Actes 13 52. Les disciples
étaient remplis de joie let d'esprit saint.
Plèrès
(plein),
Luc 4 : 1. Jésus, plein
d'esprit saint.
Actes 6 3. Sept hommes... qui
soient pleins d'esprit. Actes 6 5. Etienne, homme plein de foi et d'esprit
saint.
Actes 7 55. Etienne, plein
d'esprit saint.
Actes 11 : 24. Barnabas...
plein d'esprit saint et de foi.
On remarquera immédiatement
qu'Eph. 5 : 18 se distingue des autres textes : d'abord par l'usage de « plèroô
», ensuite parce que c'est le seul cas où le datif est utilisé, tous les autres
textes se servant du génitif. Que l'on ne perde pas de vue que c'est aussi le
seul texte qui date d'après les Actes. Nous l'examinerons de plus près
ci-dessous.
Le génitif indique que ces
personnes sont remplies de quelque chose, tandis que le datif indique
qu'ils sont remplis (ou plutôt « accomplis » en Eph. 5 : 18 ; voir aussi Col. 2
: 10, Darby) par quelqu'un (c.-à-d. ici le Saint-Esprit, la Personne
divine).
2 (2) On peut traduire « en esprit »,ou « par l'Esprit ». La préposition «
en » se traduit souvent « par » (Mat. 9 : 34 ; 17 : 21 ; Gal. 3 : 11, etc.).
L'article, quoique ne figurant pas dans le texte grec, peut être latent après
la préposition.
Page 111
Il est nécessaire de distinguer
la nouvelle naissance (une action de l'Esprit) qui n'a lieu qu'une fois, de la
plénitude de l'esprit qui était donnée au moment voulu et à plusieurs reprises
afin d'accomplir certaines choses visibles. Mais ces deux actions de l'Esprit
ne concernent que la sphère terrestre (3).
Le Saint-Esprit peut encore
agir de manière différente. D'abord il n'y a pas nécessairement un effet
visible, comme pendant la période des Actes, quand le Royaume était encore en
vue. Et puis, nous lisons dans les textes où Paul s'adresse à ceux qui sont «
en Christ-Jésus » et font partie de la nouvelle création, des expressions
telles que : « l'Esprit de Dieu habite en vous » (Rom. 8 : 9, 11 ; 1
Cor. 3 : 16) ; « ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils
(non pas : enfants) de Dieu » (Rom. 8 : 14). Dans cette sphère céleste, cette
nouvelle création, il y a une communion plus intime avec Dieu et une action
permanente (quoique pas nécessairement sensible) du Saint-Esprit. Ceci est
possible parce qu'ils ne sont plus pécheurs, étant morts par rapport au péché
et à l'ancienne humanité. Cette action permanente n'existe pas à la Pentecôte
qui concerne Israël et l'ancienne création.
Mais en Eph. nous dépassons même
la sphère céleste et Eph. 5 : 18 dit une chose entièrement différente des
autres textes. Ici c'est le Saint-Esprit qui rend parfait ou accompli. Nous
avons en effet de nombreux textes qui mentionnent encore cette action : « En
sorte que vous soyez accomplis (plèroô), jusqu'à toute la plénitude (plèrôma)
de Dieu », Eph. 3 : 19. Voir aussi Eph. 1:23; 4: 10; Phil. 1: 11; 2:2; 4:
18-19; Col. 1 : 9, 25 ; 2 : 10 ; 4 : 17, etc. Le but est : « l'état d'homme
parfait, à la mesure de la stature de la plénitude (plèrôma) du Christ », Eph.
4 : 13. Il faut être accompli (plèroô) en Lui, Col. 2 : 10.
Dans chaque position : enfant,
fils, homme parfait, dans chaque sphère, on est invité à marcher d'une manière
digne de sa vocation selon la capacité que Dieu a donnée à cet effet. Il faut
donc dans chaque cas, quant à la marche journalière, s'abandonner entièrement à
Dieu afin d'atteindre la plénitude de grâce correspondant à cette sphère.
3 (3) Les textes cités montrent qu'on pouvait aussi être « rempli du
saint-esprit " avant la Pentecôte et nous croyons que cette action
spéciale correspond à celle qu'éprouvèrent les prophètes et d'autres dans l’A.
T.
Page 112
Voir ainsi p. ex. dans 1 Pi. 2
et 3 les exhortations de Pierre aux Juifs dispersés, nés de nouveau (1 Pi. 1 :
23). Voir p. ex. aussi comment Paul demande aux « fils » de se regarder comme
morts au péché (Rom. 6 : 11), mais de se donner eux-mêmes à Dieu (v. 13). Voir
enfin comment Paul, après les Actes, exhorte aussi ceux de la sphère sur
céleste à marcher d'une manière digne de leur vocation (Eph. 4 : 1 et Col. 3).
Les Épîtres de Paul
Il est intéressant pour notre
sujet, de distinguer entre les épîtres de Paul écrites pendant et celles qui
sont écrites après la période des actes. Le groupement suivant a été accepté
par la grande majorité des théologiens :
Épîtres que Paul a écrites
pendant la période des Actes
Romains
1 et
2 Corinthiens
Galates
1 et
2 Thessaloniciens
Épîtres que Paul a écrites
après Actes 28 :29
Éphésiens
Philippiens
Colossiens
2
Timothée
Philémon.
On n'est pas d'accord sur
l'ordre dans lequel les épîtres de chaque groupe ont été écrites, excepté pour
ce qui concerne 2 Timothée, qui est la dernière en date. Les dates de 1 Tim. et
de Tite sont incertaines. Nous pouvons très bien laisser ces deux épîtres de
côté, lors d'un premier examen. Il est en effet important d'omettre au début
tout ce qui n'est pas certain. Si l'on accepte les conclusions générales de
notre examen, le contenu des autres épîtres ne constituera plus une difficulté
importante (1).
1 (1) Si nous négligeons la critique moderne, l'épître de Jacques est
considérée, habituellement, comme étant une des premières en date. L'Évangile
selon Jean est sans doute écrit après le temps des Actes, mais il ne fait que
rendre fidèlement le passé. L'Apocalypse est aussi de composition tardive, mais
ne concerne que ce qui est encore maintenant dans l'avenir.
Page 113
Comme certains théologiens des
temps actuels ont une tendance à croire que les épîtres aux Eph. Col. et celle
à Philémon ont été écrites en prison à Césarée et non à Rome, nous examinerons
sommairement leurs arguments.
Le Dictionnaire
Encyclopédique de la Bible, rédigé sous le signe général du modernisme,
donne les arguments suivants, au chapitre « Colossiens » :
Les arguments sérieux
paraissent être :
a)
la mention, en Col. 4 : 10, des trois seuls collaborateurs juifs de Paul, alors
que, d'après Rom. 16, il en avait davantage à Rome ;
b)
la différence entre le groupe Col., Philémon., Eph., et Philipp.
vraisemblablement composée à Rome ;
c)
la mention par Tacite d'un grand tremblement de terre dans la région
colossienne en 60-61, et le silence à ce sujet de Col., Philém., Eph. qui
seraient donc antérieures à cet événement ;
d) le vide de trois ou quatre
ans dans l'activité épistolaire de Paul, d'après l'hypothèse romaine.
La réponse à ces arguments est
bien simple.
a) Col. 4 : 10 et 11 nous informe en effet qu'Aristarque,
Marc et Jésus étaient les seuls qui travaillaient avec Paul tandis que Rom. 16
mentionne un grand nombre de collaborateurs. Il n'y a pas ici une question de
lieu, mais de temps. À Rome, aussi bien qu'ailleurs, l'attitude des chrétiens
vis-à-vis de Paul a changé. Depuis qu'il parle dans ces épîtres aux Eph.,
Phil., Col. du grand mystère caché de tout temps, on l'abandonne (Voir Phil. 2
: 21 ; 2 Tim. 1 : 15 et ce que nous avons dit de cette question ci-dessus). Il
n'est donc pas étonnant qu'il n'y ait que trois fidèles à Rome après le temps
des Actes. On se rend compte que cet argument tombe complètement dès qu'on voit
la différence radicale entre le temps des Actes et la période actuelle.
Col. 4 : 11 est au contraire un
argument en faveur de Rome, car s'il s'agissait de Césarée, on ne voit pas
pourquoi Philippe ne serait pas mentionné. Cet évangéliste venait de recevoir
Paul avant sa captivité à Césarée (Act. 21 : 8-10).
Page 114
b) On fait remarquer qu'il y a
une différence entre le groupe Col., Philémon, Eph. et l'Épître Aux
Philippiens. Mais pourquoi cela serait-il une indication que ces trois
premières ont été écrites en un endroit ou un temps différent ? Il y a
d'ailleurs entre Phil. et Eph. Col. 2 Tim. une correspondance d'idées et de
style remarquable, qui sont en faveur de l'opinion qu'elles ont été écrites
approximativement en même temps. Voir aussi le tableau p. 62.
c) L'argument du tremblement de
terre est peut-être d'importance pour ceux qui considèrent l'Écriture comme un document
non entièrement inspiré par Dieu. Peut-on sérieusement s'attendre, en des
épîtres de cette valeur, atteignant la perfection, que mention soit faite d'un
événement terrestre sans rapport direct avec le sujet ? Et si ce tremblement de
terre a eu lieu, qu'est-ce qui empêche que Paul, s'il l'a jugé à propos, ait
écrit à ce sujet dans d'autres lettres (non-inspirées) ? Enfin on est d'accord
que l'Épître Aux Philippiens a été écrite à Rome. Or elle non plus ne dit rien
de ce tremblement de terre.
d) Le vide de trois ou quatre ans dans l'activité
épistolaire (tout au moins en ce qui concerne les épîtres inspirées) s'explique
très bien du fait du changement radical de dispensation. N'y a-t-il pas un vide
de ce genre entre le chemin de Damas et l'activité de Paul pendant son premier
ministère ? (Voir Gal. 1 : 18).
En résumé il semble qu'il ne
reste aucun argument en faveur de Césarée. Voyons maintenant ce qui est en
faveur de Rome.
Pour Phil. on ne peut pas
hésiter. Paul dit en Phil. 4 : 22 : « Tous les saints vous saluent, et
principalement ceux de la maison de César. » Ceci indique Rome. Il en est de
même de Phil. 1 : 13 : « Dans tout le prétoire. »
En Phil. 1 : 26 et 2 : 24 il
parle de son retour auprès des Philippiens. Or à Césarée, il n'avait aucune raison
pour s'exprimer ainsi. Il venait d'aller à Jérusalem et voulait visiter Rome.
Étant arrêté, il en appelle à César afin d'aller à Rome. Nous verrons encore
plus loin qu'il n'est ici nullement question de la Macédoine.
À Césarée il était enchaîné
(Act. 26 : 29) et même si on lui laissa un peu de liberté et qu'on n'empêcha
aucun des siens de lui rendre service (Act. 24 : 23), ceci n'était pas
comparable à son état à Rome. Là, il avait une demeure particulière (Act. 28 :
16, 30) et il prêchait en toute liberté et sans obstacle (Act. 28 : 31).
Page 115
L'impression que donnent les
épîtres aux Phil. et Col. sous ce rapport est nettement en faveur de Rome.
L'épître à Philémon est aussi
en faveur de Rome. Il est bien plus naturel qu'un esclave (Onésime) se soit
enfui vers la grande capitale, que vers un centre peu important comme Césarée.
Au verset 22 Paul demande à Philémon de lui préparer un logement à Colosse. Or,
comme nous l'avons déjà dit, Paul n'avait aucune intention d'aller en Asie
Mineure quand il était à Césarée. En quittant Milet, il avait même dit aux
anciens d'Éphèse : « Je sais que vous ne verrez plus mon visage. » (Act. 20 :
25).
Le grand théologien anglais
Lighfoot a examiné en détail dans quel ordre les épîtres aux Eph., Phil. et
Col. ont été écrites et le résultat de son étude est que celle aux Phil. doit
être la première en date. Comme il est certain que cette épître a été écrite
durant la captivité à Rome, les autres ne peuvent donc pas avoir été composées
à Césarée.
Il est aussi assez
caractéristique que tous les chrétiens ayant la plus grande vénération pour la
Parole inspirée sont unanimes à accepter Rome.
Notre étude concernant le
contenu de ces épîtres, confirme qu'elles sont nettement différentes de celles
écrites pendant la période des Actes et montre qu'il est tout à fait impossible
qu'elles aient été écrites de Césarée.
Les Sur célestes
Le mot grec pour « ciel » est «
Ouranos », l'adjectif « céleste » est « ouranios ». Paul parle du troisième
ciel (2 Cor. 12 : 2) et le pluriel « cieux » est employé plus souvent que le
singulier « ciel ». On doit donc distinguer entre plusieurs cieux.
Nous mentionnons en premier
lieu le ciel atmosphérique, le ciel bleu, la « voûte » d'azur. L'impression
qu'il nous donne est en effet celle d'une voûte et il est intéressant de faire
observer que, si certains « esprits forts » se sont moqués de cette conception,
la science confirme qu'à une dizaine de kilomètres au-dessus de la terre
commence une couche diffusante, qui exerce une action plus grande sur la
lumière bleue du soleil, dont la longueur d'onde est plus petite que celle des
autres couleurs intenses.
Page 116
Au-dessus de l'observateur, il
y a donc littéralement une voûte bleue gazeuse à une hauteur d'environ 10
kilomètres. Cette couche est la limite de la stratosphère, qui comprend encore
une couche ozonée et des couches ionisées, parmi lesquelles les fameuses
couches d'Heaviside et d'Appleton, qui semblent jouer un si grand rôle dans la
propagation des ondes radio-électriques courtes.
La Parole mentionne aussi un
mi-ciel en Apoc. 8 : 13 ; 14 : 6 ; 19 : 17 (mèsouranèma). Il ne faut pas voir
là le « milieu du ciel » atmosphérique du fait qu'il est question d'un « aigle
» et d' « oiseaux » qui « volent » dans ce ciel. En effet, cet aigle et ces
oiseaux sont des êtres spirituels. L'aigle parle et prophétise, un ange parle
aux oiseaux. Ce ne sont donc pas des animaux. Apoc. 14 : 6 dit d'ailleurs qu'un
ange volait dans ce mi-ciel. Comme dans toute prophétie et vision spirituelle,
il faut distinguer entre deux significations du mot littéral. L'aigle n'est pas
littéralement un aigle, mais bien littéralement un être appelé « aigle ». Il
faut prendre les faits littéralement, dans le sens qu'ils se produiront un
jour, mais il faut se souvenir que les choses qui dépassent notre sphère
terrestre doivent nécessairement être exprimées à l'aide de nos mots courants.
Il ne s'agit donc pas dans tout ceci, de vagues symboles, mais de réalités
encore plus réelles que celles que nous connaissons.
L'Ancien Testament parle des
cieux et des « cieux des cieux » (p. ex. Deut. 10 : 14 ; 1 Rois 8 : 27 ; Néh. 9
: 6). L'expression « cieux des cieux », distincte de « cieux », indique une « région
» plus élevée, mais qui appartient encore à la création (Néh. 9 : 6). Les cieux
des cieux aussi bien que les cieux ont leur « armée », c.-à-d. des multitudes
d'êtres. On se rappelle que ces armées, conduites par le Seigneur, sont souvent
mentionnées dans les Écritures.
Nous voyons ainsi trois régions
dans les cieux : le ciel atmosphérique, le ciel interplanétaire (et
interstellaire) et le ciel du ciel. C'est sans doute jusqu'à ce troisième ciel
que Paul a été ravi (2 Cor. 12 : 2).
Mais ni la terre, ni les cieux,
ni les cieux des cieux, ne peuvent « contenir » Dieu (1 Rois 8 : 27). Tout ce
que nous avons mentionné jusqu'à présent appartient en effet à la création
(Néh. 9 : 6) et Dieu est en dehors de toute création.
Page 117
Les expressions « au-dessus de
tous les cieux » (Eph. 4 : 10) ; « qui a traversé les cieux » (Héb. 4 : 14) et
« plus élevé que les cieux » (Héb. 7 : 26) ne doivent donc pas nous étonner. Il
y a nécessairement une « région » qui dépasse la création.
Quoi de plus approprié alors
qu'une expression spéciale pour cette sphère ? Or le N. T. utilise 19 fois
l'adjectif « epouranios », formé de la préposition « épi » (sur) et de «
ouranios » (céleste). Dans la plupart des cas, ce mot indique qu'une chose est
d'origine sur-céleste, mais dans cinq cas il est clair qu'il s'agit de la
présence de quelqu'un dans cette sphère. On trouve alors l'expression : « en
tois epouraniois » c à d. « dans les sur célestes » (Eph. 1 : 3, 20 ; 2 : 6 ; 3
: 10 ; 6 : 12).
Quand on examine ces questions,
une série de problèmes se posent. D'abord, si donc Dieu est au-dessus de tout,
comment Mat. 5 : 16 et Col. 4 : 1 disent-ils qu'Il est dans les cieux ? Quelles
que soient nos idées sur les cieux, nous avons ici une de ces « contradictions
» que la critique aime à relever. Or ces « contradictions » sont toujours très
utiles pour montrer notre faiblesse, l'étroitesse de nos idées et la divinité
de la Parole. Nous pourrions répondre que « cieux » est une expression qui a
une signification générale et peut indiquer tout ce qui est en contraste avec
la terre. Le mot cieux peut ainsi comprendre toutes les « régions » dont nous
avons parlé, de même que l'expression « les saints » peut comprendre tout le
tabernacle, divisé en parvis, lieu saint et saint des saints. Du point de vue
de la terre tous les cieux se confondent. Ce n'est que quand on s'élève qu'on
peut bien distinguer. Il en est de même d'un paysage lointain où tout est
confus et où les maisons, les routes, les arbres, etc., ne se distinguent que
quand on approche. Quand on se place donc au point de vue terrestre, le mot «
cieux » peut indiquer tout ce qui est au-dessus de la terre et il n'y a alors
nulle contradiction entre « dans les cieux » et « au-dessus des cieux ».
Ce qui précède est une
explication suffisante, mais on peut aller plus loin en faisant un effort pour
ne pas rester dans les chaînes matérialistes. Dieu est au-dessus de la
création, mais cela veut-il dire qu'il faut L'exclure de la création ?
Il est évident que non. Des phénomènes physiques pourront nous faciliter la
compréhension de cette thèse.
Page 118
On a dû considérer l'existence
d'un « éther » qui s'étend partout, même dans le vide, même dans les corps
matériels. Ainsi, là où il y a de la matière, il y a aussi de l'éther. Les
phénomènes électromagnétiques, comme les ondes de T. S. F., se propagent dans
l'éther, mais ne sont pas nécessairement gênés par la matière. Ces « ondes »
sont dans l'éther, mais si une portion de cet éther est occupée par un corps
matériel mauvais conducteur de l'électricité, ces ondes seront aussi dans ce
corps. Par rapport à l'espace, les ondes se trouvent à la fois dans les deux ;
selon leur nature, elles ne se manifestent que dans l'éther. Ces ondes sont
(selon leur nature) au-dessus de la matière, quoique (par rapport à l'espace)
elles peuvent se trouver dans la matière. Il y a pénétration. Nous croyons que
d'une manière analogue les sphères célestes pénètrent la sphère terrestre et
que la sphère sur céleste pénètre le tout. Les anges, qui d'après leur nature appartiennent
à la sphère céleste, peuvent très bien apparaître sur terre, tout en restant
dans leur sphère (1). Quand le Seigneur se présentait sous forme humaine
devant Abraham p. ex., Il restait dans les cieux selon Sa nature, quoique se trouvant
sur terre par rapport à l'espace. De même le Fils de l'homme est à la fois «
descendu du ciel », et « dans le ciel » (Jean 3 : 13).
Pour qui donc n'est pas limité
par des idées étroitement matérialistes, il n'y a nulle contradiction si d'une
part on dit que certains êtres sont sur terre et que d'autre part, ces mêmes
êtres sont au-dessus de la terre.
Il est bien entendu qu'en
considérant les « sur célestes », il devient difficile d'employer des mots
adaptés à ce qui est terrestre. L'idée d'espace, de lieu, d'endroit n'est,
strictement parlant, plus applicable parce qu'il s'agit ici de ce qui dépasse
la création, donc aussi l'espace et le temps. Mais nous pouvons cependant bien
concevoir que cette sphère sur céleste pénètre tout, que Dieu peut être partout
et pourtant au-dessus de tout. Il est partout dans le sens spatial et absolu,
et au-dessus de tout d'après son essence.
Dire que Dieu, ou un ange, est
sur terre, ne veut pas encore dire que nous le voyons.
1 (1) Ils peuvent aussi « quitter » leur sphère en passant d'une manière
définitive à la sphère terrestre. C'est ce qui s'est produit avec certains
d'entre eux (Jud. 6). il y a là non seulement changement de lieu, mais
changement de nature.
Page 119
Tant qu'un être d'une sphère
supérieure ne réagit pas sur la sphère inférieure, les organes de cette sphère
inférieure ne peuvent évidemment rien enregistrer. De même nous ne voyons ni ne
sentons les ondes électromagnétiques, même quand elles traversent notre corps.
Pour qu'il y ait une impression, il faut une réaction d'une sphère sur l'autre.
Pour devenir visible, il faut donc que l'ange se « manifeste ». En général on
voit que les êtres des sphères inférieures ne peuvent avoir connaissance des
sphères supérieures que de deux manières : ou bien un être de la sphère
supérieure communique avec la sphère inférieure et, quand il s'agit de Dieu, il
y a révélation, ou bien un être de la sphère inférieure est élevé, par une
action spéciale, dans la sphère supérieure et il y a vision en esprit.
Il est bon d'examiner de plus
près la signification de « au-dessus » dans Eph. 4 : 10. Le grec a ici «
huperanô », ce qui veut dire littéralement : « au-dessus en haut ». Nous
rencontrons ce mot encore en Eph. 1 : 21 et Héb. 9 : 5. Or ce dernier texte
nous permet de mieux comprendre la signification, parce que les choses
spirituelles sont ici représentées matériellement. Au-dessus (huperanô) de
l'arche se trouvent les chérubins. Si on considère l'arche en général, les
chérubins en font partie. Examine-t-on les détails, alors on distingue p. ex.
le coffre, le couvercle et les chérubins. Ex. 25 : 21 dit ainsi : « tu mettras
le propitiatoire sur l'arche. » Dans un sens, le propitiatoire fait partie de
l'arche, dans un autre sens, il est au-dessus. D'une manière analogue les sur
célestes peuvent, dans un sens, faire partie des cieux et, dans un autre sens,
se trouver au-dessus.
Mais on a objecté que dans «
huperanô pantôn tôn ouranôn » l'expression « des cieux » est au génitif et que
« au-dessus de tous les cieux » n'indiquerait donc pas des régions au-dessus
des cieux, mais les régions supérieures des cieux. Or cela est vrai quand on
prend ici « cieux » dans son sens général, mais croit que ceci veut dire que le
Seigneur n'a pas dépassé les cieux. c'est d'abord se mettre en contradiction
avec Héb. 7 : 26 et c'est aussi limiter Dieu aux cieux, puisque Eph. 1 : 20 dit
que le Christ est assis à Sa droite. Si ce génitif nous forçait vraiment à
accepter ce sens, on pourrait encore comprendre que ce verset pût gêner un peu
notre manière de voir, mais il n'en est rien. N'importe qui peut s'en
convaincre par la Parole même.
Page 120
Nous avons en effet en Mat. 5 :
14 une expression qui se rapproche beaucoup d' « huperanô », savoir « epanô », et
qui est également utilisée avec le génitif. Or « sur une montagne » ne veut
certainement pas dire qu'il s'agit de la région supérieure de la montagne.
Comme « huper » est « au-dessus », tandis que « épi » n'est que « sur », «
huperanô » indique encore bien plus une chose supérieure que « epanô ».
Mais pourquoi le texte inspiré
a-t-il « sur célestes » et non « sur cieux » ? Le grec use souvent d'ellipses
et dans le cas présent il faut ajouter un mot, dont « sur célestes » est
l'adjectif. Or comment parler de ce qui est au-dessus des cieux ? Ce ne sont
plus des « cieux », ni des « espaces », ni des « régions » puisqu'on dépasse la
création, l'espace et le temps. Nous avons parfois mis « sphères », mais le,
mieux n'est-il pas de garder l'ellipse et de dire « sur célestes » sans
préciser ?
On a parfois prétendu que « en
tois epouraniois » (dans les sur célestes) devait être lu : « parmi les (êtres)
sur célestes » parce que la préposition « en » se lit souvent « parmi » quand
il s'agit de plusieurs personnes. Mais on peut répondre que quand il s'agit
d'un emplacement, le sens de « en », même au pluriel, reste toujours «
dans » (voir p. ex. Mat. 6 : 2 ; 8 : 32). La préposition ne permet donc pas de
conclure s'il faut compléter l'ellipse par « êtres » ou « lieux ». Il nous
semble qu'Eph. 1 - 20, 21 doit décider ici : « en le faisant asseoir à sa
droite dans les sur célestes, au-dessus de toute domination... » « Dans les sur
célestes » ne peut pas vouloir dire « parmi les êtres sur célestes » puisque la
suite dit justement « au-dessus de toute domination » et que ces "
dominations, etc. » sont des êtres sur célestes d'après Eph. 3 - 10.
Le verset Eph. 1 - 20 rapproché
de 3 : 10, nous indique aussi que la « droite de Dieu » est encore un « lieu »
spécial parmi les « sur célestes », puisque Dieu et le Seigneur Jésus-Christ
sont à la fois dans les sur célestes et au-dessus des êtres qui se trouvent
dans les sur célestes.
Nous ne mentionnons qu'en
passant que d'aucuns ont prétendu qu'il fallait comprendre par « sur célestes »
les êtres qui se trouvent sur les planètes ou étoiles. Ils arrivent alors à
l'absurdité que Jésus-Christ -est « parmi » les êtres qui habitent les corps
célestes et, que là aussi se trouve le trône de Dieu.
Page 121
APPENDICE V
L'Église qui est le Corps de Christ est-elle l'Épouse ?
Avant tout, il faut observer
que Paul n'emploie jamais l'expression « épouse » et que « Épouse de Christ »
ne se trouve pas dans les Écritures. Celles-ci parlent de « l'épouse, la femme
de l'agneau » (Apoc. 21 : 9). Il est vrai que l'Agneau est Christ, mais
seulement en relation avec la sphère terrestre et Son humiliation. Le mariage
est aussi une chose terrestre (en Christ il n'y a ni homme ni femme) et est peu
approprié pour symboliser une relation céleste et encore moins une unité sur
céleste.
Dans l’A. T. Israël est souvent
désigné comme « femme », « épouse » et « fiancée ». Voir p. ex. Es. 54 : 6 ; 62
: 5. Cette femme s'est détournée de l'Éternel (Jér. 3 ; Os. 2 ; Ezéch. 16).
Mais Il l'invite à retourner (Jér. 3 ; Os. 2) et elle sera accueillie (Es. 54 :
1-8 ; Jér. 3 : 12-22). Ceux d'Israël qui se repentent et se tournent vers
Christ forment donc l'Épouse et existaient déjà au temps des Évangiles (Mat. 9 :
15 ; Jean 3 : 29). Ce n'était certes pas un mystère, comme l'Église dont parle
Paul après les Actes.
À la Pentecôte nous voyons que
le groupe qu'on peut appeler « l'Épouse » se développe : il était constitué
exclusivement de Juifs-chrétiens. C'est pendant le Royaume que les noces de
l'Agneau ont lieu (Apoc. 19 : 7), l'Épouse étant maintenant au complet par la
repentance nationale d'Israël.
Le mot « épouse » est au sens
strict applicable seulement pendant la noce. Après le Royaume, l'Épouse est «
femme » (Apoc. 21 : 9).
Mais on peut s'imaginer qu'il y
a une difficulté. Comment celle qui ne sera littéralement l'Épouse que dans
l'avenir, est-elle déjà appelée femme dans le passé ? La solution est aisée
quand on sait que d'après la Loi, la fiancée était déjà comptée comme « femme
». Ceci est indiqué p. ex. par Mat. 1 : 18 et 20, où Marie, qui n'est que
fiancée, est appelée la femme de Joseph.
Mais malgré tout on s'en réfère
à Eph. 5 pour dire que l'Église est l'Épouse.
Page 122
Or là non plus Paul n'utilise
pas le terme « épouse ». Il parle d'une femme et d'un mari, après leur
mariage. Comment ceci peut-il être en rapport avec l'Épouse et l'Époux dont le
mariage doit encore venir ? Au contraire Christ est ici représenté comme Chef
de l'Église du mystère. Cette Église est son Corps et non son Épouse. Le mari
doit aimer sa femme comme son propre corps. Ces deux ne sont donc pas un seul
corps, quoique étant « une seule chair ». Tout ce que Paul fait, c'est
d'évoquer l'identification de Christ et de l'Église du mystère, pour la donner
en exemple à l'homme et à la femme dans le mariage. La perfection est donnée
comme exemple à ce qui est imparfait. Mais ceci ne permet pas de retourner les
choses et de dire que l'union de Christ avec l'Église est donc du même genre
que celle qui est entre l'homme et la femme et encore moins de déduire de ce
passage que l'Église du mystère est l'Épouse de Christ.
La relation entre Christ et
l'Église du mystère était cachée de tout temps en Dieu, jusqu'à la fin des
Actes et ne peut être exprimée par quelque chose qui était connue depuis Adam.
L'identification avec Christ est d'un tout autre ordre que l'union entre femme
et homme et cette dernière ne peut d'aucune manière être utilisée pour
représenter la première.
Nous pourrions comprendre qu'on
dise que l'Église est l'Épouse, si l'on entend par là l'Église de la Pentecôte.
Mais ceci exclut alors totalement les Gentils, comme nous croyons l'avoir
montré dans Le Plan Divin, cette assemblée de croyants n'a rien à voir
avec l'Église dont parle Paul dans ses dernières épîtres.
Si nous avons insisté quelque
peu sur cette question, c'est que l'expression « Épouse » contribue à confondre
ce qui doit être distingué. Cette idée nous est aussi venue des premiers
siècles alors qu'on croyait que « l'Église » chrétienne s'était substituée à
Israël. Si cela avait été vrai, on aurait pu dire que cette Église était
l'Épouse.
Page 123
Peut-on juger de la valeur d'un message
d'après le nombre de conversions obtenues ?
Il n'est pas rare d'entendre
dire que la suprême épreuve d'un message est le nombre de conversions qu'il
produit. Il est vrai qu'on ne saurait surestimer l'importance de la conversion,
mais avant de prendre le nombre de conversions comme indice de la valeur d'un
enseignement, il faudrait pouvoir donner une réponse satisfaisante aux
observations suivantes :
1. Il n'est pas facile pour
nous de distinguer une vraie conversion d'un mouvement produit par l'enthousiasme
ou la sentimentalité, ou même par de basses pensées. Il faudrait donc observer
les « convertis » pendant quelque temps au moins, et corroborer les
statistiques initiales par des statistiques révisées établies parfois des
années plus tard.
2. Un message non scripturaire
peut apporter la conversion. Dans ce cas, le message ne peut pourtant pas
manquer d'avoir en même temps (comme tout ce qui s'écarte de la vérité) une
action néfaste. Comment apprécier l'étendue de cette action ? Elle peut, par
les conséquences ultérieures qui nous échappent, devenir considérable.
3. Les tribulations peuvent
apporter la repentance. Est-ce à dire que ces tribulations sont bonnes en
elles-mêmes ?
4. Il y a une chose encore plus
importante que la conversion : c'est la glorification de Dieu. Si notre but
principal est de glorifier Dieu, nous devons nous demander avant tout si ce que
nous disons et faisons est scripturaire, car ce qui est scripturaire seulement
peut aboutir à la gloire de Dieu. Ainsi le critérium ne sera pas le nombre de
conversions obtenues, mais la fidélité scrupuleuse de la prédication à la
Parole. Si notre but est essentiellement la conversion des pécheurs, nous
risquons souvent d'être moins attentifs à ce critérium souverain.
Page 124
Si on répond que la conversion
glorifie Dieu et que celui qui a pour but la conversion a donc aussi pour but
la glorification de Dieu, nous répliquerons que des conversions peuvent
résulter de choses qui ne sont pas scripturaires et qu'un message très
insuffisamment scripturaire peut même être utilisé par Dieu pour amener la
conversion. C'est malgré l'imperfection du message que Dieu a alors provoqué un
bon résultat. On peut ajouter qu'il est telles « conversions » sensationnelles
qui ont introduit au milieu des vrais chrétiens des éléments dont la présence y
a causé par la suite le scandale. Si on est d'accord pour admettre que le but
suprême doit être la glorification de Dieu, pourquoi ne pas s'en tenir à ce but
? Des conversions immédiates ou ultérieures en résulteront d'une bien plus
grande certitude, et nous éviterons les conséquences fâcheuses de ce qui n'est
pas strictement scripturaire.
5. Il y a plus. Souvent un
examen approfondi de la Parole, et seul un tel examen permet d'être
scripturaire, est négligé ou même repoussé sous prétexte que le « simple
évangile » suffit pour convertir. Or s'il est vrai qu'un message simple doit
être présenté aux débutants, encore faut-il qu'il soit scripturaire et à cette
fin celui qui le délivre doit en connaître un peu plus, donc avoir examiné
plus. Ensuite d'autres ont besoin de messages plus complets et ceux qui parlent
d'un « simple évangile » généralement ne s'en contentent pas en pratique, mais
vont plus loin.
En résumé il arrive trop
souvent que l'on néglige l'étude des Écritures prétextant que la conversion «
des âmes » est plus importante. Ainsi on court le risque de ne pas être
scripturaire et de sacrifier la gloire de Dieu.
6. Personne ne peut prétendre
être absolument dans la vérité. Si Dieu donne des bénédictions, c'est donc
malgré ce qui est anti-scripturaire. Dieu peut bénir quand cette attitude non
conforme à Sa volonté est excusable. Ainsi, pour prendre un cas extrême, un
homme qui devient conscient de sa nouvelle naissance, mais qui est encore peu
instruit dans la vérité, peut dans l'enthousiasme du moment dire beaucoup de
sottises. Mais le Saint-Esprit peut néanmoins utiliser ce message. Tout autre
serait le cas d'un prédicateur qui dirait la même chose. Il serait responsable
de beaucoup d'expressions anti-scripturaires et ne pourrait pas se justifier en
disant que Dieu a cependant béni ce message chez l'autre.
Page 125
Quand l'attention est attirée
sur certaines erreurs, on se contente trop souvent de répondre que tant de
grands et saints prédicateurs ont proclamé ces choses, que leur message a été
béni et qu'on veut se tenir à cela. On trouve inutile de réexaminer la Parole
et on se base sur une « autorité », tout comme le fait l'Église Romaine. Or il
se peut très bien que ce message ait été béni malgré ce qu'il avait
d'anti-scripturaire. Ces saints prédicateurs peuvent s'être mal exprimés sans
le savoir, ils pouvaient être excusables. Mais celui auquel on propose de
réexaminer la question parce qu'on est persuadé, après une sérieuse étude
spirituelle, qu'elle est anti-scripturaire et qui refuse de faire une tentative
d'examen personnel n'est plus excusable (1). Il croit une chose parce que Calvin, Luther, Moody,
Spurgeon, Wesley, Darby, Bullinger ou un autre l'ont cru. Il a l'esprit
catholique-romain contre lequel les réformateurs se sont élevés.
Toute foi qui se base sur une
autorité humaine, qui n'est pas personnelle, est vaine. L'examen continuel, des
Écritures, sous la conduite du Saint-Esprit, reste toujours nécessaire pour glorifier
Dieu et pour amener chaque créature à son but.
7. Mais ce sont là simples
raisonnements, dira-t-on. Soit. Mais il y a aussi des faits et nous n'en
toucherons qu'un seul en posant la question : Ose-t-on appliquer à l'Apôtre
Paul ce principe que la valeur d'un message, ou sa conformité à la volonté
divine, doit être jugée d'après le nombre de convertis ? Il se peut que pendant
la période des Actes le résultat de cette application semble parfois confirmer
le principe, mais plus tard ? A-t-on été frappé par ce fait formidable que si,
pendant les Actes, « tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la parole du
Seigneur » (Actes 19 : 10) par l'intermédiaire de Paul, nous lisons qu'après
cette période Paul dit : « tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » (2 Tim. 1 : 15) ?
1 (1) On peut, à ce sujet, se rappeler ce que Calvin disait dans son «
Epistre au Roy de France » : « Davantage il falloit considérer ce que dit
sainct Cyprien en quelque passage, assavoir que ceux qui faillent par
ignorance, combien qu'ils ne soyent pas du tout sans coulpe, toutefois peuvent
sembler aucunement excusables, mais que ceux qui avec obstination rejettent la
vérité, quand elle leur est offerte par la grâce de Dieu, ne peuvent prétendre
aucune excuse. »
Page 126
Si nous devons donc juger Paul
d'après ce principe, nous devons conclure que l'enseignement qu'il a donné
après les Actes était non seulement de peu de valeur, parce qu'il n'avait pas
fait de nouveaux convertis, mais qu'il était même dangereux parce qu'il égarait
ceux qui avaient déjà été convertis. Or quel était cet enseignement ? Celui des
épîtres aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Colossiens, qui constitue de
l'aveu unanime, le message le plus élevé, le plus spirituel de la Bible tout
entière.
Il nous semble donc que la
conclusion est nette : Jamais on ne peut juger de la valeur d'un message par le
nombre de convertis. Toujours il faut, avant tout, se demander si ce qu'on fait
et ce qu'on dit est scripturaire et glorifie Dieu. La Parole inspirée doit être
le seul critère réel parce que c'est Dieu même qui a parlé par ce moyen. Et ces
Écritures devront être soumises à une étude approfondie et personnelle par
tous, mais surtout par ceux qui veulent enseigner.
De toute manière, il est bon de
ne pas trop considérer les hommes, ni même leur conversion. La gloire de Dieu
prime tout, et si Dieu est glorifié par ce que nous faisons, nous avons atteint
le but. Dans ce cas, le petit nombre de conversions ne doit pas nous étonner :
nous sommes dans un âge « mauvais » (Gal. 1 : 4), dont Satan est le « dieu » (2
Cor. 4 : 4). En général ce sont les enseignements non scripturaires (pouvant
avoir toutes les apparences d'un message de lumière) qui ont le plus de succès
dans le siècle présent. Dieu se tait parce qu'Il a tout dit dans les Écritures.
Ne cherchons donc pas d'encouragements venant des hommes, des résultats de
notre travail, de nos expériences. Seule la Parole est un guide sûr, au sein de
ce qui est visible. Ne cherchons pas de preuves de la bénédiction divine dans
ce que nous voyons ou sentons, mais seulement dans ce que nous ne voyons pas :
la foi scripturaire, la communion avec Dieu, la proximité du Seigneur et
l'action du Saint-Esprit.
Quelqu'un nous demandera
peut-être si la parole du Seigneur : « Car on reconnaît l'arbre à son fruit »
n'a aucune valeur pour nous ; notre réponse sera fort aisée. Nous y attachons
au contraire la plus grande importance, comme à toute la Parole. Appliquons-la
donc au christianisme officiel. Quels sont les fruits depuis 1.900 ans ? Nous
entendons par là, comme notre interlocuteur supposé, les fruits visibles. Ce
fruit, c'est le désordre mondial. Si c'est par cette parole qu'il faut
contrôler la valeur du christianisme officiel, le résultat lui est donc fatal.
Page 127
Voyons maintenant l'application
à Paul. Comme fruit visible il y a peu de chose et ceci nous montre de suite
que tout fruit n'est pas nécessairement visible. Les enseignements de
Paul ne porteront que peu de fruits visibles pendant le mauvais éon présent,
mais les résultats réels dépasseront de loin ceux des autres messages.
N'arrive-t-il pas trop souvent qu'on sacrifie l'avenir au profit de quelques
résultats immédiats ?
La parole citée pouvait
cependant être comprise dans le sens de fruits visibles. Mais il ne faut pas
oublier, comme le fait le christianisme officiel, que ces paroles avaient
surtout en vue les conditions terrestres du Royaume. À l'époque actuelle
l'arbre sera aussi connu par le fruit, mais gardons-nous de ne faire attention
qu'à ce qui est visible pour nous et à ce que nous croyons être bons. Ce n'est
pas à nous d'estimer le fruit parce que nous ne saurions le faire actuellement.
Mais ce que nous pouvons et devons faire, c'est être scripturaires. Alors les
conséquences sont entièrement entre les mains de Dieu et il y aura certainement
des fruits abondants et de bons fruits.
APPENDICE VII
S'il y a une tradition
liturgique ancienne, c'est bien celle de la messe. Les écrits des premiers
siècles font souvent allusion à cette cérémonie (1), qui a le caractère d'un
sacrifice. Les plus anciens documents ne donnent pas de détails parce qu'on
prenait soin de cacher le plus possible aux non-baptisés ces rites considérés
comme sacrés. Mais des allusions montrent que cette cérémonie était connue et
observée par les croyants. Dans les documents moins anciens, plus de détails
sont donnés, et s'il est vrai que la liturgie n'est pas partout identique, les
nombreux points communs montrent qu'il y a une source commune, qui, par la
tradition verbale, a donné lieu à quelques variantes.
1 (1) Voir p. ex. The Early Eucharist par W. B. Frankland, qui cite beaucoup de passages.
Page 128
Ce qui prouve surtout l'ancienneté
de la cérémonie, c'est sa ressemblance (même sous sa forme moderne) avec la
Pâque juive et le repas du sabbat. On y trouve les mêmes chants, les mêmes
prières, les mêmes lectures, les mêmes allusions à la création, à la sortie
d'Égypte et aux faits glorieux d'Israël (2). Nous avons d'ailleurs déjà vu que les chrétiens
d'Asie gardèrent même longtemps le 14 Nissan pour célébrer la Pâque et
prétendaient avoir reçu des Apôtres cette ancienne tradition. En résumé, il est
indéniable que la masse des premiers chrétiens n'a pas seulement observé un
rituel sommaire, se limitant aux quelques détails mentionnés par les Écritures
au sujet de la Pâque juive et de ce qu'avait fait et dit le Seigneur quand Il
fêtait la Pâque pour la dernière fois avant l'arrivée du Royaume, mais qu'elle
a suivi assez fidèlement le rituel juif.
Ces chrétiens essayaient d'être
logiques. Ils prétendaient remplacer Israël, ou mieux encore, être le véritable
Israël. Les « fêtes de l'Éternel » (Lev. 23), la Pâque, la fête des pains sans
levain, la fête des prémices de la moisson, la fête des pains agités
(Pentecôte), etc. devaient donc en principe être observées par « l'Église »
(3). Ils ne pouvaient pas le faire servilement, mais ils essayaient d'en garder
le plus possible. On « spiritualisa », on adapta aux conditions nouvelles et,
petit à petit, les liturgies « chrétiennes » furent « standardisées ». Si après
19 siècles la célébration de la messe ressemble encore tant à celle d'une
partie de la Pâque juive, il est certain que, tout au début, la ressemblance
était encore bien plus grande.
Il est bon de faire remarquer
ici que les juifs tenaient un repas cultuel le vendredi soir à l'ouverture du
sabbat (4). La Mishnah donne des détails à ce sujet. On bénissait le pain et le
vin, on disait des prières et on mangeait.
2 (2) Voir une étude du Dr. G. Bickell : Messe und Pascha (1872).
(3) Le célèbre théologien Ch.
Hodge dit dans son Commentary on the Epistle to the Romans, p. 69 : "
On ne peut manquer d'observer que la doctrine des Juifs a été transférée
complètement dans la chrétienté par des ritualistes. »
(4) La relation entre la messe
et le repas du sabbat a été examinée particulièrement par Drews (Realenzyklopädie
fur protestantische Theologie. Article Eucharistie) et von der Goltz (Tischgebete und
AbendmahIsgebete in der altchristlichen und in der griechischen Kirche. 1905).
Page 129
Une partie du pain était
réservée pour la fin du repas quand le père de famille prononçait la grande
bénédiction et faisait allusion à la venue du Messie. Les femmes, les enfants
et les étrangers n'étaient pas admis à cette partie du repas. Le mot hébreu «
amen » était prononcé.
Ce repas était un sommaire du
repas pascal, mais ce dernier était beaucoup plus solennel.
Pour permettre au lecteur de
mieux suivre les allusions du N. T. à certaines parties de la Pâque juive (Mat.
26 : 26-29 ; Marc 14 : 22-25 ; Luc 22 : 15-20 ; 1 Cor. 10 : 16 ; 11 : 20-26)
nous donnons ci-dessous un sommaire du rituel juif (5).
Résumé du rituel de la Pâque, juive
On verse la première coupe.
Commencement de la fête
(Kiddush).
Bénédictions.
On boit la première coupe.
On rompt le pain sans levain
(Mazzoth) (6). On rend grâces et on mange un morceau trempé dans de la sauce.
On verse la seconde coupe.
L'histoire de la Pâque
(Haggadah).
Bénédictions.
On boit la seconde coupe.
On rompt le pain sans levain.
On rend grâces et on en mange un morceau trempé dans de la sauce.
....................................................................................................................................
Souper substantiel hors du
rituel. On mange l'agneau pascal et du pain sans levain et on boit du vin.
.....................................................................................................................................
On verse la troisième coupe.
La « coupe de bénédiction ». (Voir Luc 22 : 20 : « la coupe, après
le souper » ; 1 Cor. 11 : 24 « après avoir soupé, Il prit la coupe »
1 Cor. 10 : 16
« la coupe de bénédiction »;
1 Cor. 11 25 : « cette coupe »).
Bénédictions et actions de
grâce (Voir Mat. 26 : 27 ; Marc 14 : 23 « après avoir rendu grâces »).
On boit la troisième coupe
(Voir Mat. 26 : 28 ; Marc 14 : 23 : « buvez-en tous »).
On verse la quatrième coupe.
Chant de louange (Hallel - Ps.
115-118).
Bénédictions et actions de
grâce.
On boit la quatrième coupe.
5 (5) Voir par ex. la Mishnah, le Dictionnaire de la Bible de Don
Calmet, ainsi que d'autres livres spéciaux.
(6) L'expression « rompre le
pain » indiquait un repas quelconque chez les Juifs (voir p. ex. Mat. 14 : 19).
Les Arabes parlent de « manger du sel , les Anglais de « prendre le thé », nous
disons en France « casser la croûte » pour indiquer par euphémisme un repas ;
il ne faut rien voir de plus dans l'expression « rompre le pain ». Les Juifs
rompaient souvent le pain pendant la cérémonie pascale. l'Église Romaine veut
justifier les messes quotidiennes par des textes tels que Act. 2 : 46 et ils
disent que le Seigneur a remplacé la prédication de la Parole, par la
prédication de sa chair et de son sang dans la messe.
Page 130
La Pâque « chrétienne », la
messe et la cène tirent leur origine des pratiques juives aux repas ordinaires,
aux repas du sabbat et au repas pascal. Le N. T. nous donne des exemples de ces
trois repas (7). Dans le repas du sabbat et dans celui de la Pâque,
il y avait une partie profane et une partie plus réservée. La dernière surtout
a été « christianisée » et est devenue la messe et la cène.
Ceux qui croient être le «
véritable Israël » peuvent croire aussi que Paul s'adresse à eux en 1 Cor. 10 :
1-5 où il est question des « pères » qui ont traversé la mer rouge, puisque la
mention de Rom. 9 : 4 : « A qui (c.-à-d. aux Israélites) appartiennent... les
patriarches (même mot grec que « pères ») » ne les gêne pas. Le reste de 1 Cor.
10 et 11 peut donc aussi les concerner. Mais comment expliquer l'attitude de
ceux qui se rendent compte qu'Israël a encore, comme nation, une mission à
remplir, mais qui croient que la nouvelle alliance (1 Cor. 11 - 25) est conclue
avec eux, alors que Jérémie dit clairement qu'elle concerne Israël et Juda
(Jér. 31 : 31) ?
Nous devons reconnaître que les
Églises romaines et anglicanes sont les plus « apostoliques » dans ce sens
qu'elles sont les plus fidèles aux 12 Apôtres de la circoncision. Mais ainsi
elles sont aussi les plus anti-scripturaires. Non pas parce qu'elles gardent ce
qu'il y a de personnel dans ces enseignements (et qui concernent tout homme)
mais en ce qu'elles veulent remplacer Israël comme nation et suivre les
cérémonies juives.
La Réforme s'est rapprochée de
Paul, mais en même temps a voulu conserver ce qui appartient à Israël ; de là
une position difficile et instable.
7 (7) Pour le repas ordinaire, la " fraction du pain », voir Mat. 14
: 19 Act. 2 : 42, 46 ; 27 : 35. Pour le repas du sabbat, voir Act. 20 7, 11 et
ne pas oublier que " le premier jour de la semaine " est
littéralement « un des sabbats , (Voir Le Plan Divin, App. 5). Pour le repas
pascal, voir Mat. 26 : 26, 27 ; Marc 14 : 22, 23 ; Luc 22 : 19, 20 ; 1 Cor. 10
: 16 ; 11 : 24, 25. On peut montrer que contrairement à l'opinion de certains,
le Seigneur a fêté la Pâque le 14 Nissan, le jour même de sa crucifixion.
Page 131
La date de la Pâque
D'après Ex. 12 : 2 l'année
devait commencer par le mois de Nissan et la Pâque tombait le 14 Nissan (Ex. 12
: 6 ; Lev. 23 : 5, etc.). En ce mois il fallait aussi apporter au sacrificateur
une gerbe ; c'étaient les prémices de la moisson. Ce premier mois devait donc
être choisi de telle sorte que ces prémices pussent être apportées au Temple.
Or, en Palestine, la date de la moisson ne diffère pas beaucoup d'une année
solaire à l'autre. D'autre part l'année étant divisée depuis longtemps en 12
mois lunaires, le premier mois venait un peu plus tôt chaque année. À un
moment donné les prémices ne pouvaient donc plus de ce fait être offertes au
moment voulu et il fallait alors recourir à l'intercalation d'un mois
supplémentaire (1). Le 14 Nissan pouvait donc, dans l'année solaire,
varier d'environ 30 jours.
Plus tard ont prit comme règle d'insérer
un mois supplémentaire de telle manière que l'équinoxe du printemps tombait
toujours avant la Pâque. Cependant ce mois n'était jamais inséré dans une année
sabbatique.
Au I siècle, à part la
controverse déjà signalée, il y en eut une autre entre ceux qui observaient la
Pâque le 14 Nissan et d'autres qui préféraient le 15 (les quintodécimans).
Cette controverse fit couler beaucoup de sang.
1 (1) Les indications divines pour les fêtes et les sabbats ne pouvaient
être observées qu'en Palestine. Pour tout autre pays la différence en
longitude, latitude, température et autres conditions climatiques devaient
conduire à d'autres résultats. Ceci aussi indique que ces cérémonies n'étaient
instituées que pour Israël et, de plus, pour être célébrées par ce peuple dans
son pays.
Page 132
Le concile de Nicée décida en
325 que la fête pascale serait observée le dimanche, mais il restait à fixer
quel dimanche. On choisit le dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe
d'hiver. Mais comme ce moment dépend de la longitude, il fallait aussi fixer
l'endroit où cette observation devait se faire. On décida que cette date devait
être calculée à Alexandrie et que l'évêque de cet endroit devait communiquer l'information
à Rome. C'était une innovation, puisque d'après les Écritures ce jour devait
être fixé en Palestine.
Plus tard, on a voulu fixer la
date de la Pâque en se basant sur un cycle d'années. On a d'abord adopté un
cycle de 8 ans, puis de 84 ans, puis de 532 ans, enfin de 19 ans. C'est ce
dernier qui permet de fixer le « nombre d'or » et la « lettre dominicale ». Du
fait de l'incertitude du jour exact, saint Augustin a pu dire qu'en 387 les
Églises de la Gaule fêtaient la Pâque le 21 mars, celles d'Italie le 18 avril
et celles d'Égypte le 25 avril. Une lettre de Léon le Grand nous apprend qu'en
455 il y avait une différence de 8 jours entre la Pâque de Rome et celle
d'Alexandrie. Au VIIe siècle les Églises britanniques et celtiques suivaient
encore le cycle de 84 ans. Comme elles refusaient absolument d'abandonner cette
ancienne tradition pour le cycle de 532 ans, il y eut une controverse amère
avec les latins. La Pâque était alors célébrée en Angleterre à deux dates
différentes : un jour par les fidèles des Églises britanniques et l'autre par
les membres des Églises latines.
La modification du calendrier
en 1582 fut de nouveau la cause de divergences. Ce nouveau calendrier ne fut
adopté en Grande-Bretagne et en Irlande qu'en 1752. Actuellement les Églises
orientales ne suivent pas encore ce calendrier et leur jour de Pâque ne
coïncide donc pas habituellement avec celui des Églises occidentales.
Les inconvénients d'une fête
mobile ont depuis longtemps fait rechercher une combinaison qui placerait la
date de la Pâque à un jour fixe, mais il n'est pas certain qu'on arrive à une
solution avant la fin de l'âge présent.
Cet aperçu montre les
conséquences d'institutions non scripturaires. Toute cérémonie instituée par
Dieu est déterminée dès le début aussi bien en ce qui concerne la date qu'en ce
qui touche la manière dont elle doit être observée.
Page 133
Jamais il n'y a eu évolution,
ni discussion au sujet des « fêtes de l'Éternel » (2). Que l'on
compare à cela la confusion, les conflits, les divisions produits par les
différentes cérémonies « chrétiennes » et on sera fixé sur leur origine.
Nous n'avons aucune objection
de principe contre une fête mobile, mais bien contre le fait que les manières
de fixer les fêtes « chrétiennes » ont varié et ne sont pas données par Dieu.
Quelques considérations éparses relatives
à « l'Église naissante »
Il faut convenir que l'Église
Romaine est logique dans le raisonnement suivant :
1. « Des communautés visibles ne
peuvent être régies que par une autorité vivante : une loi écrite ou
traditionnelle ne peut pas ne pas enfanter de controverses, de discordes, de
séparations » (1).
2. « Or la chrétienté s'est
substituée à Israël... Il y a substitution d'un peuple à un autre dans le choix
de Dieu, et la nouveauté historique est la création de ce peuple, dont l'unité
est visible comme celle du judaïsme... » (2).
3. Donc : la chrétienté doit
être régie par une autorité vivante.
Comme l'Église romaine est la
seule qui présente une véritable unité, qui est universelle (catholique) et qui
possède un chef visible exerçant l'autorité divine (?), il s'ensuivrait donc
qu'elle serait la vraie Église et que nous devrions tous en faire partie et
être soumis à son magistère.
L'erreur réside surtout dans la
prémisse mineure de ce syllogisme : « Or la chrétienté s'est substituée à
Israël. »
2 (2) Il est vrai qu'il y a eu des discussions entre ceux qui ne tenaient
pas compte des prescriptions divines.
(1) BATTIFOL, P. 66 de l'Église
Naissante. Le protestant Harnack doit admettre cela (Dogmengeschichte,
tome I, p. 416).
(2) BATTIFOL D. 69.
Page 134
Le protestantisme a essayé,
mais avec peu de succès, de résister à la prémisse majeure. Il a pratiquement
admis la nécessité d'une autorité vivante. Quoiqu'il se trouve plus près de la
vérité, sa position est affaiblie par son acceptation de la prémisse mineure. À
part les petites réactions locales et l'influence de l'histoire encore un peu
trop récente des temps de la Réformation, le courant général porte de toutes
parts les milieux protestants vers le catholicisme, ou tout au moins vers une
sorte de catholicisme. Tout le monde ou presque y convient qu'il faudrait
constituer une unité et, du moment où l'on croit à une « Église » visible, il
faut nécessairement donc que l'unité soit visible. D'autre part si on laisse à
Israël sa mission terrestre et si l'on se garde de mettre l'Église à sa place,
l'unité cesse d'être nécessairement visible dans le présent siècle mauvais.
L'erreur fondamentale de
substituer l'Église à Israël a entraîné des difficultés innombrables. Nous
serions alors en plein Royaume des cieux et Satan serait présentement lié 1...
(Apoc. 20 : 2). Or Paul dit que l'âge présent est « mauvais » (Gal. 1 : 4) et
que Satan est le dieu de cet âge (2 Cor. 4 : 4). Pierre ajoute qu'il rôde comme
un lion rugissant (1 Pi. 5 : 8). Le nombre des non-chrétiens dépasse de loin
celui des « chrétiens » et parmi ceux-ci un faible pourcentage, qui va plutôt
diminuant, mérite réellement ce nom. Nous voyons, partout la guerre, la
corruption, le péché. À part l'unité extérieure et de pure apparence de
l'Église romaine, nous ne voyons que divisions dans cette chrétienté qui,
soi-disant, formerait « l'Église visible ». Si l'état actuel était ce que les
prophètes ont dit du Royaume messianique, on se demanderait ce que valent ces
prophéties, et jusqu'à quel point on a le droit de « spiritualiser » aussi les
enseignements de la Loi, du Seigneur et des Apôtres.
Et que devons-nous penser des
Apôtres et des communautés de la première heure, qui tous attendaient le
prochain retour du Christ ? Le Seigneur Lui-même ne s'est-Il pas trompé quand
il parlait de son avènement prochain ? Comment expliquer ce long délai dans la
venue en gloire et dans l'établissement du Royaume sur terre s'il n'y a pas une
interruption nette dans l'accomplissement des prophéties à la fin des Actes, si
le plan divin s'est développé régulièrement par la substitution de « l'Église »
à Israël (3) ?
3 (3) Battifol résume dans l'Église Naissante, p. 174, quelques
théories de A. Sabatier Les communautés chrétiennes de la première heure, - car
dès la première heure le christianisme se forme en communautés, - sont
individuées (sic) par une même foi au retour prochain du Christ, et cette foi
obsédante leur ôte toute pensée d'établissement durable. Les communautés
chrétiennes de la première heure, parce qu'elles vivent dans cette attente
fébrile de la parousie, n'ont besoin d'aucune discipline. »
Page 135
Ceux qui veulent s'appuyer sur
la tradition des premiers siècles, au surplus, ne doivent pas oublier qu'il n'y
a pas une tradition, mais des traditions. Un exemple notable est celui,
que nous avons déjà mentionné, de la controverse pascale. « Le malheur est que,
dans le cas présent, il y a conflit entre deux usages authentiqués tous deux
par une tradition apostolique. Qui l'emportera ? » (4). La tradition se
développe, varie, s'accommode aux circonstances. Comment peut-il être question
de chercher là un appui ?
Toute l'histoire de « l'Église
» montre que le fait d'être martyr, de mener une vie exemplaire, d'être
continent, d'être baptisé d'eau, de s'abstenir de viande, d'alcool, etc. ne
prouve d'aucune manière que l'on est dans la vérité. Le marcionisme, le
montanisme, le novationisme, le donatisme, etc. ont toujours été fiers d'avoir
plus de martyrs que les autres, d'avoir des adeptes saints, continents, etc. Il
en est de même de nos jours, où des groupes même antichrétiens observent
parfois la plus haute moralité et sont des plus humanitaires. Il est vrai qu'un
croyant sérieux doit avoir une marche impeccable, mais il est faux de conclure,
d'une vie apparemment exemplaire, à la possession de la vérité.
Toute la théologie officielle
protestante et catholique romaine est imprégnée de l'idée que « l'Église » est
héritière de toutes les promesses d'Israël. De là des spéculations
innombrables, des controverses sans fin, des problèmes multiples et souvent
insolubles. Les hommes ont tellement embrouillé les choses que n'est pas
théologien qui veut. La théologie est devenue un terrain inaccessible au
profane, qui doit se borner à recevoir ce qu'on veut bien lui enseigner.
Malheureusement il n'y a pas de concordance et la « foi » devient une affaire
de clan. Alors qu'un examen des Écritures - prises à la lettre là où c'est
possible - est relativement simple et peut être entrepris par le croyant
lui-même, on est actuellement forcé de choisir d'abord une « autorité »
(et sur quelle base ?), puis d'accepter servilement l'enseignement de cette
autorité.
(4) BATTIFOL, dans l'Église Naissante, p.
270.
Page 136
Pour des choses terrestres,
d'une importance toute relative, il est convenable qu'on accepte cette manière
de procéder ; mais quand il s'agit de notre être, de choses divines, aucune «
autorité » autre que celle de Dieu ne peut être indispensable. Si les hommes
peuvent servir d'instruments entre les mains de Dieu, jamais ils ne doivent
avoir la prétention de se substituer à Lui et de rendre impossible une
vérification personnelle. « Je vous parle comme à des hommes intelligents,
disait l'apôtre Paul, jugez vous-mêmes de ce que je dis. » (1 Cor. 10 :
15).
Citons quelques difficultés prises
au hasard. On voit Harnack se demander pourquoi Luc a perdu tout intérêt dans «
l'activité missionnaire » de Pierre après Actes 12, alors qu'il lui semble que
cette activité doit l'avoir rapproché de Paul (5).
Harnack reconnaît que Paul n'a
pas admis qu'Israël était rejeté définitivement, mais il dit que ce point de
vue lui est particulier (6). En général on a accepté cette réjection car si
l'on maintient une seule promesse pour Israël, comment pourrait-on «
spiritualiser » le reste et qui nous autoriserait à appliquer les autres
promesses à un peuple étranger (7) ? Mais alors il faut rejeter toute
interprétation littérale de l'A. T. et Israël n'aurait donc jamais été le vrai
peuple élu ! C'est en effet à cette conclusion que beaucoup de chrétiens des
premiers siècles ont été conduits. Mais ils admettaient que les patriarches,
les prophètes et les autres hommes de Dieu étaient les précurseurs du « peuple
» chrétien, qui existait alors à l'état latent (8) ! Harnack reconnaît que
c'est là l'opinion unanime de tous les auteurs chrétiens de la période
postapostolique et il ajoute qu'une injustice pareille de l'Église des Gentils
par rapport aux Juifs est unique dans l'histoire : la Fille rejette la Mère
après l'avoir dépouillée (9). Il pense cependant pouvoir accepter cette
solution si elle est exprimée d'une manière un peu différente, c à d. que «
l'Église » prend dans les « traditions » d'Israël ce qui est utilisable et
spiritualise ou rejette le reste.
5 (5) Die Mission und
Ausbreitung des Christentums, p. 43.
(6) Id., p. 46.
(7) Id., p. 47.
(8) Id., p. 49.
(9) Id., P. 50.
Page 137
C'est la transformation de la
religion juive en une religion universelle. Il est regrettable qu'il n'explique
pas comment Paul a résolu la difficulté. L'abandon de Paul est d'ailleurs un
problème qu'à notre connaissance, on ne touche même pas.
Parlant de la libération des
chrétiens du judaïsme, vers l'an 140, Harnack ajoute :
« Quarante ans après, Irénée
pouvait considérer l'A. T. et sa religion d'une manière plus objective, car on
ne se trouvait plus alors gêné par le judaïsme dans la possession de l'A. T.
Irénée pouvait de nouveau admettre que l'observation littérale de l'A. T. était
juste et selon la volonté de Dieu dans l'ancien temps. Les Pères qui lui
succédèrent allèrent encore plus loin et dans un sens se rapprochèrent ainsi de
Paul. Mais dans un autre sens, ils s'écartaient simultanément de lui, et si
possible encore plus que les générations précédentes, parce qu'ils comprenaient
encore moins son opposition à la Loi et qu'ils avaient à défendre l’A. T.
contre les Gnostiques. Ils acceptaient facilement le sens littéral de l'A. T.
non seulement parce qu'ils ne craignaient plus le judaïsme, mais surtout à cause
de leur sympathie pour les lois et les cérémonies de FA. T. » (10).
La dogmatique des siècles
succédant aux deux premiers commençait à dépasser l'A. T., mais la vie courante
de l'Église n'en était pas affectée. Nous voyons encore aujourd'hui l'opposition
criante qui existe entre une grande partie de la théologie biblique et la
pratique courante et cela plus encore dans l'Église romaine que dans le
Protestantisme. L'accommodation est allée si loin que d'un pays à l'autre cette
Église présente les aspects les plus divers. Cette inconséquence est possible
du fait que rares sont ceux qui pensent, surtout quand il s'agit de « religion
». Il semble que, dans ce domaine, on est prêt à accepter n'importe quoi.
Autant cependant une foi « aveugle » en ce que Dieu dit dans Sa Parole est
justifiée et logique, et glorifie Dieu, autant une crédulité aveugle est un
scandale qui appelle nécessairement des réactions, parfois même violentes comme
celles que nous voyons actuellement en Russie.
Nous citerons encore le cas du
grand théologien anglais Lightfoot, qui, dans son introduction à l'épître aux
Colossiens, se demande comment il est possible que trois siècles après la
rédaction de cette épître, il était encore nécessaire au Concile de Laodicée
(363 ?) d'anathématiser ceux qui observaient le sabbat.
10 (10) Id., p. 51.
Page 138
Or si l'on a suivi
attentivement notre examen, cela n'est nullement étonnant. On voulait
s'approprier toutes les promesses d'Israël, mais on n'était pas encore
entièrement arrivé à se les assimiler et quelques-uns tenaient, comme dans la
controverse pascale, à suivre les choses plus à la lettre que les autres. Même
au IVe siècle l'existence de ceux qui fêtaient la Pâque le 14 Nissan et que
l'on appelait les « Quartodecimans » (11) est historique (12). Et n'avons-nous pas encore de nos jours les «
Sabbatistes » qui portent avec une surprenante constance le poids de la
tradition des premiers siècles et ne peuvent pas se résoudre à « spiritualiser
» ?
11 (11) En latin 14 est , quartodece ».
(12) Mosheim, Hist. Christ.
Saec. 2, § 71.